Recueil sur la faune - 1960 à 1979
- JF
- 28 mars 2025
- 24 min de lecture
Dernière mise à jour : 18 avr. 2025



Devant le choix démesuré qu’offre au philatéliste débutant l’éventail de ces petites vignettes émises, depuis la création du timbre, par l’ensemble des pays du monde, la première tâche est celle de sélectionner le ou les thèmes de sa future collection.
Ce fut mon cas lorsqu’encore enfant, je fus intrigué par ces enveloppes que mon oncle et parrain, grand voyageur et philatéliste lui-même, nous adressait depuis les pays qu’il traversait.
Elles étaient abondamment ornées de timbres, de leurs pays de provenance, que je récupérais et gardais précieusement.
Mon oncle m’avait appris très tôt comment récupérer ces petites vignettes sans les abimer, en immergeant les enveloppes dans une bassine d’eau tiède.
Les timbres décollés et flottant en surface après quelques instants pouvaient être collectés précautionneusement, à l’aide d’une pince à épiler avant d’être mis à sécher sur un linge propre.
Insérés ensuite entre les pages d’un livre, ils retrouvaient leur aspect d’origine, si l’on excepte les oblitérations dont les services postaux les avaient affublés.
Enrichi de tout ce que je pouvais récupérer auprès de mes proches et des copains avec lesquels, munis de doubles, je procédais à des échanges, mon petit pécule prit assez vite de l’importance.
C’était l’heure des choix.
Toujours auprès de cet oncle providentiel, j’avais récupéré de vieux catalogues Yvert et Tellier et je procédais à une première tentative de classement dans des cahiers d’écolier où mes précieuses vignettes étaient collées à l’aide de charnières translucides spéciales comme je l’avais vu faire.
J’ai rapidement été débordé par la multiplication des thèmes possibles ainsi que par les problèmes économiques que cette passion m’imposait.
Je rêvais de me procurer l’un de ces catalogues superbes dans lesquels, chaque timbre étant représenté par impression, il suffisait de coller à sa place la vignette correspondante et constituer peu à peu une magnifique collection.
Une seule option était économiquement possible, limiter mes prétentions à la France et c’était déjà très important, la poste française produisant annuellement une moyenne d’une soixantaine de timbres.
Les années ont passé, sans éteindre ma passion philatélique, et ma collection, enrichie par celle de mon cher oncle décédé il y a déjà bien longtemps, est considérable.
De cette profusion de vignettes est née une autre idée, celle de restreindre mes choix en sélectionnant et illustrant les thèmes que propose la Poste Française lors de ses émissions annuelles.
Dans un premier temps, je me suis intéressé aux personnalités célèbres sélectionnées par cette administration.
C’est un vaste sujet que je continue à développer.
En observant les années écoulées depuis la première émission de 1849 et son célèbre « type Cérès », j’ai été surpris de constater qu’aucun timbre évoquant la faune animale n’a été émis pendant plus d’un siècle.
C’est seulement en 1960 qu’avec une première série sur les oiseaux, la Poste
Française a pris conscience de l’énorme vivier de sujets à exploiter pour ses publications annuelles.
Depuis, elle s’est largement emparée du sujet au point que, depuis la fin du vingtième siècle et jusqu’à ce jour une série de quatre timbres est proposée, presque chaque année, sur diverses catégories d’animaux.
Ce sont donc pour ces longtemps « oubliés de la Poste » que je me propose de dresser des fiches illustrées par leurs timbres.

Série de quatre timbres sur les oiseaux avec pour thèmes conjoints la protection de la nature et l’étude des migrations
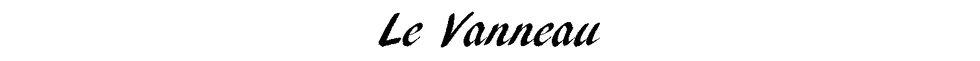

Valeur faciale du timbre 0,20 Francs
Dessiné et gravé par Pierre Gandon
Référence catalogue Yvert et Tellier n°1273
De son vrai nom « Vanneau huppé » son appellation scientifique étant « Vanellus vanellus », le vanneau est une espèce de petit échassier dit « limicole ».
Mesurant une trentaine de centimètres pour une envergure de plus de quatre-vingts, il peut peser jusqu’à 330 grammes.
Sa tête est ornée d’une longue huppe noire, ses fines pattes sont orangées, son ventre est blanc et ses ailes, sombres dessus et blanches dessous, font entendre, lors de leur battement très rapide, un son rappelant le bruit de cette sorte de grand tamis appelé van qu’avait coutume d’utiliser le vanneur.
De là vient son nom de vanneau.
Très commun on le trouve dans les zones de marais, prairies et champs cultivés du centre de l’Asie, de l’Europe, depuis la péninsule Ibérique jusqu’à la Scandinavie.
Durant la saison hivernale, sensible au froid, il migre vers les régions au climat plus doux, jusqu’en Afrique du Nord, et on peut l’observer en colonies nombreuses, en France, dans les régions maritimes.
Il se nourrit d’insectes, d’araignées et de vers de terre.
Il niche au sol de fin mars au mois de mai, la femelle pondant généralement quatre œufs dans une cavité aménagée par le mâle durant la parade nuptiale.
Après une incubation d’une trentaine de jours, les juvéniles quittent le nid quelques heures après l’éclosion et volent au bout de cinq semaines.


Valeur faciale du timbre 0,30 Francs
Dessiné et gravé par Pierre Gandon
Référence catalogue Yvert et Tellier n°1274
Les macareux sont des oiseaux qui vivent exclusivement en tribu.
Ils font partie de la famille des « Alcidés », oiseaux marins dont la particularité est de pouvoir nager sous l’eau en se propulsant à l’aide de leurs ailes.
Ce sont des volatiles à l’aspect très particulier avec leur gros bec triangulaire et coloré, notamment en période nuptiale.
Avec un corps d’une trentaine de centimètres de long, leur envergure peut atteindre 60 centimètres pour un poids d’environ 500 grammes.
Ils passent la plus grande partie de leur temps en mer, ne séjournant à terre que lors de la période nuptiale, de la nidification et de l’éducation des petits.
Réunis en colonies nombreuses au sommet des falaises, les femelles ne pondent qu’un seul œuf, sous le couvert des herbes, dans un nid de plumes.
Ils peuvent aussi nicher dans des trous creusés dans les falaises avec leur bec.
Ils se nourrissent de poissons et occasionnellement de mollusques ou crustacés qu’ils attrapent sous l’eau et qu’ils stockent dans leur bec en grand nombre avant de les consommer à terre.
Confrontés au problème de raréfaction des populations de poissons en raison de la surpêche, leur population décroit de façon alarmante.


Valeur faciale du timbre 0,45 Francs
Dessiné et gravé par Pierre Gandon
Référence catalogue Yvert et Tellier n°1275
Sarcelle est le nom commun donné en français à certains canards de petite taille, la « Commission internationale des noms français des oiseaux » limitant cette appellation à une vingtaine d’espèces et sous-espèces.
Il est probable que les oiseaux auxquels se réfère la Poste française avec ce timbre soient en réalité des « sarcelles d’hiver », la plus petite espèce de canards dits « de surface » que l’on peut rencontrer en Europe, en Amérique du Nord et même en Asie.
D’un poids variant entre 250 et 400 grammes, la sarcelle est de petite taille, 35 à 40 centimètres pour une envergure inférieure à 60 centimètres.
Le mâle, avec son ventre est blanc, ses ailes vertes et noires avec des bandes blanches devenant jaunâtres vers l’intérieur, est un joli petit canard aux pattes palmées et au vol rapide et élégant.
Lors de la période nuptiale, sa tête se pare d’une couleur brun-rouge, barrée d’une bande verte cernée d’un trait de couleur crème.
Comme la plupart des oiseaux de cette espèce, la femelle avec son plumage marron pommelé est plus terne que le mâle.
Sa queue est bornée d’une courte ligne blanche.
Les sarcelles se nourrissent de graines de plantes de zones humides, d’algues et de plantes aquatiques, mais aussi de petits crustacés, mollusques, larves d’insectes et même d’œufs de poissons.
La saison de ponte s’étend de mai à juillet suivant les régions, la femelle pondant de 8 à 11 œufs dans un nid garni de duvet et soigneusement dissimulé par une végétation aussi dense que possible.
L’éclosion a lieu au terme d’environ trois semaines et les canetons seront en état de voler au bout de 25 à 30 jours, leur durée de vie étant de 15 ans en moyenne.


Valeur faciale du timbre 0,50 Francs
Dessiné et gravé par Pierre Gandon
Référence catalogue Yvert et Tellier n°1276
De son vrai nom « Guêpier d’Europe », son appellation scientifique étant « Merops apiaster », le Guêpier est une espèce d’oiseau appartenant à la famille des « Meropidae », qui ne compte pas moins de 27 espèces existantes de guêpiers.
Mesurant 28 centimètres et pesant une soixantaine de grammes, son envergure peut atteindre 50 centimètres.
Oiseau européen et nord-africain, il est extrêmement coloré.
Des reflets métalliques composés de bleu-vert turquoise pour les plumes de son ventre, de son poitrail et du bas de ses ailes, de brun-roux pour son dos, sa tête et le haut de ses ailes, et de vert-sombre pour sa queue font de ce magnifique oiseau l’un des plus brillants d’Europe.
Comme son nom l’indique, l’essentiel de sa nourriture est composé de guêpes, abeilles et frelons, mais il ne dédaigne pas de nombreux autres insectes qu’il chasse en vol à la façon des hirondelles.
Après l’accouplement précédé d’une sorte de parade nuptiale, le couple creuse une galerie dans laquelle la femelle pond cinq œufs en moyenne, couvés chacun à leur tour par les deux oiseaux durant trois semaines.
Les jeunes prendront leur envol au bout d’environ un mois, mais les parents devront continuer à les nourrir pendant trois nouvelles semaines, avant qu’ils ne soient réellement autonomes.

Un timbre au profit du Fond mondial pour la nature.


Valeur faciale du timbre 0,45 Francs
Dessiné et gravé par Robert Cami
Référence catalogue Yvert et Tellier n°1613
Le mouflon méditerranéen, parfois appelé « mouflon européen », désigne trois groupes de mouflons différents originaires des îles méditerranéennes, Corse, Sardaigne et Chypre.
L’animal descendrait de mouflons du Proche-Orient domestiqués et introduits dans ces îles au Néolithique avant de repasser à l’état sauvage.
Ancêtre du mouton domestique, c’est une sorte de gros mouton à la laine foncée, mesurant de 0,90 à 1,30 mètre de long, le mâle arborant une paire de superbes cornes spiralées.
Les femelles sont plus petites que les mâles, leurs poids respectifs adultes étant de 35 kg pour les premières et 50 kg pour les seconds.
Ils vivent en groupes farouches dans des lieux escarpés, jusqu’à 3 000 mètres d’altitude, où ils se nourrissent de broussailles attendries par la rosée.
C’est un animal herbivore, actif de l’aube au crépuscule, les mâles regroupés entre eux et les femelles formant d’autres groupes avec les petits.
Très à l'aise sur les falaises escarpées, il est rapide à la course avec des pointes à 50 à 60 km/h.
Les femelles ne rencontrent les mâles qu’en automne, à la période du rut.
La gestation dure environ cinq mois et la femelle donne naissance à un ou deux petits qu’elle allaitera durant trois mois, les agneaux restant près de leur mère jusqu’à leur majorité sexuelle.
Leur espérance de vie est estimée à une douzaine d’années.

Un timbre au profit du Parc national des Pyrénées Orientales


Valeur faciale du timbre 0,65 Francs
Dessiné et gravé par Claude Haley
Référence catalogue Yvert et Tellier n°1675
L'Isard ou Izard est un mammifère qui fait partie de la famille des bovidés et de la sous-famille des caprins.
En France, environ 24 000 isards sont répartis sur l'ensemble de la chaîne des Pyrénées, dont environ 5 000 individus dans le « Parc National des Pyrénées Orientales ».
Son nom vient du mot pyrénéen izardo.
Il fait partie du même genre que le chamois des Alpes, dont il diffère par son poids, plus lourd d'une dizaine de kilogrammes et par un pelage d'été plus roux et un pelage d'hiver plus clair, avec un collier de poils noirs au niveau du cou.
Ses cornes forment un crochet plus ouvert que celui du chamois.
Sa hauteur au garrot est de 70 à 80 cm et sa longueur est d'environ un mètre.
Le mâle, plus lourd que la femelle, pèse entre 25 et 40 kg, la femelle, quant à elle, fait entre 22 et 30 kg.
Il a une espérance de vie d'environ 20 à 22 ans.
Il se déplace en hardes généralement sous la conduite d'une femelle, les mâles adultes vivant en solitaires. Ces derniers rejoignent les femelles en octobre et novembre, à l'époque du rut.
Le jeune, ou cabri, naît à la fin du printemps, après une gestation de 23 semaines et est sevré à 6 mois, s'il échappe à l'aigle royal dont il est une des proies préférées.
A l'âge d'un an, les femelles prennent le nom « d' éterle » et les mâles celui « d'éterlou ».
Cet animal a été très chassé jusque dans les années 1960 et a failli disparaître, mais il a pu être sauvé grâce, justement, à la création en 1967 du « Parc National des Pyrénées Orientales ».
En dehors de la France, on trouve l'isard en Espagne, qui compte près de 70 000 individus, et, grâce à différentes réintroductions, en Italie où on en dénombre près de 4 000.

Série de trois timbres sur le thème de la protection de la nature.


Valeur faciale du timbre 0,60 Francs
Dessiné et gravé par Pierre Forget
Référence catalogue Yvert et Tellier n°1692
Le saumon est un nom commun désignant plusieurs espèces de poissons de la famille des salmonidés.
- Huit espèces du genre « Oncorhynchus » vivant dans le nord de l’océan Pacifique,
- Deux espèces du genre « Hucho » vivant dans le bassin du Danube,
- Une espèce du genre « Salmo » vivant dans le nord de l’océan Atlantique.
C’est probablement cette dernière espèce à laquelle il est fait référence avec ce timbre.
La vie des saumons est rythmée par trois cycles très différents et particuliers.
- Une naissance en eau douce vers la source des rivières de l’hémisphère nord ,
- Une migration des alevins, après une à deux années passées en rivière où ils sont devenus des « tacons » d’environ 15cm, vers l’océan pour une croissance en eau de mer jusqu’à la maturité sexuelle,
- Un retour vers la source de la rivière de naissance pour y pondre et y mourir.
Cette remontée vers la source pour y pondre a longtemps été et reste un des grands mystères de la nature.
Comment cet alevin fraîchement éclos à la source d’une rivière retrouve-t-il infailliblement son lieu de naissance après des années vécues en mer ?
Autrefois, les saumons remontaient par millions les rivières d’Europe pour aller pondre.
Avec une extraordinaire opiniâtreté, bravant tous les obstacles et tout particulièrement les rapides et les chutes, décimés par les animaux sauvages et tout particulièrement les ours, ils répondent à l’instinct qui leur impose d’aller donner la vie avant, pour l’écrasante majorité d’entre eux, de mourir épuisés.
Jadis, très communs dans l’océan Atlantique, les saumons sauvages ont quasiment disparu, victimes, entre autres, de la révolution industrielle et agricole.
La plupart des saumons que l’on retrouve sur nos tables, frais ou fumés, sont issus de piscicultures où ils font l’objet d’un élevage spécifique appelé « salmoniculture » de plus en plus industrialisé.
Sept espèces de saumons sont consommées :
- Le « saumon royal » mesurant en moyenne 84 à 91 cm et pesant de 14 à 18 kg, c’est le plus grand des saumons.
Sa chair rose clair à orange foncé est commercialisée fraiche, congelée ou fumée.
- Le « saumon rouge » fait partie des espèces les plus recherchées. Mesurant 60 à 70 cm, il pèse entre 2 et 3 kg.
Sa chair rouge mat est très savoureuse et se prête bien à la mise en conserve.
- Le « saumon argenté », troisième espèce vendue, mesure en moyenne 45 à 60 cm pour un poids de 2 à 4,5 kg.
Sa chair excellente, rouge argenté, est très utilisée pour la mise en conserve.
- Le « saumon rose », le plus petit du genre, mesure entre 43 et 48 cm pour un poids de 1,3 à 2,3 kg.
Sa chair rosée, plutôt molle, convient surtout à la conserverie.
- Le « saumon keta » mesure en moyenne 64 cm et pèse 5 à 6 kg.
Sa chair moins bonne, rosée et plutôt molle, a toutefois l’avantage d’être moins grasse et moins couteuse.
- Le « saumon de l’Atlantique » est à la fois plus résistant et plus sauvage que les précédents.
Il ne meurt pas forcément après le frai et peut se reproduire trois et même quatre fois.
Sa chair rose est délicate et délicieusement parfumée.
Apprécié par les pêcheurs pour sa combativité, les spécimens capturés mesurent de 80 à 85 cm pour un poids de 4,05 kg.
- Le « ouananiche » est un saumon exclusivement d’eau douce qui a été emprisonné dans les terres à l’époque glaciaire.
Il vit en Amérique du Nord et en Scandinavie, mesure entre 20 et 60 cm et pèse rarement plus de 6 kg.
Ce poisson forme une espèce à part entière, tant par son habitat que par certaines modifications corporelles qui le distinguent du saumon.


Valeur faciale du timbre 0,60 Francs
Dessiné et gravé par Pierre Forget
Référence catalogue Yvert et Tellier n°1693
Le caméléon fait partie de la famille des « caméléonidés », sous-famille arboricole des « sauriens ».
On compte près de 200 espèces de caméléons dont les tailles peuvent aller, queue comprise, de 3 à près de 70 cm.
Les caméléons sont des lézards, et donc des reptiles, au mode de vie diurne et présentant tous les nombreuses particularités anatomiques suivantes :
- la mobilité indépendante de leurs yeux proéminents, qui leur permettent de surveiller simultanément et de tous côtés l’approche des prédateurs.
En présence d’une proie, leurs yeux convergent vers elle pour être plus précis.
- leur langue protractile enduite d’un mucus gluant qui leur permet, en la projetant avec une grande précision, en 1/25ème de seconde et à une vitesse pouvant atteindre 90 km/heure en 1/100ème de seconde, d'attraper des proies à une distance qui peut atteindre deux fois la longueur de l’animal,
- les doigts griffus groupés en deux blocs opposables assurant une bonne prise sur les branches,
- leur capacité à changer de couleur, grâce à deux couches de « nano cristaux » incorporées à leur épiderme.
Les robes des caméléons permettent de les identifier, les caméléons nains, plutôt terrestres, ont en général une robe plutôt marron, mais les espèces arboricoles arborent souvent du vert, du jaune ou du bleu.
- leur queue assez longue qui peut s’enrouler sur elle-même et leur sert à se stabiliser.
Mâles et femelles sont souvent très différents.
Les mâles, la plupart du temps plus grands et gros que les femelles, ont une tête ornée de crêtes ou cornes généralement plus développées que celles des femelles chez qui ces appendices peuvent, parfois même, être complètement absents.
Les mâles ont la plupart du temps des couleurs plus vives et contrastées.
Les caméléons se rencontrent en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie du Sud et dans le sud de l’Europe, mais c’est surtout à Madagascar, souvent considérée comme le berceau de la race, que vivent les deux tiers de leur population, dans les plaines broussailleuses, humides à très humides, parfois jusqu'à plus de 2 000 m d'altitude.
La majorité des caméléons est ovipare, les femelles creusant le sol pour y pondre.
La gestation dure en principe un à deux mois, mais peut durer jusqu’à six mois pour certaines espèces.
Tous les caméléons sont des insectivores et attrapent la plupart des insectes qui passent à leur portée.
Toutefois, certaines espèces parmi les plus grandes consomment également de petits oiseaux ou des lézards.
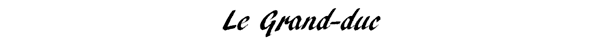

Valeur faciale du timbre 0,65 Francs
Dessiné et gravé par Pierre Forget
Référence catalogue Yvert et Tellier n°1694
Le Hibou Grand-duc également appelé Grand-duc d’Europe est le plus grand rapace nocturne, vivant de préférence à proximité de falaises et de cours d’eaux, dans une très large bande centrale d’Europe et d’Asie, du Portugal à la Corée.
Il mesure environ 75 cm de haut pour un poids de 2 à 2,5 kg pour le mâle et jusqu’à 3,3 kg pour la femelle.
Sa silhouette massive, au plumage brun-roussâtre sur le dos et fauve sur le ventre zébré de brun foncé, est presque invisible tant elle se confond avec les branches sur lesquelles il est perché.
Sa tête est surmontée de deux aigrettes d’environ 8 cm, dressées verticalement quand il est excité, mais normalement horizontales.
N’ayant aucun autre prédateur que l’homme, c’est un « surprédateur » au vol agile et silencieux grâce auquel il surprend ses proies, mammifères, rongeurs, oiseaux, serpents, lézards et même d’autres rapaces diurnes ou nocturnes.
Son cri est une sorte de « hou-hou » répété une ou plusieurs fois et audible de loin.
Dans une falaise, de fin mars à début avril, le couple installe un nid simplement garni des poils et des plumes arrachées à ses proies.
La femelle pond 2 à 4 œufs blancs qu'elle couve seule pendant 32 à 37 jours, tandis que le mâle lui apporte de la nourriture.
Un mois et demi plus tard environ, les petits quittent le nid mais restent à proximité, protégés par la femelle qui n'hésite pas à attaquer, avec le bec et les serres, tout intrus susceptible de menacer ses jeunes, aidée en cela par le mâle.
À trois mois, ils savent parfaitement voler.
Le Grand-duc est une espèce menacée de disparition en raison
- de la fragmentation écologique de son habitat,
- du braconnage,
- des pesticides et des poisons utilisés contre les rongeurs qu’il ingère, ces poisons s’accumulant dans son organisme et pouvant entrainer sa mort,
- de la pollution lumineuse, car il est très sensible à l’éblouissement des phares de voiture,
- de la multiplication des câbles électriques et autres fils aériens
- de l’épidémie de myxomatose qui touche le lapin, l’une de ses proies principales.
Fort heureusement, en France, depuis l’arrêté ministériel du 17 avril 1981, il bénéficie d’une protection totale sur l’ensemble du territoire et est également inscrit à l’annexe 1 de « la directive Oiseaux de l’Union européenne ».

Série de deux timbres sur le thème de la protection de la nature.


Valeur faciale du timbre 0,40 Francs
Dessiné et gravé par Robert Cami
Référence catalogue Yvert et Tellier n°1754
Symbole du Parc National de la Guadeloupe, ce raton laveur, aussi appelé « Ti-rakoun » en créole, est considéré comme une sous-espèce du raton laveur commun.
Petit animal au pelage gris-brun sur le dos et gris clair sur le ventre, il donne l’impression de porter un masque de loup.
Introduit en Guadeloupe au 18ème siècle, à la suite au naufrage d’un bateau américain, il vit à présent, au-dessus de 300 m d’altitude, dans les forêts et les zones humides de la Soufrière en Basse-Terre.
De mœurs nocturnes et arboricoles, il est capable de grimper aux arbres en s’aidant de ses griffes acérées ou bien de pêcher dans un torrent.
Il se nourrit d’oiseaux, de mollusques, de crabes, de poissons ou de fruits qu’il nettoie préalablement dans l’eau des rivières avant de les consommer.
Son espérance de vie est en moyenne de 10 ans et sa gestation d’environ 9 à 10 semaines.
Il est protégé en Guadeloupe depuis 1954.


Valeur faciale du timbre 0,60 Francs
Dessiné et gravé par Robert Cami
Référence catalogue Yvert et Tellier n°1755
Symbole de la région alsacienne, la cigogne blanche fait partie de la famille des « ciconiidés ».
Elle n’est pas présente qu’en Alsace et on la trouve à présent, comme espèce nicheuse, pratiquement dans toutes les régions françaises ainsi qu’en Belgique, au Pays-Bas et en Espagne.
Ce grand échassier carnivore mesure environ un mètre de long et son envergure peut atteindre deux mètres pour un poids moyen de trois kilos, le mâle étant un peu plus lourd que la femelle.
La cigogne peut vivre de 20 à 30 ans.
Son plumage est blanc avec du noir sur les ailes, son bec et ses pattes étant d’un beau rouge.
C’est un oiseau migrateur qui quitte l’Alsace chaque année pour passer la saison hivernale en Afrique Occidentale.
Les cigognes nichent en hauteur, généralement sur les toits, mais également sur des pylônes électriques et des arbres, dans des nids de branchages de forme circulaire d’environ 1,50 m de diamètre et dont le poids, au fil des ans et des consolidations, peut atteindre et même parfois largement dépasser les 500 kg.
Mâle et femelle participent à la couvaison et à l’élevage des deux ou trois petits.
En grand danger de disparition, alors qu’en 1960 on dénombrait près de 160 couples, ils n’étaient plus que 9 en 1974 dans toute l’Alsace.
L’État a du réagir et en 1976, l’espèce fut protégée par la loi.
Des centres de réintroduction furent créés un peu partout, si bien qu’en 2017, on estimait la population à environ 850 couples, chiffre sensiblement égal à celui qu’on connaissait au 19ème siècle.

Série de trois timbres sur le thème de la protection de la nature.


Valeur faciale du timbre 0,40 Francs
Dessiné et gravé par Robert Cami
Référence catalogue Yvert et Tellier n°1795
Le Bison d’Europe est une espèce de mammifère ruminant de la famille des bovidés dont il existe deux types, ce dernier et le Bison d’Amérique.
Alors qu’il était commun à l’époque préhistorique, il a failli être exterminé par la chasse et aussi par la quasi-disparition de son milieu naturel qu’était « la forêt primaire ».
Les derniers spécimens sauvages ont été tués en Pologne en 1927.
À la fin des années 1920, les seuls bisons d'Europe encore vivants (54, dont 29 mâles et 25 femelles) ne survivaient plus que dans les zoos.
Seuls douze géniteurs sur les 54 survivants se sont finalement reproduits.
Désormais protégé, il est peu à peu réintroduit en Europe depuis les années 1950, à partir de spécimens reproducteurs élevés dans des parcs zoologiques.
En 2020, le recensement des Bisons d'Europe permettait de dénombrer :
- 1 791 individus en captivité,
- 501 en semi-liberté,
- et 6 819 à l'état sauvage vivant pour l’essentiel à l’est du continent.
C’est le plus gros mammifère d’Europe.
Le poids moyen d’un mâle est d’environ 800 kg, pouvant atteindre et même dépasser nettement la tonne.
Avec environ 3m de long, sa taille peut atteindre 1,80 et même 2 m au garrot.
La femelle, plus petite, peut toutefois peser jusqu’à 600 kg.
Il peut vivre de 15 à 20 ans.
Après des accouplements qui ont lieu durant la période allant de la fin de l’été au début de l’automne, les petits naissent au printemps, après neuf mois de gestation.
L’animal vit en petits troupeaux familiaux d’une trentaine de bêtes au maximum, sous la direction d’une femelle, se nourrissant de végétaux variés avec une prédominance d’herbe, mais également d’écorces et de feuilles.
Ces troupeaux ont tendance à se disperser l'été en petits groupes et à se reformer à l'automne.
Malgré tous les efforts consentis, l’espèce est toujours menacée :
- du fait de l’étroitesse des territoires qui sont accordés aux troupeaux vivant en liberté et qui de ce fait sont plus facilement menacés par les aléas tels que le climat, les maladies, les prédateurs ou le braconnage.
- pour cette même raison, les troupeaux trop petits et trop dispersés sont affectés par une consanguinité qui est la cause de problèmes osseux et de fertilité apparaissant dans certains groupes.


Valeur faciale du timbre 0,65 Francs
Dessiné et gravé par Robert Cami
Référence catalogue Yvert et Tellier n°1819
Le Tatou géant est également appelé Cabassou en Guyane.
Vivant à proximité des cours d’eau, on le trouve dans la forêt tropicale de l’est de l’Amérique du Sud et dans le nord de l’Argentine.
Tous les deux jours, il creuse un nouveau terrier pour trouver une température stable à 5 m de profondeur.
Ces terriers abandonnés sont ensuite utilisés pour y nicher par toutes sortes d’espèces, au nombre d’au moins une vingtaine.
L’animal nocturne, doté d’un très bon odorat, est insectivore mais mange également de petits serpents et de charognes qu’il trouve en creusant le sol.
D’une longueur allant de 90 à 160 cm, dont un tiers pour la queue, il pèse entre 20 et 30 kg.
Son dos et sa tête protégés par une armature de 11 à 13 bandes osseuses, son corps reste très flexible et lui permet de se mouvoir aisément.
Ses pattes dotées de longues griffes lui permettent de creuser facilement et d’éventrer et de détruire termitières et fourmilières qui sont la source essentielle de sa nourriture, les insectes étant capturés à l’aide d’une langue qui sécrète une substance visqueuse.
Il vit en moyenne 12 à 15 ans.
Les deux sexes vivent séparés et l’accouplement résulte d’une rencontre fortuite entre mâle et femelle.
La période de gestation est de 16 semaines, la femelle mettant au monde de un à trois petits.
C’est une espèce en grand danger d’extinction.


L’aigrette Garzette est un oiseau échassier de la famille des « Ardeidae » qui mesure entre 55 et 65 cm avec une envergure de 85 à 95 cm et un poids d’environ 500 gr.
Entièrement blanche avec un bec noir et des pattes également noires avec des ongles jaunes, elle porte sur l’arrière de la tête, en période nuptiale, une aigrette formée par deux longues et fines plumes.
Elle se nourrit principalement de petits poissons, d'insectes, de crustacés, de mollusques, d'araignées, de vers, de reptiles et de petits oiseaux.
Vivant en colonies, elle niche, suivant les cas, au sol dans les roseaux ou les broussailles, mais également dans les arbres ou les rochers.
Le couple façonne un nid de roseaux et de brindilles dans lequel, de fin avril à début mai, la femelle pond 3 à 5 œufs de couleur bleu-verdâtre, couvés durant 21 à 25 jours, alternativement par chacun des deux oiseaux.
Les jeunes quittent le nid au bout de cinq semaines.
On la trouve au sud de l’Europe et sur tout le pourtour méditerranéen jusqu’en Afrique subsaharienne dans les zones humides avec une prédilection pour les eaux saumâtres.
Sensible au froid, elle est généralement migratrice, la majeure partie de la population passant l’hiver en Afrique.

Un timbre sur le thème de la protection de la nature.


Valeur faciale du timbre 0,80 Francs
Dessiné par Yvonne Schach-Duc
Référence catalogue Yvert et Tellier n°1946
La cigale rouge ou « Tibicina haematode » est un insecte hémiptère de la famille des « Cigadidae ».
Avec ses 26 à 38 mm de longueur et son envergure de 75 à 85 mm, c’est l’une des plus grosses cigales métropolitaines.
Son nom commun a pour origine le fait que les nervures de son aile antérieure sont de couleur brun-rouge.
Comme c’est le cas pour toutes les cigales, les mâles possèdent sous l’abdomen deux organes stridulants destinés à attirer les femelles.
Cette cigale est présente dans la plupart des régions françaises, mais surtout dans la partie méridionale de l’hexagone.
On la trouve également dans les vergers de cerisiers et dans les vignes en Bourgogne, Saône-et-Loire, Côte-d’Or et Yonne.
Grâce à leurs pattes antérieures fouisseuses, les larves creusent des galeries dans le sol où elles vivent durant au moins deux années.
C’est alors qu’elles remontent à la surface, grimpent sur un support végétal et s’extraient de leurs enveloppes nymphales qu’elles abandonnent, vides, sur leur support avant de s’envoler.
A ce stade, jusqu’à l’envol, elles sont particulièrement vulnérables et des cibles privilégiées pour les guêpes, frelons et fourmis.
C’est le symbole des régions provençales qui sont indissociables de leur chant.

Un timbre sur le thème de la protection de la nature.


Valeur faciale du timbre 1,80 Francs
Dessiné et gravé par Pierre Forget
Référence catalogue Yvert et Tellier n°2018
Le Balbuzard pêcheur ou « Pandion haliaetus » est un oiseau rapace diurne piscivore de la famille des « Accipitridae » dont font partie, entre autres, les aigles, les buses et les vautours.
Sa taille varie entre 50 et 66 cm pour une envergure allant de 127 et 174 cm.
Tête, poitrine et le dessous des ailes sont de couleur blanche avec diverses marques sombres.
Le dessus de l'animal est brun brillant.
Ses ailes longues et étroites sont ornées d’une bande sombre en bout des rémiges et leur extrémité digitée donne à cet oiseau son aspect caractéristique.
Ses serres sont longues et noires et leurs écailles orientées vers l’arrière l’aident à saisir les poissons, proies vivantes et glissantes qui représentent l’essentiel de sa nourriture.
Ce sont généralement des carpes, des tanches, des brochets, des brèmes, des goujons et des mulets dans les zones littorales.
Mâles et femelles se ressemblent si ce n’est que la femelle est un peu plus grande que le mâle.
Leur espérance de vie est de 25 ans et les couples se forment pour la vie.
Installé sur un arbre, le nid est constitué d’un énorme amas de branchages garni d’herbe, d’écorces et de végétaux divers.
Fin avril, la femelle pond 2 à 3 œufs en moyenne, de la taille de ceux d’une poule, la couvaison durant généralement 5 semaines.
Les petits sont capables de prendre leur envol au bout de 8 semaines.
On trouve des balbuzards près des lacs d’eau douce et parfois près d’eaux côtières saumâtres, un peu partout dans le monde, excepté aux pôles.
Ils migrent durant les saisons d’hiver,
- ceux d’Europe allant en Afrique du Nord où en Espagne,
- ceux du Canada et des Etats-Unis dans les Etats méridionaux comme la Floride ou la Californie.
Ceux d’Australie ou des Caraïbes ne migrent pas.
Le Balbuzard est parfois utilisé comme emblème :
- c’est l’oiseau officiel de la Nouvelle-Ecosse au Canada,
- c’est également l’emblème de Sudermanie en Suède,
- c’est aussi celui de l’équipe de football américain de Seattle et de l’université de Caroline du Nord à Wilmington.
Dans les années 1950-1970, le balbuzard a été menacé d’extinction en raison principalement de l’usage du DDT fragilisant les œufs et de la persécution de cette espèce considérée, durant un temps, comme nuisible.
En France, il ne restait plus que 3 couples réfugiés en Corse.
Depuis l’interdiction du DDT durant les années 1970 et suite à une campagne de réimplantation dans le département du Loiret, le balbuzard est en train de reconstituer lentement ses populations.
Ses noyaux de population sont à présent suivis par « la Ligue pour la protection des oiseaux ».
On dénombre actuellement :
- 20 couples en région Centre-Val de Loire,
- 25 couples en Corse.
Le Balbuzard pêcheur bénéficie d'une protection totale sur le territoire français depuis l'arrêté ministériel du 17 avril 1981 relatif aux oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire.
Il est inscrit à l'annexe I de « la directive Oiseaux de l'Union européenne ».

Un timbre sur le thème de la protection de la nature.


Valeur faciale du timbre 1,00 Francs
Dessiné et gravé par Jacques Jubert
Référence catalogue Yvert et Tellier n°2039
L’Abeille du genre « Apis Mellifica » est la plus connue parmi plus de 20 000 espèces d’abeilles répertoriées sur la planète.
Sociale, elle peut être élevée dans des ruches pour la pollinisation des cultures et la production de miel.
Nettement distinctes des guêpes par leur morphologie, leur comportement et leur alimentation, elles constituent leurs réserves alimentaires en récoltant le nectar et le pollen des fleurs qu’elles butinent.
Ce faisant, comme d’autres insectes, elles assurent la pollinisation, c'est-à-dire le transport du pollen permettant la reproduction des plantes.
Dans les ruches construites et mises à sa disposition par l’homme, les abeilles domestiques transforment la plus grande partie de leur récolte,
- en une substance appelée miel, base de leur nourriture, qu’elles obtiennent en abaissant la teneur en eau du nectar,
- en une sécrétion de cire avec laquelle elles bâtissent des alvéoles dans lesquelles sont stockés miel, pollen ainsi que les couvains abritant les œufs pondus par leur reine, leurs larves et leurs nymphes,
- en gelée royale, substance blanchâtre secrétée par des abeilles ouvrières, entre le cinquième et le quatorzième jour de leur existence et dont le rôle est de nourrir :
o toutes les larves durant les trois premiers jours de leur existence,
o les larves sélectionnées pour devenir reines jusqu’au cinquième jour de leur existence,
o la reine de la colonie, durant toute la durée de son existence.
Les substances produites par les abeilles, cire, miel, gelée royale et même leur venin, ont depuis toujours la réputation d’être utiles au maintien de la santé humaine.
Socialement, les abeilles sont constituées en essaims regroupés autour d’une reine, pilier central de la reproduction de la colonie.
Cette reine, dont l’espérance de vie est de 3 à 4 ans, est nettement plus grande que les abeilles ouvrières.
Elle est capable de pondre, au printemps, plus de 20 000 œufs par jour.
Elle ne sort pratiquement jamais de la ruche.
Les ouvrières sont les autres femelles de la colonie.
D’une taille de 10 à 15 mm pour un poids allant de 60 à 80 milligrammes, elles possèdent, en extrémité de leur abdomen, un dard dentelé, instrument de défense qu’elles sont contraintes d’abandonner, après piqûre, dans la plaie qu’elles ont provoquée, avec une partie de leurs organes, ce qui entraine inévitablement leur mort.
Elles ont chacune une fonction bien définie :
- les butineuses effectuent la récolte du pollen et du nectar,
- d’autres surveillent le bon développement des larves et s’occupent de l’entretien de la reine,
- Certaines, placées à l’entrée de la ruche, assurent sa sécurité et sa ventilation en cas de fortes chaleurs.
Il existe enfin une dernière catégorie d’occupants de la ruche, ce sont les abeilles mâles ou faux-bourdons.
Générés par la reine à partir d’œufs non fécondés, ils n’ont d’autre fonction que d’assurer la fertilisation des reines qui ne s’accouplent qu’une seule fois durant toute leur existence, durant leur vol nuptial.
Considérés par les ouvrières comme une charge inutile une fois leur unique mission accomplie, ils sont généralement expulsés de la ruche à l’entrée de l’hiver.
Le vol nuptial des reines a lieu généralement au printemps, par beau temps et à une température d’au moins 17 degrés.
Durant ce vol, elle s’accouple avec différents faux-bourdons jusqu’à ce que sa spermathèque étant pleine, elle regagne la ruche.
Il arrive qu’une vieille reine quitte la ruche pour laisser place à une jeune reine en emportant avec elle à peu près la moitié de la population de la colonie.
Elle forme alors un essaim qui partira à la recherche d’un site propice à l’installation d’une nouvelle colonie.
Les abeilles, comme d’ailleurs beaucoup d’autres espèces de pollinisateurs, sont gravement menacées par le changement climatique, l’usage des pesticides, la monoculture, la culture intensive entrainant la destruction des habitats qui leur sont habituellement propices.
Elles sont également dangereusement mises en péril par la survenue récente en Europe d’un prédateur redoutable dont elles sont une des proies principales, le frelon asiatique ou frelon à pattes jaunes, sorte de grosse guêpe d’environ 2 cm de longueur.
Cet insecte a envahi, en quelques années, pratiquement toute la France et la majorité des pays européens.
Se nourrissant de fruits mûrs et de nectar, il capture des insectes et notamment les abeilles afin de nourrir ses larves.
Il peut s’emparer de 25 à 50 abeilles par jour en se postant en vol stationnaire à proximité de l’entrée des ruches.
Représentative de l’harmonie sociale, l’abeille a été utilisée symboliquement depuis l’Antiquité :
- en Egypte c’est un emblème pharaonique,
- le Coran comporte un chapitre nommé Les Abeilles,
- pour les Mérovingiens, l’abeille était synonyme de résurrection et d’immortalité,
- c’était le nom donné au 15ème jour du mois de germinal dans le calendrier républicain,
- Napoléon a remplacé par l’abeille les fleurs de lys des armoiries royales.
Commentaires