22 - Denis-Auguste Affre - 1793/1848
- JF
- 20 juil.
- 3 min de lecture
Dernière mise à jour : 21 juil.


Denis-Auguste Affre dit Monseigneur Affre, fils d’une famille de bourgeois du Rouergue, entre au séminaire à 14 ans et deviendra le 126 ème archevêque de Paris.
Farouche défenseur de la liberté de l’enseignement, on lui doit la création de l’école des Carmes et de l’école de théologie de la Sorbonne.
Durant l’insurrection de juin 1848, il tente de ramener la paix en montant sur les barricades.
Blessé par une balle perdue et ramené à son domicile, il meurt le 27 juin vers 4h30 du matin âgé de 55 ans.

Emission d’un timbre par la poste française en 1948
Référence catalogue Yvert et Tellier n°802
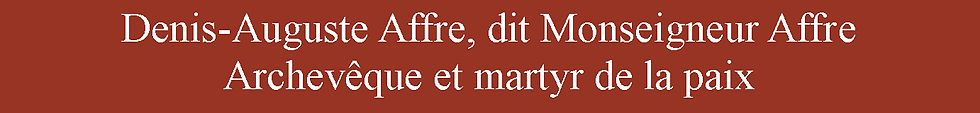
En 1870, Jacques Affre, oncle de Denys Affre, achète en 1770 la seigneurie de Saint-Rome-de-Tarn en Rouergue et, ce faisant, la famille, qui est celle de Monseigneur Affre, anoblie par le souverain pontife après la disparition des États du pape, devient partie intégrante de la noblesse pontificale.
Il entre à quatorze ans au séminaire de Saint-Sulpice, situé à l’époque place Saint-Sulpice à Paris, et après de brillantes études et un poste de professeur de philosophie au séminaire de Nantes, il est ordonné prêtre le 16 mai 1818.
Après avoir successivement été vicaire général des diocèses de Luçon et d’Amiens, il devient vicaire capitulaire de Paris, et enfin, le 5 aout 1840, il est sacré archevêque, à quarante-sept ans, sous les voutes prestigieuses de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Fort de cette dignité et du pouvoir qu’elle confère, Monseigneur Affre va peser de tout son poids pour l’amélioration des études ecclésiastiques et pour le droit de créer des établissements d’enseignement privé, confessionnels ou non, et que tout élève, de quelque origine qu’il soit, aurait librement le droit de fréquenter. C’est à lui que l’on doit la création de l’école des Carmes et de l’école de théologie de la Sorbonne.
Il se signale également par son souci d’évangélisation des basses couches de la société, en ouvrant de très nombreuses paroisses ouvrières.
Pourtant, alors que l’ensemble de son œuvre suffirait largement a assurer sa notoriété aux yeux de l’Histoire, c’est surtout à la fin de sa vie et aux conditions exceptionnelles de sa mort que l’on doit la grandeur de son souvenir.
Nous sommes en juin 1848.
Exaspérés par la fermeture des Ateliers Nationaux les ouvriers parisiens, réduits au chômage, se révoltent.
C’est la « révolution de 1848 » qui, du 22 au 26 juin pousse des milliers de travailleurs à envahir les rues.
Des barricades sont levées, notamment à l’entrée du Faubourg Saint-Antoine et de violents échanges de coups de feu ont lieu entre la Garde Nationale et les insurgés.
Convaincu que sa présence serait susceptible de ramener la paix et malgré les mises en garde du général Louis-Eugène Cavaignac à qui il rétorque courageusement « Ma vie a peu de valeur, je la risquerai volontiers », les tirs ayant cessé, il monte sur la barricade en brandissant une branche verte en signe de paix, accompagné d’un garde national costumé en ouvrier et d’un de ses domestiques, Pierre Sellier, qui lui était particulièrement dévoué.
Le premier instant de stupéfaction passé, malgré les quelques mots qu’il réussit à prononcer, un premier coup de feu déclenche à nouveau la fusillade et une balle, qu’on prétend perdue, l’atteint.
Transporté aussitôt au presbytère de Saint-Antoine, il est transféré le lendemain à l’hôtel Chenizot, sa résidence 51 rue Saint-Louis-en-l’Ile.
Malgré les soins qui lui sont prodigués, il rend le dernier soupir dans la nuit du 27 juin à l’âge de 55 ans.
On rapporte que ses derniers mots furent : « Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis, que mon sang soit le dernier versé. »
L’assemblée nationale lui a rendu hommage le lendemain en ces termes : « L'Assemblée nationale regarde comme un devoir de proclamer sa religieuse reconnaissance et sa profonde douleur pour le dévouement et la mort saintement héroïque de Monseigneur l'archevêque de Paris. »
Ses obsèques officielles rassemblèrent 200 000 personnes.
Son cœur fut placé dans une urne et gardé dans la chapelle des Carmes, de nos jours église Saint-Joseph-des-Carmes, située 70 rue de Vaugirard dans le 6ème arrondissement de Paris au sein de l'Institut catholique de Paris et du séminaire des Carmes.
La Poste française a émis, en 1948, un timbre à son effigie pour l’anniversaire de la révolution de 1848. Ce timbre, dessiné par Paul-Pierre Lemagny, a été gravé par Emile Feltesse, graveur dont La Poste a utilisé les services à de très nombreuses reprises à cette époque.
Commentaires