Recueil des Célébrités 01 à 10
- JF
- 19 févr. 2025
- 45 min de lecture
Dernière mise à jour : 7 nov. 2025



Tout philatéliste qui feuillette cette bible du collectionneur qu’est le catalogue Yvert et Tellier, ne peut qu’être frappé par la place considérable qu’occupent ces petites vignettes colorées qui ornent les enveloppes de lettres et qui font référence aux hommes et femmes qui ont animé et fait l’histoire de France.
Grands personnages d’état, politiques, rois et reines, monarchistes ou révolutionnaires, ils ont dirigé et fondé ce pays.
Grands militaires, officiers, soldats ou obscurs résistants, ils l’ont protégé des agressions multiples dont, au fil des siècles, il a été l’objet.
Chercheurs, savants et ingénieurs dans toutes branches et disciplines, ils ont contribué à bâtir ce monde moderne dans lequel nous vivons.
Poètes, écrivains, peintres ou sculpteurs, ils ont fait de ce pays une vitrine mondiale de l’art et de la culture.
En 1848, Etienne-François Arago, nommé directeur des postes par le gouvernement provisoire formé après l’abdication de Louis-Philippe, décide de la mise en place et de l’usage du timbre poste.
Depuis lors, la Poste française n’a jamais cessé d’émettre, année après année, des timbres d’usage obligatoire pour toute expédition de courrier et permettant de financer les services nécessaires à la gestion et l’acheminement des missives et correspondances de chacun d’entre nous.
Entre cinquante et soixante timbres sont émis chaque année qui font le bonheur des collectionneurs et parmi eux, très régulièrement, des personnages illustres de notre pays sont honorés par une vignette à leur effigie ou à celle d’une œuvre qui les a rendus célèbres.
Ce sont ces héros et héroïnes françaises, que la Poste a sélectionnés, auxquels je dédie cet inventaire de quelques pages évoquant chacun d’entre eux.
Dans ces recherches qui puisent dans le catalogue de France Yvert et Tellier, je me suis largement appuyé sur les fiches encyclopédiques du site internet Wikipédia, les ouvrages des éditions Larousse et les diverses images, textes et biographies glanés sur internet.
Collectionneur mais non historien et les informations glanées sur le « net » n’étant pas toujours parfaitement fiables, malgré les multiples recoupements et contrôles que j’ai pu effectuer, des erreurs ou inexactitudes se sont peut-être glissées dans les pages que j’ai rédigées. Si tel est le cas, merci de me le faire savoir afin que je puisse rectifier dans les éditions suivantes.


Adam de la Halle, dit le Bossu d’Arras, est un trouvère de langue picarde qui naquit et vécut au XIIIème siècle. Poète et compositeur, il s’intéresse aussi bien à l'histoire de la littérature qu’à celle de la musique .
Il est l'auteur des deux premières pièces de théâtre profanes françaises conservées : le Jeu de la Feuillée et le Jeu de Robin et Marion.
Il accompagne à Naples le Comte d’Artois et c’est là qu’il meurt entre 1286 et 1288.
Il est considéré comme le dernier des grands troubadours.

Emission d’un timbre par la poste française en 1985
Référence catalogue Yvert et Tellier n°2366

Au début du Moyen-Âge, un mouvement poétique et musical prend naissance dans le sud de la France à l’initiative de ceux qu’en Provence on nomme les « trobadors ».
Venus du nord, les trouvères continuent l’œuvre initiée par les troubadours.
Se déplaçant de châteaux en châteaux, ils animent les veillées, faisant résonner dans les murs de ces sombres demeures l’écho de leurs musiques, de leurs danses et de leurs chants.
Ils sont de toutes origines, certains sont des seigneurs parfois de haute lignée, d’autres sont des bourgeois, des clercs et même des humbles.
Tous ont en commun la volonté de célébrer l’amour, la nature, l’histoire et les métiers de leur époque.
Adam de la Halle est l’un d’entre eux.
Il est le fils d’un certain maître Henri le Bossu, employé à l’échevinage d’Arras, un échevinage étant une juridiction composée de juges professionnels et non professionnels, choisis en fonction de leurs compétences.
Il nait dans cette ville, y grandit et, le moment venu, débute des études à l’abbaye cistercienne de Vaucelles, au nord de la France, à proximité de Cambrai.
De retour à Arras, il épouse Maroie, ancien nom de Marie, sa femme lui ayant, tout au long de sa vie, inspiré, dit-on, ses poèmes d’amour.
En effet, manifestant très tôt une vocation pour la poésie, la musique et la composition, il poursuit des études à l’Université de Paris, vers 1262 ou 1275, et aurait obtenu le titre de « maître des arts ».
Compositeur prolixe, sous le nom d’Adam de la Halle, refusant le qualificatif de Bossu qui sous-tend une tare physique qui ne l’affecte pas, il est l’auteur de deux remarquables pièces profanes, mais aussi trente-six chansons, quatorze rondeaux, un congé, dix-huit jeux-partis, une ballade, sept motets, et le poème du « Roi de Sicile ».
La première de ces deux pièces, baptisée « Le jeu de la Feuillée » ou « Le jeu d’Adam », est une pièce satirique, dans la mesure où le poète, après s'être présenté, décrit son père puis les citoyens d'Arras avec leurs particularités et leurs défauts.
La deuxième est « Le jeu de Robin et Marion », une « pastourelle », genre poétique du Moyen-Âge ou un chevalier cherche à séduire une bergère.
C’est une pièce d’une rare habileté, alternant les dialogues avec les chants et les danses, qui se termine par un divertissement rustique et un repas sur l’herbe.
Cette pièce est considérée comme le premier opéra comique ou divertissement de cour où Molière et Lully devaient exceller quatre siècles plus tard.
Le manuscrit du « jeu de Robin et Marion » est conservé à la bibliothèque Méjanes - Cité du Livre – 8/10 rue Allumettes 13090 Aix-en-Provence.
Une interprétation remarquable de cette pièce par l’ensemble « Micrologus » peut être vue et écoutée sur le site internet
Vers 1262, il entre au service du comte Robert II d’Artois, corégent du royaume de Naples.
Il accompagne ce dernier, compose et produit à la cour du comte une grande partie de ses œuvres.
Il y restera jusqu’en 1285 ou 1288, époque à laquelle il meurt, la date exacte de son décès n’étant pas connue, au point que certaines théories hasardeuses le font mourir vers 1306, après son retour à Arras et un hypothétique voyage en Angleterre.
Il est vrai qu’il n’existe que très peu de documents relatant de façon précise la vie de ce trouvère.
Les manuscrits de ses œuvres, dont la plupart nous sont parvenus, sont les principales sources d’informations sur celui que l’Histoire qualifiera de dernier des grands troubadours.
Reconnaissant en lui une figure marquante de la littérature, de la musique et des arts, la Poste Française émettra un timbre à son effigie en 1979, dessiné et gravé par Joseph Rajewicz.


Pierre Abélard ou Pierre Abailard est un théologien qui abandonna son héritage pour étudier la philosophie et la logique. Etudiant particulièrement brillant, il fut souvent en conflit avec ses enseignants, certain qu’il était de son propre talent.
Enseignant à Paris, il devint précepteur et séduisit la jeune Héloïse, nièce du chanoine Fulbert de la cathédrale Saint-Sulpice.
Mariés secrètement, Fulbert poursuit sa nièce de sa vindicte et Abélard, pour la protéger, la fait entrer au couvent d’Argenteuil. Convaincu que le mari d’Héloïse n’agit ainsi que pour s’en débarrasser, le chanoine décide de se venger et fait émasculer Abélard.
Malgré cette infirmité, l’histoire d’amour d’Héloïse et Abélard perdurera jusqu’à leur mort, forgeant ainsi leur légende.
Leurs restes sont pour toujours réunis au « Père-Lachaise »

Emission d’un timbre par la poste française en 1979
Référence catalogue Yvert et Tellier n°2031

Fils d’un modeste chevalier de la cour d’Aquitaine, Pierre Abelard sera à l’époque l’un des philosophes dialecticiens et théologiens parmi les plus renommés de tout l’Occident.
Dès l’âge de onze ans, il intègre l’Ecole de Chartres pour suivre le « trivium », discipline regroupant la grammaire, la rhétorique et la dialectique, trois des sept arts libéraux de l’enseignement médiéval.
Etudiant brillant et sûr de ses connaissances, il côtoie de nombreux maitres ou auteurs influents et, à vingt et un ans, il n’hésite pas à humilier publiquement Guillaume de Champeaux, écolâtre, c'est-à-dire maître de l’école de la cathédrale Notre-Dame de Paris, lors d’une dispute théologique.
Ce conflit opposera les deux hommes jusqu’à leur mort et les entrainera dans une lutte de pouvoir acharnée avec leurs soutiens respectifs.
Devenu maître à son tour, son enseignement attire les foules et, au bout de deux ans, sa renommée dans le monde des intellectuels est telle qu’il peut à présent prétendre aux postes les plus prestigieux.
Se mêlant à la jeunesse parisienne effervescente, fuyant le destin guerrier de la noblesse, il réinvente le monde.
Jeune chevalier au physique avenant, il fait vœu de célibat, bien décidé à ne pas encombrer sa carrière par le mariage et la paternité.
Pourtant, un beau jour de 1113, ce beau trentenaire, enseignant charismatique suivi par une foule d’étudiants, croise et remarque une rare apparition dans le cloitre de la cathédrale de Paris.
C’est une jeune femme poursuivant des études de théologie, unique et brillante étudiante dans un cursus habituellement réservé aux garçons.
Héloïse est son nom.
Enfant illégitime de la plus haute noblesse, elle a pour oncle et tuteur Fulbert, le chanoine de la cathédrale Saint-Etienne.
Dans le but de la séduire en l’ajoutant à la longue liste de ses conquêtes féminines, il prend pension chez Fulbert qui voit en lui un précepteur de talent pour sa nièce.
C’est compter sans les pièges tendus par Cupidon.
En effet, de façon tout à fait inattendue, Abélard tombe éperdument amoureux d’Héloïse, laquelle lui rend sans compter un amour passionné.
Devenue sa maitresse, ils échangent des lettres enflammées qu’Héloïse recopie et conserve soigneusement.
Ces lettres retrouvées trois siècles et demi plus tard seront publiées anonymement sous le titre « Lettres de deux amants » et contribueront à forger la légende de cet amour unique, immense et malheureux.
Malheureux en effet, car le scandale éclate après que Fulbert ait découvert les deux amants enlacés « comme Mars et Vénus » et qu’Héloïse révèle à Abélard qu’elle est enceinte.
Pour la mettre à l’abri de la vindicte de son oncle, ce dernier l’envoie dans sa famille, en Bretagne, où elle accouche d’un fils baptisé Astralabe.
Tenace Fulbert veut obtenir réparation de l’affront qu’il considère avoir subi et exige, malgré les protestations d’Héloïse, qu’Abélard l’épouse, ce qu’il accepte.
Ils rentrent alors tous deux à Paris, laissant l’enfant chez Denise, la sœur d’Abélard.
Afin de préserver la carrière d'enseignant d'Abélard pour qui, à l’époque, la loi impose le célibat, cette union a lieu en présence de peu de témoins et ne doit pas être rendue publique, condition que le chanoine Fulbert s’empresse de transgresser en révélant le mariage au grand jour.
Pour la protéger à nouveau de son oncle, Abélard place Héloïse au couvent d’Argenteuil et Fulbert, accusant Abélard de vouloir, ce faisant, répudier sa femme, décide de le punir.
Il paie des hommes de main qui, s’introduisant dans sa chambre alors qu’il est endormi, l’émasculent, provoquant un énorme scandale, ce type de punition étant habituellement réservé aux adultères et aux violeurs.
Les deux malfrats poursuivis et repris subiront la loi du Talion.
Ils seront émasculés à leur tour et, de surcroit, on leur crèvera les yeux.
Quant à Fulbert, il est suspendu de ses fonctions de chanoine pendant deux ans, peine bien légère pour l’instigateur d’un crime aussi odieux.
Considéré comme imparfait de corps du fait de cette mutilation, Abélard voit sa carrière ecclésiastique brutalement interrompue ainsi que ses fonctions d’enseignant.
Héloïse prend le voile à Argenteuil et Abélard devient moine à l’abbaye de Saint-Denis.
Cette retraite ne nuit en rien à son succès dans l’enseignement de la théologie et de la dialectique. Il est à nouveau entouré d’une foule d’étudiants.
C’est alors que, très imprudemment, il réfute les théories d’un de ses anciens maîtres, Roscelin de Compiègne qui, outragé, réclame une « disputatio », confrontation publique dont sort vainqueur celui qui a la « claque » la plus bruyante.
Et là, l’histoire devient sordide.
Son adversaire fait courir le bruit que Pierre entretient sa femme grâce à ses honoraires d’enseignant, mêlant ce faisant conditions monastique et maritale.
Héloïse est tout à la fois présentée comme une victime et une « fille de joie ».
Ces démarches sont tellement outrancières qu’il n’est pas donné suite à la demande de Roscelin et que la « disputatio » n’a pas lieu.
Il est pourtant loin d’en avoir terminé avec les remous et les contestations violentes que provoquent ses théories et ses écrits.
Jusqu’à la fin de sa vie, son existence ne sera qu’une suite d’attaques violentes à l’instigation de ses ennemis de toujours, Guillaume de Champeaux, Bernard de Clairvaux, Guillaume de Saint-Thierry et de leurs sympathisants.
De « disputatio » en « disputatio », toujours condamné et même victime d’une tentative d’assassinat alors qu’il a été nommé abbé de Saint-Denis de Rhuys, il réussit toujours à échapper aux sanctions ou menaces exercées contre lui et, chaque fois il rebondit, son aura grandissant d’autant plus qu’on le persécute.
Il entreprend de rédiger un ouvrage qui aura un retentissement remarquable et, cinq-cents ans avant Calvin, il invite chacun à se référer directement aux textes et non pas seulement à la parole de prédicateurs ou d'évêques trop souvent incultes.
En 1136, son ami Etienne de Garlande, à nouveau doyen de l’abbaye de Saint-Geneviève, le rappelle et l’école de rhétorique et de théologie reprend vie comme vingt-six ans plus tôt.
Le succès est tel qu’Abélard passe dès lors pour l'un des philosophes les plus importants de sa génération.
Avec son épouse Héloïse, chassée du monastère d’Argenteuil, ils fondent l’abbaye féminine bénédictine du Paraclet, plus simplement désignée sous le terme de Paraclet et construite autour d’un oratoire préexistant, fondé par Abélard en 1122 avec l’aide de Thibaud de Champagne et dédié à Saint-Denis.
Pour finir, une nouvelle et dernière « disputatio » ayant lieu au concile de Sens en 1140, Bernard de Clairvaux, toujours lui, obtient qu’une condamnation soit prononcée contre Abélard par les évêques, réunis à huis clos pour un banquet.
De surcroît il exige sans débat la « repentance » du condamné, le menaçant du bûcher en cas de refus.
Ce dernier intelligemment refuse d’argumenter et déclare qu’il conteste la procédure et veut faire appel.
Puis, profitant des remous provoqués par la foule, il réussit à s’échapper.
Le scandale est proportionnel à la notoriété de l’accusé et, devant les risques de clivage de l’Eglise et malgré ses protestations de bonne foi, un « rescrit », signé du pape Innocent II, confirme la condamnation d’Abélard le 18 juillet 1841.
Se rendant à Rome pour faire appel de cette condamnation, le philosophe, vieilli et fatigué, présentant des premiers symptômes de sénilité, fait étape au prieuré de Saint-Marcel près de Chalon-sur-Saône.
Et c’est là qu’il s’éteint, au terme d’une vie incroyablement mouvementée, le vingt et un avril 1142, âgé de soixante-deux ou soixante-trois ans.
Durant toutes ces années, bien que platonique par la force des choses, l’amour d’Héloïse pour Abélard et d’Abélard pour Héloïse a perduré.
Outre la richesse des traces que ce grand philosophe laisse dans l’histoire de l’église, la vie malheureuse du couple a ému et alimenté des générations de romantiques qui, encore aujourd’hui, peuvent se recueillir devant le mausolée des amants au cimetière du Père Lachaise.
C’est là qu’après de multiples transferts, leurs cendres ont été réunies pour, il faut l’espérer, une ultime demeure.
En 1979, la Poste Française honorera sa mémoire en émettant un timbre à son effigie, l’enveloppe du 1er jour évoquant également le couple formé avec Héloïse.
Ce timbre a été dessiné et gravé par Cécile Guillaume.


Anne de France dite Anne de Beaujeu est la fille aînée du roi Louis XI.
Malgré les tentatives de Louis d’Orléans pour obtenir la régence, elle sera jusqu’en 1491, régente de son frère Charles VIII, futur roi de France.
Considérée comme une des femmes les plus puissantes d’Europe, elle fut surnommée, durant cette régence, « Madame la Grande ».
Instigatrice de l’union de son frère avec Anne de Bretagne, son rôle sera déterminant pour la réunion à terme de la Bretagne à la France.
Son frère ayant atteint sa majorité, elle sera progressivement éloignée du pouvoir par sa belle-sœur, Anne de Bretagne.
Elle se retire dans ses terres dans la région de Moulins où elle tiendra une des cours les plus fastueuses du royaume.
Elle décèdera le 14 novembre 1522 à Chantelle dans l’Allier

Émission de deux timbres, uniquement en feuillet, par la poste française en 2017
Références catalogue Yvert et Tellier n°F5161

Elle est la fille aînée du roi Louis XI et de Charlotte de Savoie qui ont eu deux autres enfants, Jeanne, appelée également « Jeanne la boiteuse » qui fut brièvement reine de France en tant que première épouse de Louis XII et Charles, futur roi de France sous le nom de Charles III.
D’abord fiancée en bas âge au jeune Nicolas de Lorraine, marquis de Pont-à-Mousson, à la mort de ce dernier, elle épouse à douze ans Pierre de Beaujeu, de vingt-trois ans son aîné, sire de Beaujeu et frère cadet du duc Jean II de Bourbon.
A la mort de Louis XI, selon les dernières volontés de ce dernier, elle est chargée, avec son époux Pierre II, d’assurer la régence durant la minorité royale de son frère, le dauphin Charles VIII qui n’a que douze ans, la majorité étant fixée à l’époque à quatorze ans.
Cette période est particulièrement mouvementée.
Dès la mort de Louis XII, Anne et son époux, retranchés dans la forteresse d’Amboise avec le Dauphin et deux cents archers de la garde royale, s’apprêtent à faire face aux attaques du duc d’Orléans qui considère Anne et Pierre de Beaujeu comme des usurpateurs d’un pouvoir qui devrait lui revenir.
Chaque tentative de rébellion étant déjouée par Anne qui se révèle particulièrement habile en flattant les grands seigneurs et en récompensant les institutions fidèles à la royauté.
Exaspéré, le duc d’Orléans forme une coalition en faisant appel au duc de Bretagne François II, à l’empereur Maximilien Ier et au roi d’Angleterre Henri VII et, là encore, l’habileté d’Anne de France parvient à étouffer la rébellion, le duc d’Orléans étant emprisonné.
Mettant fin à « la guerre folle », après la reddition des grands princes bretons, elle fait signer « le traité du Vergers » le 19 août 1488, dans lequel il est stipulé que l’héritière du duché de Bretagne ne peut se marier sans l’accord du roi de France.
A la mort de François II, duc de Bretagne, Anne de France organise le mariage de Charles VIII avec Anne de Bretagne.
En effet, le mariage de cette dernière avec Maximilien 1er avait été annulé faute d’avoir été consommé.
Il avait, d’autre part, été conclu sans que les stipulations du « traité du Verger » soient respectées, le roi de France n’ayant pas été préalablement consulté.
Ce mariage parachève l’œuvre de son père Louis XI en rattachant par cette union le duché de Bretagne au domaine royal.
Elle est alors considérée comme l'une des femmes les plus puissantes d'Europe et est surnommée « Madame la Grande ».
Outre ses fonctions de régente, Anne supervise l’éducation de nombreux enfants de l'aristocratie de l’époque, dont Diane de Poitiers et Louise de Savoie.
Elle soutient Henri Tudor contre le roi Richard III d’Angleterre lors de la « Guerre des Deux Roses » contribuant ainsi à permettre à Henri Tudor de devenir roi d’Angleterre sous le nom d’Henri VII.
Après le mariage de Charles VIII, elle est progressivement éloignée du pouvoir par sa belle-sœur Anne de Bretagne qui lui en veut d’avoir mis fin à l’indépendance du duché de Bretagne.
Elle se retire alors dans la région de Moulins, son époux et elle étant devenus duc et duchesse du Bourbonnais en 1488.
Elle reçoit ce faisant un château qu’elle transforme en un palais luxueux en le faisant agrandir par une nouvelle aile de soixante-dix mètres de long, dans un pur style gothique flamboyant, terminée par une chapelle dédiée à saint Louis.
Elle métamorphose complètement les anciens jardins médiévaux qu’elle agrémente d’une immense volière peuplée de serins, oiseaux chanteurs dont raffolait son père.
C’est là qu’elle tient alors une des cours les plus fastueuses du royaume et qu’elle crée et anime un des plus importants foyers littéraires et artistiques.
Elle protège de nombreux auteurs, peintres, sculpteurs, architectes et maîtres verriers qui réaliseront les vitraux de la collégiale de Moulins.
C’est à Anne que l’on doit également une œuvre majeure de l’histoire de l’art, « le triptyque du maitre de Moulins », représentant une vierge en gloire entourée de Pierre II de Bourbon, de son épouse et de leur fille Suzanne.
Cette huile sur bois est considérée comme l’aboutissement de la peinture du Moyen-Âge dans toute sa perfection.
L’identité de ce mystérieux peintre, « Maître Jehan le peintre » et surnommé « le Maître de Moulins », n’a jamais pu être établie avec certitude.
Longtemps dissimulé au sein de la cathédrale Notre-Dame-de-l'Annonciation à Moulins, le triptyque y est aujourd'hui exposé dans un encadrement de bois doré.

Anne de France décèdera à 61 ans, le 14 novembre 1522 à Chantelle, dans l’Allier.
Elle était la dernière représentante des Valois.
En 2017, la poste française émettra deux timbres uniquement en feuillet, référence Yvert et Tellier n°F5561



Armoiries de Bayard
Document extrait
de l’armorial des rues de Paris
Portrait extrait du site wikipedia
Pierre du Terrail, seigneur de Bayard, connu sous le nom de chevalier Bayard, est un noble dauphinois qui s’illustra notamment dans les guerres d’Italie, d’abord sous Charles VIII puis sous Louis XII
et enfin sous François 1er, qui le nomme lieutenant général du Dauphiné.
et Il devient l’un des plus proches compagnons d’arme du Roi au point, dit la légende, mais est-ce vraiment une légende,
de se faire adouber par lui, sur le champ de bataille de Marignan par le compagnon qu’il considérait comme « celui qui réalisait le mieux, aux yeux de tous l’idéal de courage et loyauté ».
En tant que lieutenant général du Dauphiné, Bayard prend très à cœur sa gouvernance, luttant contre la peste, les inondations et les brigands, nettoyant les rues de Grenoble et construisant des digues pour détourner le Drac.
Toutefois, en 1523 François 1er le rappelle à ses cotés pour combattre les troupes italiennes et c’est alors qu’il est mortellement blessé par un coup d’escopette.
Ses restes présumés sont inhumés dans la collégiale Saint André de Grenoble.



La Poste française a émis deux timbres en mémoire du chevalier, le premier à l’effigie de Bayard en 1943, référencé sous le n°590, le second en 1969 le représentant à la bataille de Brescia référencé sous le n°1617
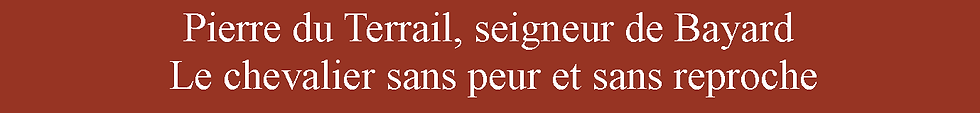
Il est le fils d'Aymon, seigneur de Bayard, et d'Hélène Alleman de Laval, sœur de l'évêque de Grenoble Laurent Alleman.
Quoique nobles, ou notaires portant l'épée, les Terrail ne peuvent mener grand train, leur domaine se limitant en effet à vingt-huit journaux, soit l'équivalent de sept hectares sur lequel s’élève une simple maison-forte construite au début du XVe siècle par l'arrière-grand-père de Bayard, Pierre du Terrail premier du nom.
Dans ce contexte, Bayard doit mener une vie ascétique, au sein de cette grande famille.
A Grenoble, commençant de modestes études, il apprend à écrire.
En février 1486, âgé de 11 ans, il obtient, grâce à la générosité de son oncle Laurent Alleman, frère de sa mère Hélène et évêque de Grenoble, une place de page à la cour de Charles Ier, duc de Savoie et il part à Turin faire son apprentissage des armes.
Il termine ses études militaires à la cour de France et à l'âge de 17 ans, il entre en qualité d'homme d'armes dans la compagnie du comte de Ligny.
C’est là qu’il commence à montrer sa bravoure devenant rapidement célèbre malgré son jeune âge, faisant « merveille d'armes » dans de nombreux affrontements liés aux guerres d'Italie, sous Charles VIII et participe à la bataille de Fornoue le 6 juillet 1495.
En 1496, à la mort de son père, Pierre prend le titre de seigneur de Bayard.
Cavalier hors pair et excellent fantassin, il sort victorieux en 1503 d’un duel l’opposant au capitaine espagnol Alonzo de Soto Mayor alors qu’il s’était déjà distingué six mois plus tot lors d’un combat d’honneur à treize contre treize contre les espagnols.
Bayard devient ainsi le héros des récits que se comptent les soldats pour distraire leur ennui.
En 1504, la retraite des troupes françaises hors du royaume de Naples est le théâtre de l'un de ses plus hauts faits d'armes.
Le Garigliano, fleuve qui se jette dans la Méditerranée au nord de Naples, sépare Français et Espagnols.
Un petit groupe d’éclaireurs est envoyé par l'armée française pour franchir le fleuve sur un pont de bateaux et averti au dernier moment, Bayard se joint à eux en simple pourpoint, sans avoir pris le temps d'enfiler sa cuirasse et son casque.
Rapidement, les trois ou quatre cents Français et Suisses ayant franchi le Garigliano sont débordés par les 1 500 hommes appuyés d'artillerie lancés contre eux et l'armée française doit battre en retraite.
Bayard, resté seul à l'arrière-garde profitant de l’étroitesse du pont, impose aux Espagnols de se présenter un à un devant lui.
Sa vaillance, son adresse et son endurance font merveille et c’est finalement l'artillerie française, mise en batterie sur la rive opposée, qui contraint les Espagnols à refluer mettant fin à la bataille.
En avril 1507, toujours sous le règne de Louis XII, il force le passage des Apennins devant Gênes et prend la ville, qui vient de se soulever.
Le 14 mai 1509, Bayard à qui le roi vient d’octroyer les fonctions de capitaine, s'illustre à la bataille d'Agnadel, victoire acquise dans un bain de sang avec 14 600 morts et qui ouvre à Louis XII les portes de Venise.
D'août à septembre de la même année alors que se déroule le siège de Padoue, Bayard qui se trouve en garnison à Vérone attaque quatre garnisons vénitiennes qui protègent la porte de Vicence.
En 1510, il tente d'enlever le pape Jules II, qui s'était retourné contre ses anciens alliés français.
En février 1512, après avoir pris Bologne, il assiège Brescia et, alors qu'il combat à pied, il y est grièvement blessé d'un coup de pique dans le haut de la jambe.
Recueilli par un gentilhomme dont il sauve la demeure du pillage et sa femme du déshonneur, vite remis, il s'illustre à nouveau, à Ravenne, lors du délicat retrait des troupes françaises.
Devenu roi le 1er janvier 1515, François Ier nomme Bayard lieutenant général du Dauphiné et lors du passage du roi à Grenoble, il doit repartir avec sa compagnie et trois mille hommes pour venir grossir l’effectif des troupes que François 1er réunit avant de partir pour l’Italie.
C’est lors de cette même année 1515 qu’a lieu la célèbre bataille de Marignan, écrasante victoire des troupes françaises au soir de laquelle on dit que François 1er voulut « prendre l’ordre de chevalerie de la main de Bayard »
C’est ainsi que le lendemain matin du jour de la bataille, le 15 septembre, devant les compagnies d’ordonnance rassemblées, le roi alors âge de vingt ans se serait fait adouber par celui qui réalisait le mieux aux yeux de tous l’idéal de courage et de loyauté des preux du Moyen-âge.
Toutefois et malgré les nombreux historiens qui évoquent l'adoubement du roi par Bayard sur le champ de bataille de Marignan, quelques auteurs et notamment Didier Le Fur dans son livre, « Marignan : 13-14 septembre 1515 », paru en 2004, considèrent cette histoire comme un mythe, qui aurait été monté à postériori « par demande royale » afin notamment de faire oublier que le connétable de Bourbon qui aurait adoubé François Ier lors de son sacre, s’était rangé en 1523 du côté de Charles Quint.
Pire, le connétable aurait été l'organisateur de la future défaite de Pavie, et donc de l'emprisonnement de François Ier.
D'autres historiens comme Robert Knecht et Nicolas Leroux ne croient pas du tout à une invention d'une hypothétique propagande royale, faisant de surcroît remarquer que, si l'on regarde les récits du sacre attentivement, le jeune roi, en fait, ne reçut pas la chevalerie du connétable de Bourbon.
En tout état de cause, même si elle est contestée, l’histoire est belle et tout à fait conforme à l’image qui est celle de cet exceptionnel et attachant personnage de l’histoire française.
De retour à Grenoble, Bayard prend très à cœur ses fonctions de lieutenant général du Dauphiné.
Trois domaines fon particulièrement l’objet de son attention :
- la peste,
- les inondations
- et les brigands.
Dans ce but, il fait nettoyer les rues de Grenoble, purger les égouts et supervise personnellement les travaux de défense contre les inondations.
Il crée également une commission chargée de surveiller, pendant ses absences fréquentes, la construction de digues pour détourner le Drac.
En 1522, alors que les consuls lui conseillent de quitter la ville, il prend des mesures contre la peste et la famine.
Les pestiférés étant regroupés dans « l'hôpital de l'Isle », en dehors des remparts de la ville, il somme trois médecins de rester pour soigner les malades.
En 1523, François Ier le rappelle à nouveau pour s’opposer à la progression des troupes italiennes et c’est alors qu’il couvre la retraite de l’armée française, le 29 avril 1524, qu’il est mortellement blessé par un coup d'escopette dans le dos lui brisant la colonne vertébrale.
Alors qu’il demande à ses compagnons de le quitter, non sans les avoir prié de l’assoir appuyé contre le tronc d’un chêne face aux troupes italiennes, il leur dit : « Je n'ai jamais tourné le dos devant l'ennemi, je ne veux pas commencer à la fin de ma vie ».
Le connétable de Bourbon, traitre au roi de France et qui poursuit les Français à la tête des troupes de Charles Quint, arrive devant Bayard et, selon Du Bellay, lui aurait dit : « Ah ! Monsieur de Bayard, que j’ai grand-pitié de vous voir en cet état, vous qui fûtes si vertueux chevalier ! », ce à quoi le mourant aurait répondu « Monsieur, il n’est besoin de pitié pour moi, car je meurs en homme de bien ; mais j’ai pitié de vous, car vous servez contre votre prince et votre patrie ! ».
Pleuré par ses ennemis, son corps est ramené en France et, après des obsèques solennelles à la cathédrale de Grenoble, il est enterré au couvent des Minimes de la commune voisine de Saint-Martin-d'Hères.
L’histoire ne s’arrête pas là et, alors que sa sépulture a été profanée durant la révolution, Louis XVIII ordonne le 4 juillet 1822 que les « restes présumés » du chevalier soient transférés dans l’église de la collégiale Saint André de Grenoble.
Restes présumés dit-on car les ossements examinés ultérieurement se révèleront être ceux d'une jeune fille.
En 1937, un passionné relance des fouilles à Saint-Martin d'Hères et trouve trois cercueils alignés, dont un abrite un officier portant une plaque distinctive.
Les restes de cet officier sont entreposés dans les années 1960 aux Archives départementales de l'Isère et depuis 2013, son descendant Jean-Christophe Parisot de Bayard a entrepris des démarches d'identification génétique du crâne supposé de Pierre Terrail.
En 2017, les résultats de cette étude de l'ADN mitochondrial du crâne auraient confirmé qu'il s'agit bien de lui mais elles ont été contestées car menées par le professeur Gérard Lucotte, un scientifique mis au ban de sa communauté scientifique, notamment parce qu'il croit à l'origine génétique des races humaines.
Bayard qui n’a jamais contracté aucune union laisse toutefois une fille naturelle prénommée Jeanne qui épousa François de Bocsozel, noble dauphinois de la région de Vienne.
La poste française émettra deux timbres en mémoire de cet illustre figure du Moyen-Age, le premier en 1943 à son effigie, dessiné et gravé par Raoul Serres est référencé aux éditions Yvert et Tellier sous le n°590, le second en 1969, le représentant à la bataille de Brescia, dessiné et gravé par Albert Decaris est référencé aux éditions Yvert et Tellier sous le n°1617.


Anne de Bretagne fut deux fois duchesse et deux fois Reine de France.
Fille de François II, duc de Bretagne, et de Margueritte de Foix, elle devient, à douze ans, duchesse de Bretagne après le décès de son père.
Son premier mariage à 13 ans avec Maximilien de Habsbourg étant rompu, faute d’avoir été consommé, elle épouse Charles VIII devenant reine de France.
Au décès accidentel de ce dernier, elle doit épouser Louis XII et devient ainsi, pour la seconde fois, reine de France le 8 janvier 1499.
Sa vie entière se déroula sur fond de conflit politique permanent, la France cherchant à se rattacher une Bretagne fermement attachée à son indépendance.
Durant ses deux mariages, elle mit au monde neuf enfants, aucun ne survécut. Épuisée par ses maternités et fausses couches, elle meurt le 3 janvier 1514.

Emission d’un timbre par la poste française en 2014
Référence catalogue Yvert et Tellier n°4834

Anne est la fille aînée du duc de Bretagne François II et de Marguerite de Foix.
Destinée de par sa naissance à devenir duchesse de Bretagne, elle devient dès son plus jeune âge l’objet d’un affrontement permanent sur l’échiquier des relations franco-bretonnes.
Dès 1481, alors qu’Anne n’a que quatre ans, son père, qui cherche à nouer des relations politiques avec le Royaume-Uni afin de trouver un appui contre le royaume de France, la promet en mariage à Edouard IV d’Angleterre, puis à Édouard, Prince de Galles et fils d’Édouard IV, ce dernier décédant peu après en 1484.
Toutes les tentatives d’alliance ayant échoué, Anne est couronnée Duchesse de Bretagne après le décès de son père en 1488.
Son autorité contestée, Anne fait appel à des troupes étrangères, anglaises, espagnoles et autrichiennes, ces dernières étant commandées par l’Archiduc d’Autriche Maximilien 1er de Habsbourg.
Un traité est signé au terme des affrontements entre Maximilien et Charles VIII, roi de France, traité qu’Anne ratifie le 3 décembre 1489.
Le 16 décembre 1481, âgée de 13 ans, la Duchesse Anne de Bretagne épouse Maximilien 1er, âgé de 31 ans, Archiduc d’Autriche, Roi des Romains et futur Empereur germanique.
Cette union, qui faisait de Maximilien le nouveau duc de Bretagne, devait assurer l’indépendance de la Bretagne vis-à-vis de la France et de l’Angleterre.
Toutefois, ce mariage s’est conclu en violation avec les termes du « traité du Verger » signé en 1488 par le Duc François II, après sa défaite contre les Français à Saint-Aubin-du-Cormier.
En effet, ce traité stipulant que la fille aînée du Duc ne pouvait se marier qu’avec le consentement du Roi de France, Charles VIII, qui n’avait pas été consulté, en prend ombrage.
Le mariage avec Maximilien est donc cassé faute d’avoir été consommé, et Charles VIII ayant de son côté rompu son alliance avec Marguerite d’Autriche, il propose à Anne de l’épouser.
Tous les contemporains s’accordent pour dire que Charles, petit comme un pygmée selon un chroniqueur, est particulièrement laid, taciturne, emporté et, semble-t-il, peu intelligent.
On comprend donc aisément les hésitations d’Anne qui accepte pourtant.
Toutefois, elle doit au préalable faire preuve qu’elle est saine de corps et n’a pas de malformation majeure.
Pour ce faire, c’est donc totalement nue qu’elle consent à se présenter devant les ducs de Bourbon et d’Orléans ainsi que madame de Bourbon et monseigneur d’Aurigny.
L’examen n’ayant permis de constater aucun défaut, si ce n’est une très légère boiterie, le mariage a lieu le 6 décembre 1491 dans la chapelle du château de Langeais.
Anne devient ainsi reine de France et elle est couronnée le 8 février 1492 à l’âge de quinze ans.
Malgré cinq maternités, aucun des enfants du couple n’ayant survécu et Charles VIII, qui meurt accidentellement le 7 avril 1498 en heurtant violemment de la tête le linteau d’une porte en se rendant dans les fossés du château d’Amboise pour y jouer à « la paume », sera donc sans descendants.
Héritière légitime du duché de Bretagne, Maximilien ayant renoncé au titre, elle redevient duchesse de Bretagne, quatre mois seulement après le décès de son royal époux.
Louis XII, successeur de Charles VIII, est marié à Jeanne de France dite « Jeanne la boiteuse », seconde fille de Louis XI.
Il est alors décidé qu’Anne épousera Louis XII dès que la répudiation de Jeanne de France sera prononcée, ce qui est obtenu le 17 décembre 1498, avec l’accord du Pape Alexandre VI.
Le contrat de mariage entre Louis XII et Anne de Bretagne est signé le 7 janvier 1499, l’union étant célébrée le lendemain dans la chapelle ducale de Nantes.
Louis XII s’est engagé contractuellement à respecter les privilèges de la Bretagne et les institutions bretonnes.
Anne devient ainsi reine de France pour la deuxième fois à l’âge de 22 ans.
Malgré quatre nouvelles maternités et plusieurs fausses couches, Anne ne parviendra pas à donner à la France un garçon viable pour la succession royale.
Louis XII décide alors, en 1505, de marier leur fille Claude avec François d’Angoulême, futur roi de France sous le nom de François 1er.
Epuisée par ses multiples grossesses, Anne de Bretagne tombe malade le 2 janvier 1514.
Elle décède sept jours après, le 9 janvier, deux semaines avant l’anniversaire de ses 37 ans, sans avoir jamais sacrifié l’indépendance de sa chère Bretagne.
Elle est ensevelie dans la basilique Saint-Denis, son cœur étant déposé provisoirement dans l’église des Chartreux de Nantes avant de rejoindre au couvent des Carmes de Nantes, le 19 mars 1514, la tombe de François II, son père.
Dernière duchesse de Bretagne et deux fois reine de France, Anne de Bretagne est avec saint Yves un des personnages historiques les plus populaires de Bretagne.
La poste française a honoré sa mémoire par l’émission d’un timbre en 2014, dessiné et gravé par Yves Beaujard et référencé aux éditions Yvert et Tellier sous le n°4834.


Jacques Amyot est un évêque français du XVIᵉ siècle. C’est l’un des traducteurs les plus renommés de la Renaissance.
Docteur en droit de l’université de Bourges et protégé de François 1er,
il se rend en Italie pour traduire les textes de Plutarque conservés au Vatican.
Nommé « grand aumônier » en 1561 puis commandeur de l’Ordre du St Esprit, Pie V le nomme évêque d’Auxerre en 1570.
Après l’assassinat du Duc de Guise, il fait partie des prêtres excommuniés pour avoir assisté à la messe du 1er janvier 1589 en compagnie d’Henri III .
Devant la fronde de son clergé, sa maison pillée, il est contraint de quitter Auxerre où il reviendra pour mourir le 6 février 1593.

Émission d’un timbre par la poste française en 1963
Référence catalogue Yvert et Tellier n°1370

Né d’une famille pauvre, Jacques Amyot parvient à se rendre à Paris pour suivre les cours du collège de Navarre, où il se met au service de riches étudiants afin de subvenir à ses besoins.
À 19 ans, en 1532, il obtient sa licence à Paris et devient maître des arts.
Poursuivant ses études à l’université de Bourges, il devient docteur en droit civil et lecteur de grec et de latin en 1537.
Par l'intermédiaire de l’aumônier de François Ier, il obtient une place de précepteur de ses neveux, puis des fils du diplomate français Guillaume Bochetel.
Il commence alors ses premières traductions avec la « Vie de Démétrius » de Plutarque.
Nommé durant dix ans professeur de latin et de grec à l'université de Bourges, il traduit le roman grec « Théagène et Chariclée » d'Héliodore, et cette traduction parue en 1547 lui vaut d'être récompensé par François Ier, qui lui octroie le bénéfice de l'abbaye de Bellozane en Seine-Maritime.
Il se rend alors en Italie pour étudier le texte de Plutarque conservé au Vatican et entreprend la traduction des « Vies parallèles des hommes illustres »
Chargé d'une mission pour le concile de Trente, rentré en France, il est nommé précepteur des fils d’Henri II en 1557.
Ces derniers, Charles IX le nommeront grand aumônier en 1561, Henri III le faisant commandeur de l'ordre de chevalerie français « l’Ordre du Saint-Esprit ».
Nommé maître de la Librairie en 1567, sous son administration, la Bibliothèque du roi est transportée de Fontainebleau à Paris, dans une maison particulière louée à cet effet.
Nommé évêque d'Auxerre par Pie V en 1570, son frère cadet Jean Amyot est désigné comme son procureur le 6 février 1570 et prend possession de l'évêché pour lui le 6 mars 1570.
Il développe des actions en faveur des populations de son diocèse, mais conserve ses fonctions à la cour auprès de Charles IX et Henri III.
Il est nommé supérieur de l'hôpital des « Quinze-Vingt » à Paris, en 1572.
En 1580, il fait publier le bréviaire en caractères romains et il fonde trois ans plus tard un collège des jésuites qui deviendra l'actuel lycée Jacques-Amyot d'Auxerre.
Présent à Blois en décembre 1588 au moment de l'assassinat du duc de Guise, et aurait conseillé à l'aumônier du roi Henri III de refuser l'absolution à l'assassin.
Il fait partie des prélats excommuniés par les résolutions de la faculté de théologie de l'université de Paris pour avoir assisté à la messe du 1er janvier 1589 en compagnie d'Henri III.
Son retour à Auxerre est difficile, perturbé par l'insubordination et les révoltes de son clergé. Sa maison est pillée et il est contraint de quitter Auxerre pendant quelque temps.
C’est pourtant à Auxerre qu’il meurt le 6 février 1593.
Son œuvre aura une influence profonde sur la langue française « ses traductions de textes anciens sont un modèle de pur langage français et contribueront à fixer la langue ».
Jacques Amyot a reçu les honneurs de la Poste Française avec l’émission d’un timbre en 1963, dessiné et gravé par Albert Decaris il est référencé aux éditions Yvert et Tellier sous le n°1370.


Étienne Delaune était appelé en son temps « Maître Étienne »
Peu connu de nos jours il était très célèbre au XVIème siècle.
Orfèvre, médailleur, dessinateur et graveur, ses estampes furent, à l’époque, collectionnées dans l’Europe entière.
Il a gravé les compositions des plus grands artistes de son temps, Rosso, Primatice, Luca Penni, Jean Cousin, Raphaël et bien d’autres.
Huguenot, il échappe de justesse aux massacres de la Saint-Barthélemy et, à la fin de sa vie, vivant à Strasbourg, il enseigne son art à d’autres graveurs devenus également célèbres, Léonard Gaultier et Johann-Théodor de Bry.
Son fils Jean fut graveur comme lui.
Il meurt à Strasbourg probablement en 1559.

Émission d’un timbre par la poste française en 2014
Référence catalogue Yvert et Tellier n°AA1011

C’est en ces termes que le critique d’art Arsène Alexandre, dans son Histoire de l'art décoratif, du XVIème siècle à nos jours, définit cet orfèvre et graveur français de la Renaissance.
Les informations biographiques sur le personnage sont d’une grande pauvreté.
Pour certains, il serait né parisien et pour d’autres orléanais, la thèse la plus probable étant développée par le docteur ès lettres Jeanne Duportal dans son livre publié en 1914, « Étude sur les livres à figures édités en France de 1601 à 1660 » dans lequel elle le fait naître à Milan.
Sa formation semble avoir été celle d'un orfèvre mais il se heurte dès le début à une réglementation drastique de cette profession soumise à une législation stricte et à une limitation du nombre de « Maitres »
Au début, « travaillant en chambre », il sera poursuivi et condamné à deux reprises, en 1545 et 1546, pour exercice illégal de la profession d’orfèvre.
En fait, il ne fut jamais reçu maître orfèvre à Paris du fait de ces règlements contraignants.
La consécration semblera enfin se profiler quand, en 1552, il entre comme graveur à la Monnaie du Moulin, atelier monétaire mis en place par Henri II.
Lors de son passage à la Monnaie, plus connu en son temps sous le nom de « Maître Étienne», il dessina une médaille éditée pour commémorer les victoires d’Henri II.
C’est son œuvre retrouvée la plus ancienne, datable d’une période située entre 1540 et 1560.
Elle est actuellement visible au musée du Louvre.
Très directement inspiré par la période dite de l'École de Fontainebleau et influencé par certains maîtres italiens comme Raphaël, il est l'auteur de plus de quatre cents gravures au burin, tantôt originales, tantôt d'interprétation.
Il avait l’habitude de signer d’un « S » son abondante production, cette lettre étant soit l’initiale de son prénom latinisé, soit signifiant « Stephanus fecit ».
Comme tout orfèvre, Delaune a appris le dessin et la gravure.
Ses premières estampes datées remontent à 1561 et il va se consacrer, plus particulièrement, à la gravure lorsque le déclenchement des Guerres de Religion mettra un terme à ses activités d'orfèvre et de médailleur.
De confession huguenote, il échappe au massacre de la Saint-Barthélemy, perdra nombre de ses proches et quittera Paris pour s'installer à Strasbourg puis à Augsbourg, ville allemande du « Land de Bavière ».
L’œuvre gravée de « Maître Etienne » est considérable et déjà recherchée à son époque.
Elle est essentiellement composée de pièces de petites tailles et de formes diverses, exécutées avec une extrême minutie.
Allégories, sujets mythologiques, sujets pieux, scènes de chasses et de combats, grotesques sont les thématiques dominantes.
Nombre de ses dessins, médailles et œuvres diverses sont conservés et visibles, entre autres
- dans l'Ashmolean Museum d'Oxford,
- dans la Staatliche Graphische Sammlung
- au Louvre,
- à l'École des Beaux-Arts de Paris et à la Bibliothèque Nationale de France.
Sa dernière œuvre datée indique l'année 1582 et représente un portrait d'Ambroise Paré.
Il meurt à Strasbourg probablement en 1583.
Il aura un fils, Jean, qui fut graveur comme lui.
En 2014, la poste française émettra un timbre auto-adhésif dans un carnet commémoratif de 12 timbres consacré aux objets d’art de la Renaissance, référence Yvert et Tellier de ce timbre AA1011


Document extrait du site wikipedia - Tableau de Louis-Ferdinand Elie
Pierre Bayle est un philosophe français, écrivain et lexicographe c'est-à-dire un homme qui recense, classe, définit et illustre les mots de la langue française.
Converti au catholicisme, il abjure au bout de sept mois et revient au protestantisme, sa religion de naissance
En tant que « relaps » il doit s’exiler en Suisse où il entreprend des études de théologie et de philosophie.
C’est alors que, renonçant à toute croyance et religion, il devient « sceptique », manifestant ainsi son doute et sa défiance vis-à-vis de tout ce qui n’est pas prouvé.
Il publie de nombreux ouvrages, son œuvre majeure étant
« le dictionnaire historique et critique » qui servira de modèle à « l’Encyclopédie »
La France lui proposant de revenir à Paris moyennant une reconversion au catholicisme, il refuse et mourra de tuberculose
à Rotterdam le 28 décembre 1706

La Poste française a émis un timbre à l’effigie de Pierre Bayle en 2006
référencé au catalogue Yvert et Tellier sous le n°3901

Second fils d’un pasteur protestant, Pierre Bayle est instruit par son père qui lui apprend le grec et le latin.
Sa famille étant pauvre, il attendra la fin des études de son frère aîné Jacob pour intégrer l'Académie protestante de Puylaurens.
En 1669, élève au collège des jésuites de Toulouse, il se convertit au catholicisme et, après dix-sept mois, le 21 août 1671, il abjure et revient au protestantisme.
En tant que «relaps», il doit s'exiler à Genève, entreprend des études de théologie et de philosophie et découvre en particulier les pensées cartésiennes de Descartes.
En 1674, il revient incognito en France, travaille comme précepteur à Rouen puis à Paris et en 1675, sur les instances de son ami, le pasteur réformé Jacques Basnage, il se porte candidat à un poste d'enseignant à l’Académie protestante de Sedan et, à l’issue d’un concours et grâce au soutien du pasteur calviniste Pierre Jurieu, il est nommé professeur de philosophie et d'histoire.
En 1681, Louis XIV fait fermer l’Académie de Sedan dans le cadre des mesures antiprotestantes, et Pierre Bayle s'exile aux Provinces-Unies, où il restera jusqu’à sa mort.
Le 8 décembre 1681, il est nommé professeur de philosophie et d’histoire à l’illustre « Ecole de Rotterdam ».
Parallèlement à sa charge d’enseignant, il écrit sans relâche et publie, en 1682, sa célèbre « Lettre sur la comète », rééditée en 1683 sous le titre de « Pensées diverses sur la comète » complétées, par la suite par une « Addition » et une « Continuation ».
Dans ces publications, il dénonce les superstitions et l'idolâtrie et développe le paradoxe de l'athée vertueux en écrivant : « Il n’est pas plus étrange qu’un athée vive vertueusement qu’il est étrange qu’un chrétien se porte à toutes sortes de crimes ».
En 1684, Pierre Bayle crée et rédige un périodique de critique littéraire, historique, philosophique et théologique, les « Nouvelles de la république des lettres », qui rencontre dans toute l’Europe un rapide succès lui permettant d’entrer en relation avec les principaux savants de son temps, car il n'existe alors pas de distinction nette entre la « littérature » et la « science ».
Malheureusement, en 1687, malade, il doit abandonner la rédaction de ce périodique, qui sera repris par la suite par l'avocat lexicographe Henri Basnage de Beauval.
En 1685, après la révocation de l’édit de Nantes, Bayle apprend la mort en prison de son frère Jacob, qui avait refusé d'abjurer.
Dans son « Commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ : Contrains-les d’entrer », il s’insurge contre l'intolérance et prône une tolérance civile de toutes les confessions chrétiennes, du judaïsme, de l'islam et même pour les athées.
En 1690, il fait paraitre un « Avis important aux réfugiés » exhortant les protestants au calme et à la soumission politique.
Ce texte provoque la colère de Pierre Jurieu qui prend la tête de ses ennemis et parvient à le faire destituer de sa chaire en 1693.
Ceci n’entrave pas la préparation de son « Dictionnaire historique et critique », œuvre majeure qui préfigure « l'Encyclopédie ».
Bayle précise son projet dans la préface de ce dictionnaire :
« Or voici de quelle manière j'ai changé mon plan, pour tâcher d'attraper mieux le goût du public. J'ai divisé ma composition en deux parties : l'une est purement historique, un narré succinct des faits : l'autre est un grand commentaire, un mélange de preuves et de discussions, où je fais entrer la censure de plusieurs fautes, et quelquefois même une tirade de réflexions philosophiques ; en un mot, assez de variété pour pouvoir croire que par un endroit ou par un autre chaque espèce de lecteur trouvera ce qui l'accommode. »
Véritable labyrinthe, ce dictionnaire est composé d’articles emboîtés les uns dans les autres, en plus des nombreuses notes et citations où se trouve en réalité l'essentiel de la réflexion.
Le principal enseignement de Bayle est que le monde ne se réduit jamais à une vision manichéenne et suppose le croisement permanent des points de vue et des opinions contradictoires.
Pierre Jurieu le dénonce au consistoire comme impie et au Prince d’Orange, devenu roi d’Angleterre, comme ennemi de l’État et partisan secret de la France, mais, grâce à la protection de Lord Shaftesbury, il échappe aux poursuites.
Pierre Bayle meurt de la tuberculose à Rotterdam le 28 décembre 1706.
Dans une de ses dernières lettres, il écrit : « Je meurs de la mort du philosophe chrétien, persuadé et pénétré des bontés et de la miséricorde de Dieu ».
Bayle est surtout connu comme « sceptique ».
Dans son Dictionnaire, il se plaît à exhumer les opinions les plus paradoxales et à les fortifier d’arguments nouveaux, sans toutefois les prendre à son propre compte.
« Il pense que l'objectivité historique est possible si on respecte les principes fondamentaux de la critique historique, mais que cette objectivité n'est pas la vérité et que l'erreur est toujours possible : elle est causée par les préventions, les préjugés de l'éducation et les passions ».
Avec l’incrédulité qui règne dans ses écrits, il est déjà par son souci de la tolérance un philosophe au sens du XVIIIe siècle et il a frayé la voie à Voltaire qui écrira dans la préface de son « Poème sur le désastre de Lisbonne » que Pierre Bayle est « le plus grand dialecticien qui ait jamais écrit. »
En 2006, la poste française émettra un timbre à son effigie dessiné et gravé par Yves Baujard et référencé dans le catalogue Yvert et Tellier sous le n°3901.


Jean Bart, en flamand Jan Baert, est un corsaire célèbre pour ses exploits au service de la France durant les guerres de Louis XIV.
Pendant la guerre de Hollande, il va cumuler plus de 50 prises entre 1674 et 1678.
Admis dans la Marine Royale avec le grade de lieutenant de vaisseau, il est promu « capitaine de frégate » en aout 1686.
En 1689, chargé d’escorter un convoi de Dunkerque à Brest, il est fait prisonnier par les anglais mais réussit à s’échapper en traversant la Manche à la rame.
Promu « capitaine de vaisseau », il met au point une tactique de guerre faite de harcèlement par des divisions de frégates légères et rapides.
En 1690, il commande « L’Alcion » à la célèbre bataille du cap Béveziers.
En 1692, il détruit une flotte de 80 navires de pêche hollandais.
En 1696, il détruit plus de 80 navires hollandais avant de rentrer à Dunkerque au nez et à la barbe des anglais.
Chef d’escadre, il commande la marine à Dunkerque où il meurt
le 27 avril 1702.

Émission d’un timbre par la poste française en 1958
Référence catalogue Yvert et Tellier n°1167

Jean Bart, en flamand Jan Baert est le fils second de Jean-Cornil Bart, corsaire combattant pour le compte des « Provinces Unies », nom donné à « La république des sept Provinces-Unies des Pays-Bas » et de Catherine née Janssen Rodrigues, fille du corsaire Henri Janssen.
Sa langue maternelle est le flamand.
Avant lui, son grand-père, le vice-amiral Cornil Weus, combat les Hollandais, pour le compte de l'Espagne.
Son arrière-grand-père, Michel Jacobsen, est nommé vice-amiral par Philippe IV d'Espagne après avoir ramené « l'Invincible Armada » à bon port, après sa tentative ratée d'invasion de l'Angleterre en 1588.
Son grand-oncle, Jan Jacobsen, lui aussi au service de l'Espagne, choisira de se faire sauter avec son navire plutôt que de se rendre.
Après lui, la tradition familiale se perpétue puisque ses trois frères seront tous les trois corsaires, son fils François-Cornil Bart servira lui dans la Marine royale et sera nommé vice-amiral du Ponant par Louis XIV.
Enfin, le 27 mars 1759, à bord de « La Danaé », son neveu Pierre-Jean Bart et son fils Benjamin mourront au service de la France en tentant de forcer un blocus anglais près des côtes de la Manche afin de ravitailler la ville de Québec alors sur le point d'être assiégée.
Né dans une famille de marins, de militaires et de corsaires dunkerquois, excellents officiers ayant servi la marine espagnole et dunkerquoise, dès son enfance, son destin est tout tracé.
Dunkerque, sa ville de naissance, fait l’objet d’affrontements qui la font passer successivement sous domination espagnole, puis française, anglaise en 1658 avant d’être définitivement française, Louis XIV l’ayant rachetée à Charles d’Angleterre en 1662.
C’est cette même année que Jean Bart, âgé de onze ans et huit mois, s'engage comme mousse sur un navire de contrebande dont le capitaine, Jérôme Valbué, homme instruit en astronomie, est pilote hauturier des bâtiments du roi.
C'est en sa compagnie qu’il effectuera ses premières sorties en mer.
En 1666, la France étant alliée avec les Provinces-Unies contre l'Angleterre, son père trouve la mort au service des Hollandais dans l'attaque d'un vaisseau anglais, et durant l'été, il s'engage comme matelot sur le « Sept Provinces », navire hollandais, sous les ordres de l'amiral Michiel de Ruyter.
En juin 1667, les Anglais et les Hollandais ayant signé le traité de Breda, de Ruyter confie à Jean Bart le commandement d'un brigantin, navire à un pont, deux mats et voiles carrées, « Le Canard Doré ».
En 1672, Louis XIV entre en guerre contre la Hollande et l’année suivante, Jean Bart embarque comme second à bord de « L'Alexandre » pour pratiquer la « guerre de course ». L'année suivante, il commande une galiote, petit voilier armé de deux canons, « Le Roi David » avec lequel, le 2 avril 1674, il s'empare de sa première prise puis enchaine en faisant sept prises pour 260 000 livres tournois.
Le 6 avril, Bart s'empare d'une « pinasse » anglaise, navire de commerce armé, le 16 mai d'un navire de pêche, un « dogre » et cette même année, huit autres prises viendront compléter le tableau.
Le 3 février 1675, à l'âge de vingt-cinq ans, il épouse Nicole Goutier, âgée de seize ans, fille d'un riche aubergiste, qui lui apporte une dot respectable de 10 000 livres.
En guise de cadeau de mariage, il lui offre « L'Espérance », une frégate légère de 10 canons, dont il s'était emparé aux dépens des Provinces-Unies.
L'année même de son mariage, il capture vingt bâtiments.
En avril 1676, il embarque sur « La Royale », armée de huit canons, et, avant qu’elle ne soit saisie à Hambourg, il s'empare de quatre bateaux de pêche.
Puis, à bord du « Grand Louis » il capture vingt-huit vaisseaux avant de rentrer à Dunkerque.
La même année, chargé par des armateurs particuliers de commander une frégate de 24 canons et de 150 hommes d'équipage, en compagnie de quatre autres corsaires dunkerquois, il découvre et intercepte une flotte marchande convoyée par trois frégates.
Il la bat, après un combat de trois heures.
Le 7 septembre, il enlève seul une frégate d’escorte hollandaise de 36 canons.
Pour l'année 1676, le nombre des prises effectuées par Jean Bart s'élevant à dix-sept, il commence à attirer l'attention du ministre de la Marine Colbert et de Louis XIV lui-même.
De 1677 au 10 aout 1678, avant que la France et la Hollande signent le traité de Nimègue, mettant ainsi fin à la guerre de Hollande, il arraisonne et capture un nombre impressionnant de vaisseaux :
- À bord de « La Palme », frégate de vingt-quatre canons, à la tête d'une flottille de six navires, il s'empare d'une vingtaine de vaisseaux.
- À bord du « Dauphin », frégate de quatorze canons, il arraisonne un quatre-mâts hollandais.
- Au large de l'île de Texel, en juin 1678, sa petite escadre de quatre navires s'attaque au « Schiedam », frégate de 24 canons de la flotte hollandaise.
Durant l’affrontement, Jean est gravement brûlé aux mains et au visage par l'explosion d'une grenade et un boulet de canon emporte des lambeaux de chair de ses jambes.
Il s’empare pourtant du « Schiedam » et le remorque jusqu'à Dunkerque.
- À bord du « Mars », corsaire de vingt-six canons, il arraisonnera encore quelques navires, avant la signature du traité mettant fin aux combats.
Une fois la paix signée, sur la recommandation de Vauban, Jean Bart rejoint la Marine royale et, le 8 janvier 1679, Louis XIV le nomme « lieutenant de vaisseau ».
Désœuvrées durant un temps, en 1681, trois frégates quittent Dunkerque pour chasser les pirates barbaresques qui hantent la Méditerranée.
Jean Bart, commandant « La Vipère », frégate de douze canons, il capture quelques bateaux pirates avant qu’une trêve soit signée avec la France.
1681 est une année noire pour Jean Bart dont la mère meurt, suivie quelques mois plus tard par sa fille, et en fin d'année par sa femme Nicole, alors âgée de vingt-trois ans.
En 1683, la France est en guerre contre l'Espagne et Jean Bart, ayant capturé un vaisseau espagnol chargé de transporter 350 hommes de troupe, le ramène à Brest.
La même année, il contribue à la prise de deux vaisseaux espagnols dans le voisinage de Cadix, mais la marine espagnole étant bien plus faible que la marine française, Charles II d'Espagne signe très vite une trêve.
Le 14 août 1686, le Roi le nomme capitaine de frégate de la Marine Royale.
Il commande alors « La Serpente », frégate de vingt-quatre canons.
En 1688, la France, alliée au Danemark et à l'Empire ottoman, entre en guerre contre la ligue d'Augsbourg qui réunit l'Angleterre, l'Allemagne, l’Espagne, les Pays-Bas, la Savoie et la Suède.
En 1689, Jean Bart qui commande « La Raillause », petite frégate de 24 canons, quitte Dunkerque pour escorter des convois.
Il est accompagné d’une autre frégate « Les Jeux », plus petite encore que la sienne, commandée par l’officier de marine Claude de Forbin.
Au cours d'un premier combat, après un abordage sanglant, ils s’emparent d'un corsaire hollandais et le conduisent à Brest avec les bâtiments qu'il escortait.
Un peu plus tard, alors qu’ils convoyaient vingt bâtiments au large de l’ile de Wight, ils sont pris en chasse par deux vaisseaux anglais de cinquante canons chacun.
Pour s’opposer à la capture des navires marchands qu’ils escortaient, Jean Bart et Claude Corbin décident d’engager le combat.
Débordés par la supériorité des forces anglaises, ils sont battus, faits prisonniers et envoyés à Plymouth.
Malgré leurs nombreuses blessures reçues au combat, gagnant la confiance d’un matelot d’Ostende qui leur procure une lime, ils parviennent à scier les barreaux de leur fenêtre de cellule.
Réussissant à cacher l’opération jusqu’à ce que leurs blessures commencent à guérir, grâce à l’aide de deux mousses qu'on leur avait donnés pour leur service, ils réussissent à s'emparer d'un canot norvégien dont le batelier est ivre-mort.
Descendant une nuit par la fenêtre de la prison au moyen de leurs draps, ils embarquent sur le petit canot.
Aidé par les deux mousses, les blessures de Corbin encore saignantes ne lui permettant pas de ramer, Jean Bart et ses compagnons réussissent à gagner Erquy, près de Saint-Malo, dans les « Cotes d’Armor » après trois jours de rame.
Le 20 juin 1689, quinze jours après son évasion, en récompense de son dévouement à sauver la flotte marchande, Jean Bart est nommé « capitaine des vaisseaux du roi ».
Le 13 octobre de la même année, après sept années de veuvage, et alors qu'il est âgé de trente-neuf ans, il épouse Jacqueline Tugghe.
L'année suivante, il reçoit le commandement de la frégate « L'Alcyon » au sein de la flotte conduite par Tourville, vice-amiral de la « flotte du Levant » et prend part à la bataille du « cap Béveziers », remportée par Tourville, le 10 juillet 1690, ainsi qu'à la fameuse campagne « du Large » effectuée par cet illustre amiral, entre juin et août 1691.
Pourtant, cette année-là, il se distingue surtout par son extraordinaire sortie de Dunkerque avec une escadre placée sous ses ordres.
Apprenant qu'un armement se préparait à Dunkerque, une flotte de trente-cinq à quarante vaisseaux anglais vient bloquer la rade de Dunkerque.
Après quinze jours passés dans la rade, sans que les Anglais et les Hollandais jugent utile de l'attaquer, Jean Bart parvient à prendre le large, de nuit, avec sept frégates et un brûlot.
Dès le lendemain, il s'empare de quatre bâtiments marchands et de deux navires d'escorte anglais qu’il met à l'abri d'un port de Norvège, alors en paix avec la France.
Puis il reprend la mer et s’empare d'une flotte de pêcheurs hollandais et du navire de guerre qui l'accompagnait avant de faire une razzia sur les côtes d'Écosse, où il pille un château et incendie quatre villages.
Chacun, en France, ayant entendu parler des exploits du corsaire, Louis XIV l’invite en 1692 à la cour de Versailles, afin d'honorer ses victoires maritimes.
Mais, plus habitué à combattre sur mer qu'à l'étiquette, Jean Bart s'attire les moqueries d'une partie des gentilshommes présents, ces moqueries étant sûrement teintées d’une part de jalousie.
En 1693, commandant « Le Glorieux », vaisseau armé de 62 canons, sous les ordres du maréchal de Tourville, après le brillant combat de Lagos et la capture du « convoi de Smyrne », il quitte la flotte.
Il rencontre alors six bâtiments hollandais, de 24 à 50 canons, tous richement chargés, les contraint à s'échouer et les brûle.
De retour à Toulon, il reçoit l'ordre de passer à Dunkerque pour y prendre le commandement d'une escadre de six frégates, ayant pour mission de ramener à bon port une flotte chargée de blé pour le compte du roi.
Il mène cette mission avec succès et, peu de temps après, il se rend maître de trois frégates anglaises, dont les deux premières servaient d'escorte à un transport de munitions de guerre pour le roi Guillaume III.
En 1694, en raison du blocus de la Ligue d'Augsbourg, la France est affamée et Louis XIV achète cent dix navires de blé norvégien.
Le lendemain de son départ de Dunkerque, Jean Bart, rencontrant cette flotte de navires marchands, constate immédiatement qu'elle a été capturée par huit vaisseaux de guerre hollandais, dont l'un porte le pavillon contre-amiral.
Ne disposant que de sept bâtiments de rang inférieur à ceux de l’ennemi, malgré l'inégalité des forces en présence, il entreprend de récupérer la flottille.
Après un combat acharné, l'amiral hollandais Hidde Sjoerds de Vries, grièvement blessé et mourant étant capturé, il parvient à reprendre la flotte et la ramène en France.
La nouvelle de cette capture fait chuter les prix du blé et met fin à toutes spéculations.
Pour cet exploit, le 19 avril, Jean Bart reçoit des mains de Louis XIV « la croix de chevalier de l'Ordre de Saint-Louis ».
Une médaille est frappée en souvenir du combat du 29 juillet 1694, et Jean Bart est anobli. Dans les lettres de noblesse qu'il lui envoie, en date du 4 août 1694, Louis XIV autorise Jean Bart à arborer une fleur de lys d'or dans ses armes et, plein de gratitude, il écrit :
« De tous les officiers qui ont mérité l'honneur d'être anoblis, il n'en trouve pas qui s'en soit rendu plus digne que son cher et bien-aimé Jean Bart. »
En 1695, la flotte anglaise bombarde plusieurs places et en particulier Dunkerque d'où, chaque jour, des corsaires partent au combat.
Chargé de la défense du fort « Bonne-Espérance », avec sous ses ordres son fils François-Cornil, il parvient par ses tirs d'artillerie à faire partir la flotte anglaise.
En récompense de ses nouveaux services, il reçoit une pension de 2 000 livres et son fils est promu lieutenant de vaisseau à 18 ans seulement.
Début juin 1696, malgré quatorze vaisseaux ennemis qui voulaient lui fermer le passage, Jean Bart sort de Dunkerque à bord du « Maure », une frégate de 54 canons, avec sept bâtiments. Le 17 juin 1696, vers sept heures du soir, il découvre une flotte de cent-douze navires marchands escortée par six vaisseaux de guerre hollandais.
Toute la nuit l'escadre française attend, et le lendemain, à la pointe du jour, elle n'est plus qu'à deux lieues sous le vent de la flotte ennemie.
Jean Bart donne le signal d'ordre de bataille et concentre ses forces sur le principal bâtiment hollandais armé de 44 canons, le « Raadhuis-van-Haarlem ».
Après un violent combat, les bâtiments hollandais étant capturés, il apprend qu'une escadre de treize bâtiments anglais se dirige vers lui.
Le combat s’avérant trop inégal, il brûle les quatre vaisseaux capturés et renvoie les Hollandais prisonniers dans leur pays sur les deux vaisseaux restants.
Poursuivi par une véritable meute, l'escadre de Jean Bart et ses prises trouvent refuge au Danemark puis, échappant aux vaisseaux britanniques et néerlandais de Benbow et de l'amiral Wanzel, regagnent Dunkerque avec 25 navires marchands et 1200 prisonniers.
Après cette nouvelle campagne, Jean Bart rentre en France, en passant à nouveau à travers trente-trois vaisseaux anglais et hollandais qui voulaient lui barrer la route.
En récompense de sa conduite, il est promu à 46 ans, le 1er avril 1697, au grade de « chef d'escadre de la province de Flandre ».
Peu après, Jean Bart est chargé de conduire à Dantzig le prince de Conti, soutenu par le parti français pour être le prochain roi de Pologne.
Apprenant cela, les flottes alliées envoient dix-neuf vaisseaux de guerre croiser au nord de Dunkerque.
Côté français, refusant l’escadre de dix vaisseaux armés pour cette expédition, Jean Bart préfère effectuer le voyage accompagné seulement de six frégates.
Il quitte Dunkerque dans la nuit du 6 au 7 septembre et, déjouant les forces ennemies, il arrive sept jours après au détroit du Sund.
Après avoir salué de quinze coups de canon la famille régnante de Danemark en paix avec la France, il mouille à Copenhague le 15 septembre et, le 26 du même mois, il entre en rade de Dantzig.
C’est alors qu’apprenant que Frédéric-Auguste de Saxe, son concurrent, avait été couronné roi, le prince de Conti ne juge pas devoir pousser plus loin ses prétentions et décide de rentrer en France.
Cette expédition sera la dernière du célèbre marin dunkerquois.
En 1702, atteint d’une pleurésie, il ne pourra pas honorer la dernière mission qui lui était proposée et meurt chez lui le 27 avril, à l'âge de 51 ans.
Son corps est inhumé dans l'église Saint-Éloi de Dunkerque.
La Poste française honorera sa mémoire par l’émission d’un timbre en 1958 dessiné par Maurice Lalau, gravé par Jacques Combet et figurant dans le catalogue Yvert et Tellier, dans la série des personnages célèbres, sous le n°1167.


Marc-Pierre de Voyer de Paulmy, comte d’Argenson, homme d’État français, titulaire des plus hautes fonctions durant la première moitié du XVIIIème siècle, il fut successivement lieutenant général de police, chancelier du duc d’Orléans, ministre d’état et secrétaire d’État de la Guerre de Louis XV.
Cette période lui doit de très nombreuses réformes des moyens, de formation, de tactiques et d’organisation de l’armée.
D’abord ami de Madame de Pompadour, sa proximité avec le parti de la Reine changera cette amitié en franche hostilité et entrainera son exil dans son château des Ormes
Il ne reviendra à Paris qu’en juin 1764 pour mourir deux mois plus tard, le 26 aout 1764 à 68 ans.
Il est inhumé à l’église Saint-Nicolas-du-Chardonnet à Paris.

Émission d’un timbre par la poste française en 1953
Référence catalogue Yvert et Tellier n°940

Fils de Marc René, 1er marquis d'Argenson et frère cadet de René Louis, 2e marquis d'Argenson, il est en 1717, à 21 ans, avocat du Roi au Châtelet de Paris, conseiller au Parlement de Paris puis maître des requêtes deux ans après.
Le 24 mai 1719, il épouse Anne Larcher, fille d'une riche famille de parlementaires parisiens. Ils auront deux fils dont l'aîné, Marc René, sera marquis de Voyer puis comte d'Argenson.
Après un bref passage à la lieutenance générale de police en janvier-juin 1720, il est nommé l’année suivante intendant de Touraine, fonction sensiblement équivalente à nos actuels préfets.
Il redevient ensuite lieutenant général de police et gagne la confiance du Régent Philippe d’Orléans, la mort de son protecteur stoppant son ascension pour une quinzaine d'années. Comme chancelier du duc d'Orléans, il s'efforce avec succès de rétablir les finances de la maison d'Orléans.
Proche du roi Stanislas Leszczynski, il entre dans le cercle de la reine Marie Leszczyńska, aux côtés de son meilleur ami historien, le président Charles-Jean-François Hénault d’Armorezan et va réussir à reprendre pied en politique.
Revenu aux affaires, le cardinal de Fleury le nomme directeur de la Librairie, puis président du Grand Conseil juridique du Roi.
Nommé intendant de Paris en 1741, il renonce à la chancellerie d'Orléans.
Le 26 août 1742, il est nommé ministre d'État et appelé au Conseil du Roi comme adjoint au cardinal de Tencin.
Il est ensuite nommé « secrétaire d'État de la Guerre » le 7 janvier 1743 et l’année d’après, il devient surintendant des postes et relais de France.
Durant ce secrétariat d’Etat il soutient les réformes engagées dans l'armée par le maréchal de Saxe, en particulier dans l'artillerie, contribuant ainsi aux succès de 1744 et 1745.
La paix d'Aix-la-Chapelle n'arrête pas son ambition réformatrice :
- En 1743, réunion au département de la Guerre du « corps des fortifications » puis en 1755, de « l'artillerie »
- En 1744, institution des Grenadiers royaux.
- En 1746 et 47, réforme des hôpitaux militaires.
- En 1749 et 50, création de l'école royale du génie de Mézières.
- En 1750, édit sur la noblesse militaire.
- De 1750 à 1755, nouveaux exercices à la prussienne.
- En 1751, édit de création de l'École militaire.
- De 1753 à 1755, institution des camps militaires.
- En 1756, réforme du Dépôt de la Guerre.
- Cette même année, c'est lui qui se porte acquéreur au nom de l'État des terrains qui vont former le Champ-de-Mars.
En 1749, il se voit également confier le département de Paris et fait dresser les plans des Champs-Élysées et de la place Louis XV.
En 1751, il reçoit la grand-croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.
D'abord ami de Madame de Pompadour, il est ensuite en butte à l’hostilité de celle-ci, sans doute en raison de sa proximité avec le parti de la Reine et de son opposition à l'alliance autrichienne.
Il est en définitive exilé dans son château des Ormes en février 1757 et remplacé par son neveu, Antoine-René de Voyer, marquis de Paulmy.
Il ne reviendra à Paris qu'en juin 1764, trois mois après la mort de Madame de Pompadour, et mourra à son tour deux mois plus tard, le 26 aout 1764, âgé de 68 ans.
Il est inhumé à l'église Saint-Nicolas-du-Chardonnet à Paris.
Protecteur des Philosophes comme directeur de la Librairie, il se vit dédier par Denis Diderot et Jean le Rond d'Alembert « l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers ».
Ami de Voltaire, il lui procura des matériaux pour son ouvrage « Le Siècle de Louis XIV ».
Reconnaissant, le philosophe lui écrivit en ces termes : « Cet ouvrage vous appartient, il s'est fait en grande partie dans vos bureaux et par vos ordres. »
Il fut nommé membre honoraire de l'Académie des sciences en 1726 et de l'Académie des inscriptions et belles-lettres en 1748.
En 1953, la poste française émettra un timbre à son effigie, dessiné et gravé par Raoul Serres et référencé dans le catalogue Yvert et Tellier sous le n°940.
Ce même timbre fera l’objet d’une émission ultérieure avec surcharge « Algérie ».
Commentaires