Recueil Épisode 01 à 20
- JF
- 18 févr. 2025
- 75 min de lecture
Dernière mise à jour : 20 juin 2025





Pourquoi ai-je décidé de m’asseoir à ma table de travail et de puiser dans ma mémoire, souvent défaillante, pour parler de mon enfance, de ma jeunesse, d’évoquer cette lointaine époque qui m’a vu naître et découvrir ce monde qui s’offrait alors à moi.
La raison essentielle, je crois, est le manque que me procure l’absence de connaissance des années de prime jeunesse de mes parents et singulièrement celles de mon père.
Il y a quelques années, par curiosité tout d’abord puis par passion, j’ai cherché à remonter la lignée de mes ancêtres et rapidement, je me suis senti extrêmement frustré de ne pouvoir connaître, au-delà d’un nom, d’un prénom et de quelques dates, aucun ou si peu de détails sur l’existence de ceux qui sont génétiquement responsables de ce que je suis devenu.
Il y a longtemps que j’y songeais et la période de confinement que nous avons vécue pour faire obstacle à ce méchant petit virus venu de Chine et qui a, mieux qu’une guerre, paralysé et mis à genoux la planète entière, ce vilain petit microbe donc, et l’enfermement qu’il a provoqué m’ont enfin décidé à écrire et donc à essayer de transmettre ces souvenirs de moi, pour que mes enfants, mes petits-enfants et ceux qui suivront n’ignorent rien de ce que ce père et ce grand-père que je suis a vécu avant qu’ils ne me connaissent.
A condition bien sûr que cela les intéresse, mais j’ai plaisir à le croire.
J’ai eu une enfance très heureuse, guidée, entourée par des parents aimants et une famille d’autant plus présente qu’à l’issue de cette guerre qui les avait dispersés, tous avaient besoin de se retrouver, de se rapprocher, de s’aimer et de partager la joie de la paix retrouvée.
Certes, la mémoire est fugace et il faut bien reconnaître que l’enfance a souvent tendance à embellir ce qui plaît et gommer ce qui fâche, mais j’ai la conviction que tout ce que je vais relater dans ces pages est la réalité de ce que j’ai vécu et tant pis si parfois l’imagination remplit les inévitables manques de mes souvenirs.
Parents et grands-parents qui me lirez, songez à ce que cet exercice de souvenance, à coté du plaisir que vous pourriez en retirer en vous y consacrant et en retrouvant ces moments presque oubliés, apportera à ceux qui vous suivent et qui, vous découvrant ainsi, ne vous en aimeront que davantage.
C’est, en ce qui me concerne, ce que j’en espère en écrivant ces lignes.

Je suis né le 10 février 1941.
Papa, jeune ingénieur fraîchement diplômé de l’Institut Catholique des Arts et Métiers de Lille, embauché par la déjà très grande firme de Saint-Gobain, avait été affecté à la fin des années trente dans une usine de verrerie située dans un tout petit village de l’Aveyron, au bord du Lot, dans un coin perdu du Massif-Central au joli nom de Boisse-Penchot.
Il avait épousé maman, quatrième fille d’un vigneron nivernais, plus jeune que lui de deux ans et tellement jolie.
C’était Jean et Renée, Nono pour elle et Re-Chérie pour lui.
Ils étaient tout juste installés lorsqu’un certain petit moustachu allemand, hystérique et malfaisant, provoquait le Monde en déclenchant pour sept ans cette guerre qui allait bouleverser l’existence de tant de gens et la nôtre en particulier.
Après une dernière permission de quinze jours, le sept mai 1940, Nono dut donc laisser Re-chérie et partir, sur la ligne Maginot, se battre contre l’envahisseur. Ce fut bref et, comme beaucoup d’autres, le jeune lieutenant d’artillerie qu’il était se retrouva très vite prisonnier dans un « oflag » de Rhénanie.
Fort heureusement pour moi et pour cette histoire, grâce à cette fameuse ultime permission, Nono avait juste eu le temps de laisser à Re-Chérie un bien joli cadeau, « Moi » !!!
Je dois vraiment à bien peu de choses d’avoir la chance d’exister.
Nono, dans l’isolement de son « oflag » rhénan, n’apprit que tardivement sa promotion au grade de papa, en recevant un des rares courriers ayant franchi la vigilante censure teutonne et qui évoquait l’abondante quantité de couches à laver. La conclusion venant d’elle-même, il dut encore attendre quelques mois avant de savoir qu’il s’agissait d’un garçon.
Je n’ai presque aucun souvenir de mes toutes premières années.
Quelques photos délicieusement rétro montrent le « bout de chou » que j’étais, dans des bras adultes, ou assis dans l’herbe, ou bien dans un de ces antiques landaus noirs carrossés à la façon des voitures de l’époque, ou encore esquissant des premiers pas hésitants cramponnés aux deux index de ma mère.
J’étais dans tous les cas affublé de ces inénarrables barboteuses bouffantes, certainement très pratiques pour loger les couches, mais inesthétiques au possible et qui me faisaient ressembler à une petite citrouille perchée sur deux courtes guibolles gringalettes, le tout surmonté de deux petits bras grassouillets greffés sur un torse menu et d’une jolie frimousse ronde et presque toujours souriante.
J’ai porté longtemps ces fameuses barboteuses, au moins jusqu’à l’âge de quatre ans, alors que le temps des couches était révolu depuis quelque temps déjà.
En effet, grâce à la géniale invention d’un certain Albert-Pierre Raymond de Grenoble, le système de fermeture par trois ou quatre boutons-pression dans l’entrejambe facilitait grandement, aux yeux des adultes, les travaux de maintenance hygiéniques pluriquotidiens.
Cela ne me gênait pas n’ayant, à l’époque, aucun souci de plaire. Ce fut par contre l’occasion d’un de mes premiers douloureux souvenirs mon petit appendice qui, par mégarde, dépassait bêtement, ayant été cruellement pincé par un de ces diables de boutons-pression. Je me souviens d’avoir beaucoup pleuré, consolé que j’étais par mes deux mamans.
Il faut dire, en effet, qu’en ces temps troublés par la guerre, j’avais le grand privilège de bénéficier de la présence, de l’attention et de la tendresse constante de deux mères.
Re-Chérie avait, comme je l’ai déjà dit, trois grandes sœurs.
L’une d’elles, Anne-Marie, avait elle aussi vu son mari Roger, dit Gégé, partir pourfendre les « teutons » et, comme Nono, il s’était retrouvé prestement et pour quatre ans, derrière les barbelés d’un autre « oflag ».
Gégé dit « Tonton » et Anne-Marie dite « Tata » n’avaient pas d’enfant.
Anne-Marie, ayant fui l’envahisseur en se lançant courageusement et très inconsciemment seule, au beau milieu de la marée des fuyards qui cherchaient un hypothétique salut vers le sud, avait rejoint Re-chérie et les deux sœurs avaient fait front commun.
Dès ma naissance et jusqu’au retour des maris libérés, j’ai donc eu la très grande chance d’être l’objet d’une double affection.
Mon second souvenir date très précisément, et d’après ce qui m’a été dit, du 23 novembre 1943. J’avais donc deux ans et un peu plus de neuf mois.
Je revois vaguement, dans le hall d’entrée de ce qui devait être notre habitation de l’époque, une paire de gros godillots et de mollets emprisonnés dans ce que l’on baptisait fort justement bandes molletières, sur lesquels, en levant la tête, je découvrais intrigué et effrayé, un grand bonhomme dont la tête était surmontée d’une sorte de chapeau pointu appelé calot militaire.
C’était mon père que j’examinais, tout d’abord avec circonspection, réfugié dans les jupes maternelles et qui, tel Malbrough « s’en revenait de guerre », libéré en tant qu’orphelin de guerre 14-18 et chargé de famille.
Le reste est beaucoup plus flou. J’ai encore la très nette impression d’avoir quitté la terre, enlevé par des bras qui me serraient très fort sur des joues qui piquaient et qui sentaient très mauvais.
Et puis rien, ou plutôt si, j’oubliais un détail, ou plutôt un incident qui a marqué cette époque de mon enfance. Ce fut le jour ou, pénétrant dans la chambre parentale, je découvrais, tout à fait innocemment, l’anatomie paternelle et, stupéfait et pensant à la mienne, je m’écriais en pointant l’objet du doigt : oh ! qu’elle est grosse !!!
Je me souviens de papa, mort de rire, et de maman, rouge de confusion, m’entraînant prestement hors de la chambre en m’abreuvant d’explications confuses, auxquelles je ne comprenais rien et que j’ai d’ailleurs oublié.


J’allais vers l’anniversaire de mes quatre ans.
Malgré les absences fréquentes de papa en raison des obligations liées aux conditions de sa libération, l’atmosphère avait changé : il y avait un homme à la maison.
Jusqu’ici, dorloté par maman et Tata, j’avais vécu dans un contexte strictement féminin. Or voilà que je n’avais plus maman pour moi tout seul.
Une grosse voix me rappelait parfois que le monde était pavé d’interdits.
Quant à Re-Chérie, elle semblait, trop souvent à mon goût, préférer être seule avec Nono, libérée de ma présence encombrante et, paraît-il, jacassante.
Et puis il se produisait quelque chose de bizarre.
De plus en plus, sous l’œil attendri de papa, maman me faisait caresser son ventre, curieusement un peu plus encombrant chaque jour, en me parlant d’un certain « bébé ». Bébé par ci, bébé par là, je commençais à trouver ce bébé fantôme plutôt envahissant.
Je n’étais plus le centre du monde familial et j’étais loin de me douter que tout cela n’était qu’un début.
Intrigué, j’observais les grandes manœuvres durant lesquelles la chambre voisine de la mienne, jusque là inoccupée et qui servait de débarras, était vidée, nettoyée et repeinte pour enfin recevoir un curieux mobilier dont l’élément principal était un magnifique petit lit blanc, capitonné de tissu et surmonté d’un voilage dans des tons pastels que je trouvais superbe.
Ma propre chambre me paraissait soudain affreusement terne et sans intérêt.
A quelque temps de là, maman, dont le ventre était devenu énorme, entreprit, malgré mon encombrante présence, un voyage en train qui nous conduisit chez une autre de ses sœurs appelée Thérèse et que j’appelais « tante Thétèse ».
Tante Thétèse et son mari Emilien dit « tonton Milien » étaient propriétaires et exploitants d’un hôtel-restaurant dans la ville du Coteau, près de Roanne dans la Loire. Ils géraient cet établissement avec la sœur aînée de maman, tante Simone, et son mari Henri qui faisait fonction de maître d’hôtel.
Comme toutes ses sœurs, tante Simone me vouait une affection que je trouvais parfois gênante.
Elle avait pris la détestable habitude de m’affliger du surnom affectueux de « ma crotte », surnom qui m’a longtemps accompagné dans sa bouche, même devenu adulte, alors que vieillissante, elle commençait sérieusement « à perdre la boule ».
La connotation scatologique de cet affreux surnom me perturbait au plus haut point et je m’appliquais à éviter de la croiser.
Très curieusement, tante Thérèse était dotée du même ventre énorme et proéminent que sa sœur. L’une et l’autre disparurent bientôt à quelques jours d’intervalle, et puis papa revint, seul sans maman, et m’annonça avec un immense sourire que j’avais un petit frère qui s’appelait Jean-Pierre.
Encore quelques jours et maman reparut, tenant dans ses bras une sorte de paquet de linge d’où s’échappait parfois un petit cri de souris. Le paquet prestement déballé finit par atterrir dans le petit lit de la chambre voisine, le petit cri ne tardant pas à se transformer en une sorte de miaulement strident et répétitif.
J’étais médusé et d’autant plus intrigué que je ne parvenais pas à regarder dans le lit, l’entourage capitonné dépassant ma petite taille. C’est donc soulevé par papa que je découvris stupéfait cette petite chose braillarde et rouge de colère qui allait partager ma vie et me priver de mon statut de nombril de la cellule familiale.
Maman, dont le ventre avait bizarrement dégonflé, passait son temps avec bébé. Ce dernier avait pour unique préoccupation de dormir et de hurler, dés qu’il était réveillé, ce qui provoquait sans attendre l’intervention maternelle.
S’ensuivait immuablement un cérémonial dont le premier acte consistait en une mise à nu et un nettoyage attentif du petit postérieur le plus souvent merdeux, les couches sales se voyant remplacées par un carré de linge propre, emballant le derrière de bébé en un savant pliage, le tout serré et fixé par des épingles dites de sureté.
Le deuxième acte du cérémonial m’intriguait.
Une fois bébé emmailloté, maman prenait place dans un fauteuil et, sans attendre, exhibait un sein opulent qu’elle présentait à bébé, lequel, soudain calmé, s’empressait de le mordre avec énergie.
J’étais effaré, bébé mangeait maman qui ne disait rien et semblait ne pas en souffrir.
A mes questions angoissées, papa m’expliqua que les bébés, n’ayant pas de dents, ne pouvaient pas manger comme nous. Le Petit-Jésus, qui pensait à tout, avait équipé les mamans de gros biberons pour donner du lait aux bébés jusqu’à ce qu’ils puissent manger comme tout le monde.
J’étais à moitié convaincu mais, après tout, personne, et surtout pas maman ou bébé, ne semblant se plaindre, cette affaire cessa très rapidement de me préoccuper.
Pourtant, le plus étonnant était encore à venir. Tante Thétèse qui avait elle aussi dégonflé, nous avait rapporté un deuxième paquet braillard prénommé Justin. Pour une raison que j’ignore, le Petit-Jésus n’avait pas doté ma tante de biberons fonctionnels et efficaces. C’est pourquoi, à mon grand étonnement et malgré mon air réprobateur, une fois mon frère rassasié, le cousin Justin prenait le relais.

Maman fatiguée et toute à sa double mission d’allaitement, notre séjour au Coteau s’est prolongé jusqu’à l’automne.
Papa qui faisait des allers-retours par le train pour assurer sa mission d’ingénieur à l’usine, je restais seul et livré à moi-même dans la cour et les couloirs de l’hôtel où, avec peu de choses, je m’inventais des jeux.
La cour de l’hôtel servait de parking pour les clients de passage et il m’est arrivé un jour, alors que je recherchais une occupation originale, de me glisser discrètement sur le siège du conducteur d’une de ces voitures pour un merveilleux voyage immobile.
Ayant appuyé sur le bouton de l’avertisseur, au centre du volant, tonton Milien, alerté par le bruit, m’a surpris et extrait du véhicule avec interdiction formelle de recommencer.
Sa grosse voix, les sanctions, épouvantables à mes yeux d’enfant, qui m’étaient promises et la grande frayeur produite par cette aventure, me dissuadèrent bien entendu de renouveler cet exploit dont je garde pourtant un très bon souvenir.
Malgré tout, j’aimais beaucoup, que dis-je, j’adorais tonton Milien.
Toujours joyeux et dès qu’il pouvait s’enfuir de sa cuisine, c’est-à-dire très fréquemment (ce n’était pas un bourreau de travail), il m’emmenait explorer les environs et les bords de la Loire. Trop jeune encore, il n’avait pas jugé bon de m’enseigner l’art de la pêche que lui-même pratiquait de façon quasi professionnelle.
J’ai assisté, le cœur battant, à des batailles homériques pour amener au sec des carpes, monstrueuses à mes yeux, ma mission étant, parfois, de présenter l’épuisette sous ces gros poissons, halés précautionneusement jusqu’au bord, fil tendu au bord de la rupture.
La plupart de ces prises finissaient régulièrement sur les tables du restaurant. Elles étaient certainement délicieuses, mais je refusais énergiquement de les déguster par peur panique des arêtes.
C’est à cette époque que j’ai vraiment fait la connaissance de mes grands-parents maternels.
Maman était née dans la Nièvre, dernière de quatre filles, surprise tardive choyée par ses sœurs qui adoraient ce « petit reculon » comme on disait alors.
En fait, ce n’était pas réellement la première fois que je les rencontrais, quelques photos témoignant du fait que, bravant les dangers des déplacements de l’époque, Maman et Tata étaient venues présenter ce nouveau venu dans la famille.
Mes grands-parents habitaient Myennes, un petit village situé sur les bords de la Loire, pas très loin du Coteau.
Je n’ai pratiquement aucun souvenir de ma grand-mère.
Quelques photos aidant, je revois vaguement une très vieille dame, plus petite que maman, le plus souvent assise dans sa cuisine.
Elle s’appelait Catherine Bretnacher et avait épousé Pierre Blanc, vigneron de son état, lui donnant cinq enfants, dont maman et un fils disparu prématurément et que je n’ai pas connu.
Je crois ne l’avoir jamais revue depuis, car elle avait, peu d’années après, rejoint les anges et le Bon Dieu.
Grand-père Pierre, par contre, est beaucoup plus présent dans ma mémoire.
Vieil homme alerte aux cheveux de neige, il passait ses journées au milieu des ceps et des champs.
Il m’avait emmené dans les vignes, juste avant les vendanges et, paraît-il, maman m’avait retrouvé, assis sous une treille, picorant avidement les grains juteux d’une grappe de raisin blanc. Mon appétence pour ce fruit de l’automne, encore très vive de nos jours, vient surement de cette première et délicieuse expérience.
Ce séjour au Coteau a permis également la célébration d’une fête religieuse, longtemps différée en ce qui me concerne et que la venue au monde de mon petit frère Jean-Pierre justifiait.
En effet, la guerre et l’absence de papa m’avaient privé de cette incontournable cérémonie que, dans nos familles, notre civilisation judéo-chrétienne impose, je veux parler du baptême.
Jean-Pierre et moi avons donc reçu ce même jour l’onction et l’eau qui devait nous faire rejoindre le monde chrétien.
Ce fut un inoubliable évènement qui s’est tenu le cinq aout 1945, et dont je garde un souvenir assez vague heureusement ravivé par les nombreuses photos prises ce jour-là et sur lesquelles je retrouve avec émotion une grande partie de la famille réunie à cette occasion, grands-parents, parents, ainsi bien sûr que les parrains et marraines des deux baptisés.
Un grand repas avait été préparé par tonton Milien et c’est à cette occasion que, parait-il, j’ai pris ma « première cuite ».
En effet, le repas terminé et les tables non encore débarrassées, j’ai, dit-on avec application, entrepris de vider les verres en partie remplis restés sur la nappe.
J’ai, toujours selon ce qu’on m’a dit, été horriblement malade à tel point que pendant un moment, ivre-mort, il a été question de me conduire aux urgences de l’hôpital le plus proche, ce qui, pour finir, n’a heureusement pas été nécessaire.
S’en est suivi, le lendemain, un épouvantable mal de tête et une monumentale crise de foie d’une semaine, soignée comme il se devait à l’époque par une cure d’huile de foie de morue dont la simple évocation réussit, encore aujourd’hui, à me soulever le cœur.



A la fin de l’automne, le voyage de retour nous permit de rejoindre la maison et mes habitudes.
Je trouvais que maman, très occupée par le fameux bébé toujours aussi braillard, affamé et « merdeux » de façon récurrente, me négligeait beaucoup.
A cette époque, nous étions encore très loin des couches jetables.
La salle de bains, transformée en buanderie, avait été équipée, au-dessus de la baignoire, d’un étendoir constitué de câbles tendus dans un cadre en tubes métalliques, le tout relevable grâce à un ingénieux système de cordes et de poulies.
J’étais fasciné par ce procédé que je n’avais, bien entendu, pas le droit de manœuvrer. Il faut dire que le poids de l’ensemble aurait certainement et sans coup férir catapulté mes quelques kilos jusqu’au plafond.
Je trouvais, en tous cas, cet étalage de carrés blancs pendouillant aussi peu décoratif que possible, tout en sachant pertinemment que mon point de vue n’avait aucune chance d’être entendu.
Désormais assez solitaire, je me réfugiais dans ma chambre, où je retrouvais mes jouets et tout particulièrement un magnifique attelage de deux bœufs tirant une charrette en bois peint, cadeau d’un certain Père Noël quelques mois plus tôt.
Je ne parvenais pas à comprendre d’où venait et qui était ce Père Noël, mais je dois dire que je lui étais infiniment reconnaissant d’avoir deviné très exactement quel était le jouet dont j’avais tant envie et auquel je rêvais, ayant vu le même chez Jean-Louis, mon ami et fils du directeur de l’usine, chez qui je m’étais rendu, escorté par maman.
Cet attelage a fait ma joie très longtemps. Ce chariot chargé de tout un bric-à-brac, cubes, nounours, cailloux ramassés lors de nos promenades, premiers soldats de plomb et même des ustensiles et objets divers subtilisés, pour quelque temps, dans l’appartement, a fait cent fois le tour de la chambre, soit comme le simple véhicule paysan qu’il était, soit devenant par la magie de mon imagination, char de combat ou camion pour transport de troupes.
Il allait même jusqu’à oser sortir dans le couloir et rendre visite à la chambre voisine, suivant un itinéraire que mes fantasmes débordants peuplaient de pièges, d’embuscades et d’ennemis divers inspirés par les bribes de conversations entendues par hasard et qui parlaient de guerre. J’ai cent fois pourfendu ces fameux « teutons », seul d’abord, puis secondé par Jean-Pierre quand il fut en âge de m’accompagner dans mes aventures et mes jeux belliqueux.
Ainsi passa ce temps de mes toutes premières années, dont il ne me reste que quelques trop rares souvenirs et impressions, jalonnés de flashes, pour certains curieusement très précis. Ce que je sais surtout, c’est que j’étais parfaitement heureux, et qu’aucun souvenir fâcheux ne vient ternir l’image de cette période bénie que fut ma prime enfance.

J’allais bientôt avoir six ans, maman, très fatiguée par une grossesse dont j’ai très longtemps ignoré l’existence et qu’elle n’a malheureusement pas pu mener à terme à la suite d’une malencontreuse chute de bicyclette, restait à la maison pour garder Jean-Pierre, surnommé « Poupi » car, alors qu’on l’appelait affectueusement Jean-Pi, il réclamait toutes choses en se désignant et disant « pour Pi ».
De la même façon, ne parvenant pas à dire Jean-François, il m’appelait « Ouaoua », surnom qui m’a suivi longtemps sans que je puisse m’en défaire.
Donc, alors que c’était la soirée du 24 décembre, je pus, pour la première fois, accompagner papa pour assister à la messe de minuit.
A cette époque, nous n’avions pas de voiture.
L’église était édifiée sur un plateau surmontant la vallée du Lot d’une bonne centaine de mètres et auquel on accédait « par un chemin montant, pierreux et malaisé » comme disait ce bon Lafontaine.
Toutes les familles chrétiennes de la cité, c’est-à-dire la plupart des familles, empruntait le même chemin, et c’est en groupe compact, bravant ce froid, parfois très vif, de décembre que nous cheminions jusqu’à l’église.
La distance à parcourir était d’au moins deux kilomètres et notre groupe rejoignait bientôt le reste des habitants du village, rendus jusque-là par un autre itinéraire tout aussi malaisé.
C’était beaucoup pour mes petites jambes, non pas que je redoute la longueur du chemin, il m’arrivait très souvent de parcourir des distances beaucoup plus importantes lors de mes escapades avec Michel, mais papa et ses grandes jambes progressait très vite et j’avais d’autant plus de mal à suivre qu’il faisait très froid.
Mais bon, l’excitation de la découverte, non pas de l’église, car je la connaissais très bien, en catéchiste assidu que j’étais, mais de la cérémonie que j’imaginais grandiose, et il faut bien dire qu’elle l’était, du moins à mes yeux émerveillés d’enfant, cette excitation donc aidant, j’oubliais la fatigue.
Je dois dire aussi que la providence divine m’avait dotée d’un filet de voix cristallin, que monsieur le curé avait très rapidement repéré à la faveur des séances hebdomadaires de catéchisme. J’avais donc l’insigne honneur d’avoir été choisi pour chanter au moment de la communion.
Les personnalités du village assises aux premiers rangs sur des chaises qui leur étaient attribuées, moi dans le chœur, assis à côté de papa, près de l’harmonium et de quelques autres grandes personnes qui assuraient la musique et les chants animant la messe, la cérémonie pouvait commencer.
Une magnifique crèche occupant l’une des absides de l’église, monsieur le curé déposait religieusement l’enfant Jésus dans son berceau de paille.
L’un de mes voisins, bel homme avec une barbe de père Noël tout à fait d’actualité, entamait alors d’une vibrante voix de baryton un « Minuit chrétien » qui vous donnait la chair de poule.
Et puis ce fut à moi.
Nullement intimidé, à cet âge on n’a peur de rien, mais très ému, je chantais avec toute mon âme.
« Entre le bœuf et l’âne gris
Dors, dors, dors le petit-fi
Mille anges divins
Mille séraphins
Volent à l’entour
De ce grand Dieu d’amour
Dors, dors le petit-fi ».
Ma voix d’enfant, légère et pure, flottait sous les voutes de pierres que pas un autre son ne venait troubler. Le temps s’était arrêté. Prêtre, enfants de chœur, assistance écoutaient pétrifiés.
L’émotion était palpable, et on ne peut m’ôter l’idée que Jésus, Saint Joseph et la Vierge étaient là, bien présents.
Ma foi en Dieu est née en ces instants où l’on ne peut nier la présence divine.
Ce très beau chant s’achevait sur cette strophe à la gloire de la maternité.
« Entre les doux bras de Marie
Dors, dors, dors le petit-fi
Mille anges divins
Mille séraphins
Volent à l’entour
De ce grand Dieu d’amour
Dors, dors le petit-fi ».
Encore à présent, ce chant ou même sa simple évocation me fait monter les larmes aux yeux.
Ces larmes, elles, étaient bien réelles dans les yeux de papa et je me souviens avoir vu nombre de dames présentes sur les bancs et les chaises de l’église, s’essuyer discrètement les paupières et les joues.
La cérémonie terminée, après une visite pour admirer la crèche, la Vierge, Saint Joseph et le petit Jésus, sans oublier le bœuf et l’âne gris que je venais de si joliment chanter, il fallait regagner la maison.
Il était évidemment bien tard et j’étais épuisé, autant par la marche que par l’émotion, et c’est endormi sur les épaules de papa que j’ai fini dans mon lit sans avoir rouvert les yeux.
Je suppose que Nono fit honneur au repas de Noël préparé par Re-Chérie quant à moi, c’est le lendemain que, réveillé par Poupi qui, lui, avait bien dormi, j’ai découvert ce fameux vélo dont j’avais tant rêvé.
Noël, c’était aussi le plus souvent la neige toujours présente en couches parfois très épaisses dans ce coin reculé du Massif-central.
Que de jeux offrait cette campagne enfouie sous cette abondance blanche, cadeau récurrent de l’hiver.
Bonshommes de neige, bien sûr, mais surtout homériques batailles de boules bien tassées entre bandes rivales, pour un temps, du village et de la cité.
Chacun regagnait enfin, la journée terminée, joues et nez rougis par le froid, le coin d’une cheminée dont la bonne chaleur éloignait béatement la rigueur extérieure.
Ces bonheurs simples restent parmi les meilleurs souvenirs de mon enfance, d’autant plus qu’ensuite, hiver après hiver, je n’ai que rarement retrouvé de telles quantités de neige, promesses de tant de joies.

Ma sixième année était à présent largement entamée.
Jean-Pierre commençait tout juste à marcher et devenait de jour en jour d’autant plus intéressant que, parmi les nombreux jouets dont il était entouré, je trouvais quelques « pépites » qu’il me prêtait très volontiers pour peu que je les subtilise sans qu’il s’en aperçoive.
Il y avait en particulier toute une série de cubes en bois que j’entassais avec application dans ma charrette à bœufs avant de les trainer dans une de ces expéditions dont j’avais le secret.
Papa, une fois démobilisé, avait repris du service dans l’usine.
Seul ingénieur et donc second dans la hiérarchie de l’établissement, il avait le privilège de disposer d’un appartement de fonction dans lequel nous résidions.
Êdifié au bord du Lot, rivière qui prend sa source dans le département de la Lozère pour se jeter dans la Garonne, l’ensemble immobilier formé par l’usine et toutes ses dépendances était entièrement clos par un mur de trois ou quatre mètres de haut. L’accès s’effectuait en longeant la rivière, par une route suffisamment large pour permettre le passage des camions et par un énorme portail de bois à deux battants.
Sur la gauche, immédiatement avant d’arriver au portail, un grand bâtiment érigé sur trois niveaux à l’intérieur de l’enceinte abritait au rez-de-chaussée la conciergerie, le premier étage étant dédié aux services administratifs et de direction, quant au deuxième étage, il était entièrement occupé par notre appartement.
Juste avant la porte d’accès à l’immeuble depuis la route, un autre logement de fonction aménagé dans une dépendance d’un seul niveau accolé au bâtiment principal était habité par la famille d’un adjoint technique, troisième dans la hiérarchie de l’équipe directoriale.
Pour papa, habiter dans l’usine était loin de ne présenter que des avantages.
A l’aspect pratique qu’offrait une accessibilité directe à son bureau et à l’ensemble des installations dont il avait la charge s’opposaient les contraintes d’une totale dépendance qui le rendait mobilisable par tous à chaque heure du jour et de la nuit.
L’usine fabriquait du verre à vitre et fonctionnait vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Papa, tout fier de présenter son fils, m’avait conduit par la main dans cet univers industriel particulièrement bruyant et brûlant. Autant dire que je n’étais pas très rassuré.
La visite avait débuté par le rez-de-chaussée, où se trouvait le four, siège de la fonte du verre. Êcoutant les explications de papa auxquelles, je dois l’avouer, je ne comprenais pas grand-chose, j’avais pu observer à travers une sorte de face-à-main aux verres bleutés, de loin et incommodé par l’épouvantable chaleur soufflée par de petites ouvertures ménagées dans la paroi de briques, la couche de verre en fusion.
Cette masse, qui ressemblait à du miel incandescent, était ensuite étirée verticalement entre d’imposants rouleaux d’acier et conduite, tout en se refroidissant et donc se durcissant, jusqu’au dernier étage de l’usine, où des ouvriers l’attendaient.
Après qu’une sorte de petit chariot, dont la marche était déclenchée automatiquement, ait amorcé la découpe, d’immenses panneaux de verre encore chauds étaient saisis par un système de ventouses manœuvrées par un ouvrier, avant d’être stockés sur de grands tréteaux de bois.
A ce niveau, le métier de verrier était très dangereux. La feuille de verre cassait assez fréquemment et, malgré les protections des pieds et des mains portées par chacun, des accidents étaient fréquents et, malheureusement, parfois très graves.
Les causes de la casse pouvaient être diverses et se produire à tout moment, ce qui valait à papa d’être souvent réveillé à n’importe quelle heure de la nuit par des ouvriers affolés qui venaient chercher « monsieur l’ingénieur ».
Si cette cohabitation avec son travail présentait ces inconvénients pour papa, ce logement dans l’usine était pour moi une source inépuisable d’opportunités de jeux et de distractions.
Malgré des interdictions paternelles proférées sans grande conviction, je faisais souvent des incursions dans les niveaux inférieurs.
Les secrétaires m’adoraient et cultivaient ma passion pour les machines à écrire, en me laissant, à loisir, couvrir des pages blanches de caractères divers, alignés de façon aléatoire et auxquels, faute de savoir encore lire ou compter, je n’attachais aucun sens. J’exhibais fièrement auprès de maman ces œuvres qui finissaient immanquablement dans les toilettes, suspendues à une ficelle après avoir été coupées en quatre.
Je rendais aussi souvent visite aux gardiens qui occupaient la conciergerie au rez-de-chaussée, admirant au passage les énormes camions qui entraient ou sortaient.
La proximité de la rivière et la campagne toute proche complétaient agréablement l’incomparable éventail des possibilités qui m’étaient offertes.
Avec le recul des ans, je suis impressionné par le degré de liberté dont je disposais. La surveillance maternelle étant peu contraignante, je pouvais très facilement m’échapper et me rendre à l’extérieur, dans la campagne ou au bord du Lot.
Certes, j’avais appris très tôt à nager, je devrais dire « nageoter », mais tout de même !!!
J’imagine mal, de nos jours, mes petits-fils jouir d’une telle liberté sans que leurs parents meurent de frayeur. Mais bon !!! Comme je savais, par expérience, que mes bêtises, si j’en commettais, seraient impitoyablement sanctionnées, papa ayant la fessée facile, je faisais très attention et restais relativement prudent.
Jean-Pierre étant encore tout petit, j’étais libre d’aller seul à ma guise.
Et je m’étais fait quelques copains.
Du côté opposé à la rivière par rapport à l’ensemble formé par l’usine, avait été construite une cité dans laquelle logeaient la plupart des ouvriers de la verrerie.
Dans mon souvenir, c’était une enfilade de quelques dizaines de maisonnettes jumelles accolées dos à dos, précédées d’un petit jardin entre deux voies de distribution. Une placette aux deux extrémités permettait de faire le tour de l’ensemble auquel on accédait depuis la route reliant l’usine à la route départementale passant quelques centaines de mètres plus loin.
Les familles d’ouvriers étaient en général nombreuses et représentaient pour moi un superbe vivier de copains potentiels.
Je crois me rappeler que l’un d’entre eux s’appelait Michel et était très vite devenu mon ami.
La cité, comme on avait coutume de la nommer, avait également pour le petit garçon que j’étais, une foule d’attraits.
Tout d’abord, sur la placette côté entrée, en tête de l’alignement des maisons, il y avait une sorte d’épicerie-bazar tenue par Réjane, une dame que je trouvais très gentille et qui me semblait incroyablement vieille.
Ce magasin qui contenait des trésors en jouets, bonbons et friandises diverses et effroyablement tentantes.
On trouvait, entre autres merveilles, des billes sucrées qui changeaient de couleur au fur et à mesure qu’elles fondaient en les suçant, des rubans de réglisse enroulés autour d’un petit bonbon en forme de boule de couleur vive, et surtout, ce que j’adorais tout particulièrement, des petits bâtonnets de bois d’environ quinze centimètres de long, que l’on mastiquait interminablement pour en extraire du jus de réglisse, délicieusement gouteux et sucré.
Il y avait aussi ces petits boitillards métalliques multicolores d’un ou deux centimètres de diamètre, chers au chanteur Renaud et appelés « Cocos Boer », que l’on mâchouillait avec application, notre salive diluant peu à peu la poudre de réglisse contenue à l’intérieur.
J’ai un souvenir tout particulier d’une de ces petites boites.
Réjane, dans son rôle d’épicière, fournissait à tout le quartier la nourriture et les marchandises de première nécessité.
J’étais souvent chargé d’aller chercher chez elle notre pain quotidien et quelques provisions, et il m’arrivait parfois de distraire discrètement de la monnaie rendue, une ou deux piécettes de quelques centimes pour une de ces friandises tellement tentantes.
Un jour donc, chargé de mission, j’effectuais l’acquisition d’une de ces petites boites que je commençais tranquillement à suçoter en reprenant le chemin de la maison.
Soudain, un mouvement de langue maladroit provoqua un réflexe de déglutition et, affolé, j’avalais le boitillard et tout son contenu. Je me demande encore comment un objet aussi volumineux a pu franchir mon petit gosier, ça n’a d’ailleurs pas été sans difficultés, j’ai bien cru étouffer, mais finalement, c’est passé et la petite boite a fini dans mon estomac.
J’étais pétrifié et terrorisé, prenant mes jambes à mon cou, je me précipitais à la maison pour raconter entre deux sanglots, ma mésaventure à maman.
Cette dernière, encore plus terrorisée que moi, me descendit dare-dare à l’infirmerie de l’usine, au rez-de-chaussée du bâtiment, et l’infirmière, une fois mise au courant du fâcheux incident, se montra rassurante.
Selon ses dires, le boitillard qui ne comportait aucune aspérité risquant d’agresser mes intérieurs finirait sans encombre dans la cuvette des toilettes d’ici quelques jours.
Toutefois, maman tenait à s’en assurer.
J’approchais de l’anniversaire de mes six ans et j’avais depuis longtemps abandonné le pot de chambre afin, comme un adulte, de m’exécuter quotidiennement sur la grande cuvette des toilettes, malgré parfois quelques problèmes d’équilibre.
Je dus pourtant et pour satisfaire la curiosité maternelle revenir à l’usage du récipient en faïence qui n’était plus utilisé depuis peu que par mon petit frère.
Ce fut en vain et au bout d’une semaine le boitillard n’avait toujours pas réapparu. Maman s’est demandé longtemps où il avait pu passer, s’interrogeant probablement sur mes capacités digestives susceptibles de faire disparaitre ainsi ces quelques grammes de métal.
Je n’ai jamais avoué à ma pauvre mère qu’en fait, à la suite d’un raid effectué avec mon ami Michel dans un verger voisin, une ventrée de cerises m’avait contraint quelques heures plus tard à baisser culotte derrière un buisson, là où il est plus que probable, j’avais abandonné l’intrus qu’elle espérait désespérément voir reparaitre.
Outre les remontrances et les interdictions parentales qui ont évidemment fait suite à cette aventure, il est aisé de comprendre que cet épisode ait définitivement contribué à me guérir de mes envies futures de « Coco Boer ».

Entre autres attraits qu’offrait la cité ouvrière, un évènement périodique exerçait sur moi une considérable fascination.
De façon systématique, plusieurs familles regroupaient leurs déchets pour nourrir et engraisser de superbes cochons auxquels, malgré les interdictions paternelles, accompagné de Michel et de quelques autres gamins de notre âge, je rendais souvent visite.
Régulièrement, généralement deux fois par an, au début de l’automne et à la fin février, avait lieu un évènement qui excitait follement nos curiosités enfantines et exerçait sur moi un curieux mélange d’intérêt et d’effroi, l’exécution du cochon.
Qui n’a jamais entendu les hurlements d’un cochon qu’on agresse ne peut pas imaginer ce qui suit.
Tenus à distance par le cercle des spectateurs adultes, nous assistions à la scène.
La pauvre bête que nous avions, au fil des mois, vu grandir et s’étoffer, était extraite manu militari de son enclos.
Tirée par une corde qu’on lui avait passé autour d’une patte arrière, jusqu’au centre de l’aire prévue pour l’opération, un énorme coup de masse lui était asséné sur la tête entre les deux yeux.
Sa centaine de kilos hissée inanimée sur une sorte de chevalet, le boucher, armé d’un couteau pointu et consciencieusement aiguisé, tranchait sans attendre la gorge du cochon, le sang giclant et s’écoulant à gros bouillons dans un seau tenu par une femme qui battait le tout énergiquement avec un fouet.
Entre autres accessoires apportés par le boucher, un énorme baquet en bois était disposé à coté du chevalet et le corps du cochon basculé à l’intérieur.
Copieusement arrosé d’eau bouillante, brossé énergiquement, les poils soigneusement raclés au couteau, le pauvre cochon finissait ensuite accroché par les pattes arrières et hissé, écartelé et la tête en bas, sur une échelle.
Le boucher, toujours armé de son fameux couteau, lui ouvrait alors le ventre pour en extraire l’intérieur.
Déjà passablement révulsé par la mise à mort et la saignée, c’est à ce moment-là qu’en général je m’enfuyais, écœuré par ce spectacle sanglant et aussi et surtout par l’odeur très forte de sang et d’excréments émanant de la scène.
C’est de toutes manières la fin de l’épisode, la carcasse éventrée restant suspendue et exposée durant plusieurs heures avant d’être dûment découpée et réduite en morceaux divers et, il faut bien le dire, succulents jambons, filets, boudins, saucisses et autres accessoires charcutiers.
C’est en fin de journée que, généralement, introduit dans la place par l’un de mes copains dont les parents faisaient partie de la copropriété porcine, j’accédais à la cuisine où diverses préparations issues des sous-produits du cochon étaient en cours.
J’ai un souvenir inoubliable du gout délicieux et jamais retrouvé des grosses tartines de « fritons » dégoulinantes de graisse chaude, dévorées dans cette cuisine.
Ce souvenir ne me fait certes pas oublier non plus les fessées mémorables que mes rentrées tardives de ces expéditions interdites provoquaient immanquablement.
C’était la rançon à payer et cela ne m’a jamais dissuadé de recommencer.

Pour le Noël de mes presque six ans, ce fameux bonhomme barbu sur lequel, longuement et régulièrement briffé par mon copain Michel, je commençais à avoir des doutes sérieux, ce fameux bonhomme donc, avait eu la merveilleuse idée de m’apporter une bicyclette.
Tout petit qu’il était, ce vélo avec ses deux roulettes arrières me paraissait bien gros pour pouvoir être introduit jusque là par la cheminée.
Ce Père-Noël, contrairement à la légende, ne pouvait donc passer que par la porte et je me promettais, l’année suivante, de rester éveillé pour pouvoir le surprendre.
En attendant, sautant du lit tôt le matin, j’avais découvert émerveillé ce superbe vélo rouge et rutilant dont j’avais toujours rêvé.
Quelques essais, évidemment très limités et heurtés, dans le salon et dans le couloir, avaient très vite conduit papa, réveillé par le bruit, à proférer une interdiction formelle d’utilisation d’un cycle dans l’enceinte de la maison.
Contre une promesse de petit déjeuner et ma toilette rondement expédiés, j’avais obtenu l’engagement paternel d’une sortie commune pour de premiers essais assistés dans la rue.
Cette dernière, habituellement très peu passante, était évidemment déserte en ce jour de fête et donc libre de recevoir mes premiers coups de pédales, en cette froide matinée de Noël.
Suivi par papa trottinant, j’entrepris une première ligne droite, puis une seconde.
M’enhardissant, je pédalais de plus en plus vite, distançant papa qui finit, essoufflé, par cesser de trotter en prodiguant à distance conseils et ordres de tourner et de revenir.
Enivré par la vitesse, je l’écoutais d’une oreille de plus en plus distraite et, de moins en moins attentif à ce que je faisais, virant trop près du petit talus qui bordait le Lot en contrebas, ma roue avant mordant sur l’herbe et ainsi freinée brutalement, je passais par-dessus le guidon.
Heureusement, le talus ne donnait pas directement dans la rivière. Le vélo restant sur la route, après avoir dévalé le talus en roulant, je me retrouvais assis et pleurant à chaudes larmes sur la berge gelée.
Papa affolé avait sauté en bas du talus, découvrant soulagé que je fusse indemne.
Ainsi finirent ces premiers essais et je rentrai piteusement à pied à la maison, tenu fermement par la main de papa qui portait le vélo de l’autre.
Ce n’était que partie remise, ce premier incident vite oublié, je devins très vite un cycliste confirmé, avec puis sans roulettes, et je me mis rapidement à sillonner fièrement le quartier dans tous les sens.
Mes expéditions cyclistes débutaient toujours en partant de la conciergerie à proximité de laquelle mon petit vélo était remisé.
Les roulettes stabilisatrices de mes débuts n’étant plus qu’un lointain souvenir, j’avais très vite entrepris des travaux de personnalisation de l’engin dont l’une, à mes yeux essentielle et née des conseils amicaux du concierge de l’usine, consistait en l’adjonction d’un petit bout de carton plié et fixé à cheval sur l’une des fourches arrière du cadre, à l’aide d’une pince à linge chipée sur l’étendage de la salle de bains.
Le résultat de ce montage produisait, en roulant et en frottant sur les rayons de la roue, un réaliste et délicieux bruit de pétarade me donnant l’impression de chevaucher une motocyclette.
J’ai déjà évoqué l’existence d’un petit logement de fonction au rez-de-chaussée de l’immeuble où nous habitions.
Ces quatre pièces étaient occupées par un jeune ménage, lui, ingénieur d’origine anglaise ayant pour mission de seconder Papa.
Le couple avait deux petites filles d’environ deux et trois ans, que je voyais souvent jouer dans la cour sous la surveillance de leur mère.
Au tout début du printemps, je fus très intrigué par des quintes de toux fréquentes, en provenance du rez-de-chaussée, quintes qui se prolongeaient de façon interminable pour finir en apothéose par une sorte de râle victorieux assez semblable au chant des coqs des divers poulaillers de la cité.
Maman interrogée m’expliqua que les petites anglaises avaient contracté la coqueluche, maladie très pénible car elle provoquait ces fameuses quintes qui donnaient aux malades la sensation d’étouffer.
Cette affection étant très contagieuse, les recommandations maternelles étaient de se tenir à l’écart autant que possible pour éviter d’être attaqués par les microbes, très méchantes petites bêtes qui sautaient sur tous les enfants qui passaient à leur portée, pénétrant dans le corps par le nez et la bouche, pour leur refiler cette fameuse coqueluche.
Heureusement, j’avais mon vélo.
J’avais soigneusement préparé la manœuvre d’évitement qui devait me préserver de toute tentative d’agression microbienne.
Une fois passée la porte de la conciergerie de l’usine, j’enfourchais mon engin et, respiration bloquée, je pédalais comme un fou, passant aussi loin que possible de la porte d’accès au logement des petites malades, pour finir par m’arrêter et poser le pied quelques dizaines de mètres plus loin, au bord de la syncope, mais convaincu d’être sauvé et d’avoir échappé à ces sales petits microbes.
Cher premier petit vélo, en ais-je fait des courses sur les chemins de campagne, me hasardant parfois, malgré l’interdiction formelle, à oser quelques longueurs sur la route départementale goudronnée.
Que de « gamelles » et que de genoux et de coudes écorchés, mais quelle impression grisante de vitesse quand, les pieds levés pour éviter les pédales qui tournaient trop vite, je dévalais la centaine de mètres d’un petit talus qu’on aurait dit mis là exprès.
Ce pauvre petit vélo a bien mal fini son existence.
Un jour, en jouant dans la cour de l’usine, je l’abandonnais bêtement, couché par terre, pour un « petit pipi » urgent.
A mon retour, la roue arrière d’un camion en manœuvre l’avait réduit à l’état de galette irréparable.
J’étais effondré et à nouveau ravalé à l’état de piéton, ulcéré d’entendre qu’au lieu de me plaindre, les commentaires maternels étaient du genre : « tant pis pour toi, tu n’avais qu’à faire attention à tes affaires et ne pas les laisser trainer n’importe où et n’importe comment ».
Comme si l’urgence de ce « petit pipi » m’avait laissé le temps de remiser ma machine !!! C’était ça ou « pipi culotte ».
Comment une grande personne censée peut-elle ne pas avoir à ce point le sens des priorités ?
Quant à Papa, ce fut pire. J’appris en l’écoutant que, non seulement « il n’était pas question qu’un nouveau vélo vienne remplacer celui-là », mais de surcroît, « qu’il était dorénavant interdit de jouer dans la cour de l’usine, où je risquais à tout moment de subir le sort de ma bicyclette ».
C’était sans appel, ce qui ne m’empêchera pas, plus tard, de me hasarder à nouveau sur ce terrain de jeux plein de possibilités.

Pour la rentrée d’octobre de l’année de mes six ans, je fis la connaissance de l’École de la République que j’intégrais particulièrement curieux et très intimidé.
Ce siège de l’apprentissage du savoir, comme dans la plupart des villages de France, était intégré à un grand bâtiment abritant, en son centre, la Mairie, et de part et d’autre l’École des Filles et celle des Garçons.
Si mes souvenirs sont exacts, à Boisse-Penchot, en raison de la topographie du lieu, les deux établissements scolaires étaient situés sous la Mairie.
On accédait à chaque cour d’école par une large rampe, à gauche et à droite de l’Hôtel de Ville, la classe unique pour chaque sexe donnant de plain-pied sur cette cour, fermée par des murs imposants et par un très grand préau.
Contre le mur mitoyen entre filles et garçons s’alignaient les malodorantes logettes fermées par des portes dont la peinture écaillée s’ornait des lettres WC, qui ont certainement, de tous temps, été les premiers rudiments d’alphabet des écoliers débutants.
Très curieusement, j’ai peu de souvenirs de ces années scolaires.
Nous avions un maître dont j’ai totalement oublié le nom. Il portait, comme chacun de ses élèves, une blouse grise et je crois me rappeler que, malgré sa bonhomie et sa gentillesse, monsieur l’instituteur m’impressionnait beaucoup.
Il officiait dans une salle où, telle que je la revois et malgré une peinture générale vert-olive, tout était gris.
Ce n’était pas une question de manque de propreté, les grands seaux pleins de dilution d’eau de Javel qui permettaient de laver, non seulement le plancher, mais d’une façon générale, tout ce qui aurait pu véhiculer poussière, microbes et poux, garantissaient une très bonne hygiène dans toute la pièce.
Je garde toujours en tête cette odeur « de propre », mélangée à d’autres effluves et tout particulièrement ceux de l’encre et du papier neuf.
Des fenêtres immenses donnaient sur la cour et sur les murs trônait l’inévitable et superbe carte de France, ainsi que l’immense tableau noir, derrière un grand bureau juché sur une estrade et d’où l’enseignant, dominant la classe, dispensait son savoir.
Le chauffage était assuré par un gros poêle en fonte qui trônait au milieu de la pièce, d’où sortait un interminable tuyau, d’abord verticalement jusqu’à une distance raisonnable du plafond pour rejoindre ensuite horizontalement le mur le plus proche où il disparaissait.
Par la porte avant de ce poêle, notre maitre enfournait régulièrement d’énormes quantités de « boulets » de charbon, sous-produits moulés à partir de poussière de houille en provenance des mines voisines de Decazeville.
Ce combustible, très calorique, brulait très bien et je revois encore la teinte rouge cerise que prenait parfois le tuyau près de la sortie d’un poêle qui ronflait comme un beau diable, sous l’œil quelque peu inquiet de monsieur l’Instituteur qui devait se demander s’il n’avait pas trop « chargé la bête », et s’il ne fallait pas appeler les pompiers.
Nos bureaux, conçus pour recevoir deux élèves, étaient constitués d’un banc fixe et de tablettes formant écritoires et couvercle de casiers où nous entassions livres, cahiers, ardoises et accessoires divers, règles, crayons, gommes, porteplumes et tout un tas de petits trésors personnels.
La bande supérieure horizontale, sur laquelle étaient solidement vissées les charnières de tablettes, était rainurée pour servir de plumier et deux trous ronds recevaient des encriers en faïence, un pour chaque écolier.
L’état de nos doigts, abondamment tachés d’encre violette, témoignait de notre inexpérience dans l’utilisation des plumes « Sergent-Major » confiées à nos petites mains débutantes pour des pages d’écriture sur des cahiers pré-lignés.
J’adorais apprendre et faisais bien sûr largement profiter papa et maman de mes connaissances sans cesse plus étendues puisées dans ce qui était, à cette époque bénie, les bases d’une éducation immuablement fixée dans le cadre de l’école publique gratuite et obligatoire de Jules Ferry et qui garantissait, en fin d’études primaires, à toutes les jeunes têtes, de savoir parfaitement lire, écrire et compter.
J’exhibais avec fierté la collection de bon-points que me valaient mes progrès, auprès de mes parents, bien sûr, mais également et surtout auprès de mon petit frère qui, il faut bien le dire, du haut de ses presque trois ans, s’en moquait éperdument.
Une des activités que nous proposait le cher homme à blouse grise me plaisait tout particulièrement. Elle consistait à utiliser les couvertures de cahiers usagés, de couleurs diverses dans des tons pastels, pour nous initier au tissage.
Une page de couverture d’un cahier de couleur bleue, par exemple, était préparée par l’instituteur qui découpait à l’aide d’une règle et d’un couteau bien aiguisé des fentes régulières, tous les centimètres, en prenant soin de ne pas entamer la périphérie de la feuille.
Ce canevas ainsi préparé nous était confié avec une série de bandelettes découpées dans d’autres couvertures de cahier, également d’un centimètre de large et de couleurs différentes de celles du canevas.
La tâche qui nous était alors demandée consistait à entrelacer les bandelettes avec la trame du canevas, en passant à travers les fentes prédécoupées pour obtenir un tissage bicolore ou multicolore suivant le choix que nous faisions des bandelettes.
Nous trouvions évidemment ravissants ces petits ouvrages qui finissaient bien entendu, dans l’assiette des mamans très émues, le jour de la fête des mères.
Je sais que l’un de ces tissages est resté très longtemps entre les pages d’un dictionnaire et, encore aujourd’hui, je regrette profondément de ne jamais l’avoir retrouvé, pas plus que n’ont été conservées, et c’est bien dommage, la moindre trace ou photographie de ce lieu et des activités qui représentent pourtant une part fondatrice de la personnalité de l’enfant que j’étais.
Une fois par semaine avaient lieu les séances de sports et de gymnastique.
Sous l’immense préau, solidement fixés à la poutre maitresse de la toiture, un certain nombre d’agrès attendaient nos petits bras pas encore très musclés pour divers exercices, dont l’un d’entre eux m’apparaissait comme particulièrement barbare et irréalisable.
C’était une corde lisse, épaisse comme mon poignet et qui, tel un serpent redoutable, déployait ses quatre mètres ou presque jusqu’au ras du sol où elle se terminait par un solide nœud.
Pour certains de mes camarades, Michel notamment, l’exercice était une simple formalité. Tels des petits singes, en moins de temps qu’il n’en faut pour l’écrire, ils agrippaient l’engin et en quelques brassées grimpaient, touchaient la poutre d’une petite tape amicale et se laissaient glisser jusqu’au sol.
Ça paraissait tellement simple et magique.
Pour moi ainsi d’ailleurs que pour beaucoup d’autres, après une interminable station les pieds posés sur le nœud du bas de la corde, vigoureusement encouragés par notre maitre, nous entamions une laborieuse ascension, corde enroulée autour des jambes et coincée tant bien que mal entre les cuisses, les bras tétanisés par nos efforts de traction.
Au terme d’à peine plus d’un mètre, nous devions nous avouer battus et retombions piteux, dans la poussière, au pied de notre instituteur.
Pourtant, séance après séance, de semaine en semaine, centimètre après centimètre, le sommet se rapprochait.
Jusqu’au jour où, dans un effort ultime, je réussissais enfin à accrocher cette maudite poutre, avant de tout lâcher et de tomber telle une loque dans les bras sauveurs du maitre, heureusement vigilant et toujours présent au pied de la corde.
Partant de cette première demi-victoire, de semaine en semaine, l’exercice devint de plus en plus facile et, à quelque temps de là, je faisais partie du groupe des petits singes toisant avec commisération ceux qui s’obstinaient à rester en bas.
Pour me rendre à l’école, un bon quart d’heure de marche était nécessaire. Après avoir fait le tour de l’usine, en suivant la route qui longeait le mur de clôture, immédiatement après la cité ouvrière, mon cartable sur le dos, je coupais à travers champs jusqu’à rejoindre la route départementale que je suivais durant quelques centaines de mètres pour arriver jusqu’au bâtiment mairie-école.
C’était simple en apparence et pour ainsi dire sans danger pour l’enfant que j’étais.
Seulement voilà, la campagne et les champs recèlent tout un tas de choses passionnantes. Ce qui devait en principe nécessiter un bon quart d’heure pouvait soudain, en l’absence de montre et par la simple présence virevoltante et magique d’un papillon qui lui, n’avait pas le souci de se rendre à l’école, se muer, malgré mes cavalcades de dernières minutes, en deux voire trois fois plus de temps.
Il est certain que si ma scolarité de l’époque s’est montrée quelque peu brillante, ce n’est certes pas à la ponctualité qu’elle le doit.
En réalité, j’étais plutôt bon élève.
J’en veux pour preuve cette émouvante découverte faite à la faveur de notre déménagement depuis notre maison de Burçin vers ce nouveau et probablement ultime logement provençal de Chateauneuf de Gadagne.
Dans le fin-fond d’un vieux carton extrait du grenier burçinois, j’ai fait l’étonnante découverte d’un petit livre au nom « d’Ali-baba et les quarante voleurs » premier prix de travail décerné à l’élève Jean-François Bertrand et généreusement offert par la mairie de Boisse-Penchôt.
Il y a toutefois une période où non seulement j’arrivais à l’heure, mais parfois même en avance.
Immédiatement après la guerre, une grande quantité de prisonniers allemands ont été dispersés sur l’ensemble du territoire français, où ils étaient mis à la disposition des collectivités ou des industriels pour des travaux obligatoires.
Un groupe d’entre eux avait été affecté à la verrerie de Saint-Gobain où nous nous trouvions et nous avions vu arriver un beau jour, sous la conduite de la maréchaussée, quelques dizaines de pauvres diables vêtus de tenues brunâtres sales et froissées, portant inscrites en grosses lettres noires dans le dos KG, kriegsgefangener, c'est-à-dire prisonnier de guerre en allemand.
Logés dans l’usine, ils furent répartis dans les divers secteurs de l’entreprise.
La plupart d’entre eux ne parlaient que très peu et très mal le français, mais ils s’adaptèrent en définitive assez vite.
L’un d’entre eux s’appelait Frenz. Grand garçon athlétique et blond, âgé d’une trentaine d’années, ancien chauffeur dans l’armée allemande, il avait été affecté à la logistique quotidienne de l’usine et, au volant d’une grosse camionnette de type Dodge, faisait la navette entre la ville voisine de Decazeville, la poste, la gare la plus proche et l’usine.
Il s’était pris d’affection pour moi qui, je le suppose, devait lui rappeler un fils resté en Allemagne.
J’avais soigneusement noté l’heure matinale de la première sortie de Frenz pour se rendre à la poste. Comme par un heureux hasard, il démarrait ponctuellement environ une demi-heure avant la rentrée en classe.
Je pris donc l’habitude de quitter la maison un peu avant son départ pour me trouver sur son trajet quelques centaines de mètres plus loin.
Le reste est facile à comprendre Frenz me repérait immédiatement, et c’est fièrement juché sur le fauteuil passager du Dodge que j’arrivais devant l’école, pour une fois à l’heure et sous le regard envieux de mes petits copains.
Ceci n’eut bien sûr qu’un temps.
Papa, mis au courant, intervint assez vite et j’eus bientôt l’interdiction d’utiliser les services du personnel de l’usine pour me rendre à l’école. Et puis, quelque temps après, à mon grand chagrin, Frenz libéré et démobilisé partit rejoindre femme et enfants en Allemagne.
Je n’ai plus jamais entendu parler de lui.

Chaque année, peu avant les grandes vacances, avait lieu la fête de l’école.
Les deux cours de récréation, celle des filles et celle des garçons, étaient transformées en kermesse.
De nombreux stands étaient érigés tout autour des cours et sous les préaux. Montés et tenus par des parents volontaires, encadrés par les maitres et maitresses ainsi que quelques employés municipaux et certains membres du conseil municipal, ils accueillaient toute l’après-midi les familles au grand complet.
Parmi les stands de jeux proposés, je me souviens qu’on trouvait :
- le « casse-boites », pour lequel il fallait, doté d’une provision de cinq balles de tissus bourrées de son et confectionnées tout au long de l’année par les élèves filles, démolir à une distance d’environ trois mètres, des pyramides de vieilles boites de conserve, dressées sur des bancs.
- la « pétanque » consistant à jeter avec précision trois boules du même nom dans le cercle formé par un vieux pneu posé à plat, à quelques mètres de là.
- les épreuves sportives regroupées sous le préau, saut à l’élastique, en longueur, grimpé à la corde, celle lisse d’ordinaire étant remplacée par une corde à nœuds.
Le succès à ces jeux était sanctionné par des bon points qui, cumulés, donnaient droit à des lots distribués en fin de journée, conjointement au palmarès de la grande tombola organisée durant la semaine précédente, les carnets de tickets confiés à tous les élèves qui avaient en charge de les vendre.
Je laisse imaginer la véritable séance de racket qui s’en suivait auprès des parents et amis de chaque famille.
Un stand, surtout fréquenté par les grands adolescents et les adultes, offrait l’occasion de s’exercer au tir à la carabine, sur des cibles en carton, fixées sur un panneau de bois, lui-même dressé contre un mur, à environ trois mètres d’une rangée de tables.
Ce stand, évidemment très dangereux, était tenu par des adultes, dûment briefés au préalable, deux tireurs seulement étant autorisés à tirer conjointement un maximum de cinq balles.
Je me souviens très nettement de la malheureuse journée durant laquelle est survenu sur ce stand un épouvantable accident. Deux des candidats au tir ayant reçu leur lot de balles et le tir s’étant déroulé normalement, l’un des tireurs, plus lent que l’autre, avait engagé sa cinquième balle dans la culasse et, épaulant, s’apprêtait à tirer.
Le chargé du stand, n’ayant pas ou mal compté les balles tirées, s’est imprudemment avancé.
Il a reçu la balle en pleine tête et, malgré les efforts d’un médecin, aussitôt accouru, il n’a pu être réanimé.
Je n’étais pas très loin et, au milieu d’une foule atterrée et en pleurs, devant la détresse de l’auteur du tir, très rapidement emmené par le garde-champêtre, j’étais pétrifié, confronté pour la première fois à la réalité de la mort.
Inutile de dire que ce stand a été banni les années suivantes et à tout jamais de la journée de kermesse des écoles.
J’ai longtemps fait des cauchemars en repensant à ce dramatique épisode, qui m’a conduit pendant des mois à me réfugier dans le lit de mes parents, pelotonné dans les bras rassurants de maman.
Loin de cet affreux souvenir et heureusement plus joyeusement me revient en mémoire la soirée qui, suivant la kermesse, nous voyait tous élèves réunis offrir à nos familles le spectacle soigneusement préparé tout au long de l’année sous la houlette des maitres et maitresses.
Pour ces scénettes, nous étions déguisés, les mamans ayant été mises à contribution pour la confection de costumes divers destinés à camper les personnages que nous étions censés représenter.
Une année pour cette occasion, j’avais pour partenaire de scène un de mes bons amis, Jean-Louis, le fils du directeur de l’usine de Saint-Gobain, monsieur Bonjour.
Des photos prises alors en attestent nous campions des « jolis tambours qui revenaient de guerre ».
Maman nous avait confectionné un costume coloré, rouge, vert et jaune, papa mis à contribution ayant fabriqué en carton gainé de soie rouge un superbe couvre-chef en forme de cône inversé, la base étant munie d’une visière et d’une jugulaire qui l’arrimait solidement à mon menton.
J’étais si content de moi que j’en avais pratiquement oublié mon texte.
Heureusement, mon « souffleur » de maître n’était pas loin.
Nous étions tellement fiers de nos déguisements que nous avons paradé toute l’après-midi et nous déshabiller fut un crève-cœur.

Toute usine de fabrication de verre à vitre utilise obligatoirement les services d’une caisserie, là où des menuisiers, généralement peu qualifiés, fabriquent sur mesure les caisses ou chevalets destinés à recevoir les feuilles de verre avant leur transport.
Notre caisserie stockait ses réserves de planches de bois sur un vaste espace, partiellement couvert et situé le long du bâtiment administratif dont nous occupions le dernier étage.
Au rez-de-chaussée, au pied de la cage d’escalier qui desservait les divers niveaux de l’immeuble, un couloir traversant permettait, soit de sortir côté extérieur, soit d’accéder dans l’usine, justement dans cette zone de stockage du bois.
Le personnel ne venait sur les lieux que pour les approvisionnements matinaux de l’atelier de menuiserie, une ou deux fois par mois, pour renouveler les stocks et combler les vides laissés par les ponctions quotidiennes de l’atelier.
Le reste du temps, nous étions, mon frère et moi, relativement tranquilles. Jean-Pierre, qui avait à peine trois ans, suivait le « petit chef » que j’étais comme son ombre.
Nous avions soigneusement observé les méthodes de stockage utilisées par les ouvriers lors des livraisons de planches.
Sur une série de briques posées à plat et qui servaient de plots de fondations, un premier réseau de planches était disposé en carré.
Sur ce premier réseau, perpendiculairement aux planches qui le constituaient, un platelage de planches jointives était placé pour former une base en forme de plancher carré.
Une couche complémentaire venait alors, perpendiculairement à la précédente, et ainsi de suite pour atteindre des hauteurs qui nous semblaient vertigineuses mais qui dépassaient rarement trois mètres.
Sur ce modèle donc, dans un coin un peu à l’écart, après avoir soigneusement dégagé l’espace nécessaire, nous débutions notre propre édifice.
C’était absolument épuisant, chaque planche de résineux, souvent peu sec, pesait un poids respectable pour nos petits bras pas très musclés.
Mais nous étions ravis de pouvoir, petit à petit, dominer le monde du haut du plancher supérieur que nous ne pouvions que très difficilement et aux prix d’efforts surhumains élever au-delà d’un bon mètre.
Malheureusement, les ouvriers faisaient peu de différence entre notre construction et les constructions voisines, aussi nous arrivait-il fréquemment de retrouver notre superbe édifice bâti à grand peine et abandonné le soir, démoli partiellement ou entièrement par l’équipe d’approvisionnement du matin pour les besoins de la menuiserie.
Et c’est sans nous décourager que nous rebâtissions, avec chaque fois la ferme volonté d’aller un peu plus haut que la fois précédente.
C’est peut-être à ces constructions éphémères que je dois cette vocation d’architecte, venue quelques vingt ans plus tard.
Un autre attrait de cette réserve de bois résidait en la présence, tout prèt de l’atelier de menuiserie, d’un tas de chutes d’une infinité de dimensions, destinées à finir dans une chaudière et dont nous subtilisions de pleines brassées pour notre usage personnel.
A l’aide d’un marteau pris dans l’outillage paternel et de quelques clous récupérés un peu partout, nous construisions une foule d’engins plus ou moins difformes et conçus au gré de notre imagination, mais auxquels, certainement, les jouets de plastique de maintenant n’auraient rien eu à envier.
L’année de mes sept ans, ce fameux Père-Noël auquel j’avais de plus en plus de mal à croire m’avait apporté une boite de Mécano pour débutants.
Il est difficile d’imaginer la quantité d’ouvrages que j’ai pu réaliser avec un si petit nombre de pièces, de vis et de boulons, tout ceci avec l’aide de papa, au début, puis seul ensuite.
Parmi toutes ces merveilles, j’avais réussi à construire une grue, avec poulie en bout de flèche et manivelle dont l’axe, garni de laine donnée par maman, avait une longueur suffisante pour franchir les trois niveaux de l’immeuble en empruntant le vide central de la cage d’escalier.
Jean-Pierre dans le couloir du rez-de-chaussée et moi sur le palier du dernier étage avons passé des journées entières à remonter, grâce à cette fameuse grue, des kilos de ces chutes de bois récupérées dans notre petite réserve.
Véhiculés par mon charriot à bœufs, ces transports de bois finissaient dans la cuisine où, pour le plus grand plaisir de maman, ils servaient de buchettes pour allumer le feu de la cuisinière.
Avec les plus gros morceaux que nous récupérions, liteaux ou planches, nous avions également entrepris la construction d’une petite cabane, dans un coin reculé et discret, contre le mur de clôture de l’usine.
Nous avons passé des heures à bâtir cet abri et bien davantage d’heures encore à y jouer, lire, manger les tartines de nos gouters, avec un incomparable sentiment d’isolement, de tranquillité et de sécurité que je n’ai jamais pu retrouver depuis.

Comme je l’ai déjà dit, nous habitions au bord du Lot.
Il suffisait, en sortant de l’immeuble, de traverser la route d’accès à l’usine pour se retrouver au sommet du talus qui dominait de quelques mètres la berge de la rivière.
Tante Thétèse et Tonton Milien profitaient des vacances d’été pour nous rendre visite.
Tonton Milien, comme je l’ai déjà dit, aimait passionnément la pêche à la ligne qu’il pratiquait de façon quasi-professionnelle.
Dès qu’il pouvait quitter sa cuisine et ses fourneaux, il s’éclipsait sur les bords de la rivière la plus proche. Au Coteau c’était la Loire, chez nous c’était le Lot dont il connut rapidement les moindres trous, gravières et autres lieux propres à remplir ses filoches et paniers.
Très vite, alors que du haut de mes six ans, je devenais un élève possible, il entreprit de m’initier en m’offrant tout d’abord une canne et tous les accessoires nécessaires et en m’emmenant avec lui sur les bords de l’eau.
J’ai un souvenir particulièrement vif de la sensation que m’a causée ma première prise. Cette pauvre petite chose frétillante de quelques dizaines de grammes pendouillant au bout du fil de ma ligne m’a causé une émotion telle que, depuis, aucune autre capture, si belle soit-elle, n’a pu la dépasser.
Tonton Milien, ce jour-là, m’a transmis une passion qui m’a accompagné durant toute mon existence et m’accompagne encore, même si, à mon grand regret, je ne la pratique plus beaucoup.
En tous cas, à cette époque, je faisais tout pour la pratiquer et le plus souvent possible.
Mes cannes, toutes montées, prêtes à l’usage et stockées derrière le portail de l’usine, je m’échappais de la maison à la moindre occasion et, traversant la route, je dévalais le talus jusqu’au bord de l’eau.
J’avais au préalable fait provision de vers ou d’asticots et je trempais mon fil et son petit bouchon rouge dans un trou que j’avais repéré depuis longtemps et au fond duquel je voyais parfois scintiller le ventre argenté de quelques petits poissons.
Je n’étais pas trop maladroit et je rapportais souvent ma petite friture à maman qui m’en faisait mille compliments.
J’étais malgré tout un peu frustré, mes prises ne dépassant que rarement quelques dizaines de grammes.
Aussi, à ma grande stupéfaction et alors que je venais d’enfiler un superbe ver bien rouge et bien vivant sur mon hameçon, mon bouchon plongeant immédiatement et très profondément, je ferrais et sentis aussitôt la forte résistance d’un poisson qui, en se débattant, tirait sur mon fil dans tous les sens.
J’étais tétanisé, malade d’avance à l’idée que le fil allait casser et la proie de ma vie s’échapper.
Cramponné à ma canne, j’appelais au secours à gorge déployée, ce qui eut pour effet d’amener tout le personnel administratif de l’usine aux fenêtres.
Papa, alerté et secondé par le concierge, vint à ma rescousse et, pour finir, un superbe gardon d’un peu plus d’une livre finit sur le pré, à nos pieds.
C’est peu dire que j’étais fier.
Tout le village en a parlé. Il faut avouer que je n’étais pas le dernier à relater l’évènement à quiconque acceptait de l’entendre, la « bête » prenant chaque jour quelques centimètres complémentaires.
Ceci dit, cette aventure avait surtout fait très peur à mon père qui, pendant quelques minutes, avait cru que mes appels au secours cachent quelque chose de plus grave.
S’ensuivirent donc toute une série de recommandations sur les précautions à prendre lors de mes expéditions halieutiques ainsi que diverses interdictions telles que monter seul sur les barques amarrées le long des berges ou fréquenter quelques endroits considérés comme dangereux pour qui ne savait pas correctement nager, ce qui était mon cas à l’époque.
Parmi ces endroits, l’un m’attirait tout particulièrement.
En effet, les eaux usées de l’usine étaient évacuées directement par une sorte de très gros caniveau dont la face supérieure était fermée par des éléments amovibles de tôle striée.
Le tout conduisait ces eaux jusqu’à une dizaine de mètres du bord, là où le courant dispersait facilement et rapidement ces effluents pollués.
C’était un endroit très prisé par les poissons qui y trouvaient à profusion divers déchets organiques dont ils se nourrissaient.
Un jour, mes parents s’étant absentés pour l’après-midi, accompagné de mon inséparable copain Michel, j’osais transgresser l’interdiction paternelle pour m’aventurer jusqu’à l’extrémité de cette sorte de jetée.
Il se trouve que quelques jours auparavant, des travaux de curage de cet égout avaient eu lieu, quelques plaques de tôle retirées à cet effet n’avaient pas été remises en place.
A la suite d’une touche sur ma ligne, je reculais de quelques pas pour mieux ferrer, oubliant ce faisant le trou béant qui s’ouvrait derrière moi.
Le caniveau n’était heureusement pas très profond, à peine plus d’un mètre, et l’aide de Michel me permit de m’extraire de l’eau sale et de la boue malodorante dans laquelle je pataugeais jusqu’à mi-cuisse.
Abandonnant ami et matériel sur la berge, après une tentative sommaire et maladroite pour nettoyer jambes et vêtements, je rentrais piteusement à la maison, sans passer devant la conciergerie et, après avoir escaladé les deux étages quatre à quatre, je me réfugiais dans ma chambre.
Une fois déshabillé et mes vêtements cachés sous mon lit, je me couchais pour m’endormir presque aussitôt.
Ce fut un réveil en fanfare et, devant mes explications embarrassées, la mémorable fessée qui s’ensuivit reste l’un des épisodes les plus cuisants de ma jeune carrière de pêcheur en rivière.
J’avais souvent un compagnon de pêche en la personne de l’adjoint anglais de papa, père des deux petites filles qui habitaient l’appartement du rez-de-chaussée.
Ce pêcheur avait pour habitude de venir très souvent en fin de journée lancer jusqu’au milieu de la rivière deux ou trois lignes de fond avec divers appâts destinés à attirer des barbeaux, poissons vivant dans le courant, très près du fond, sur les fonds de gravier et pouvant atteindre des poids et dimensions respectables.
C’est ainsi que j’ai pu assister avec envie à de très belles batailles précédant la capture de poissons pesant parfois plusieurs kilos.
J’avais même épisodiquement l’honneur et l’angoissante responsabilité d’utiliser l’épuisette pour finaliser la écupération de quelques belles pièces qui n’étaient évidemment pas disposées à coopérer.
Le cœur battant à cent à l’heure, je dois à ces quelques séances de ce qui était pour moi la « pêche au gros » celles qui comptent parmi mes plus belles montées d’adrénaline de ma jeune carrière de pêcheur.
J’ai depuis eu, à quelques reprises trop rares à mon goût, l’occasion de tenir quelques beaux poissons au bout de mes diverses cannes, mais jamais l’émotion que j’ai pu ressentir à ces occasions n’a atteint l’intensité de ces premières expériences avec celui qui était devenu mon grand copain anglais.
J’ignore ce qu’il est devenu et c’est bien dommage, car il fait partie des personnages qui ont jalonné ma vie et contribué à forger mon caractère.
Certes, avant lui, Tonton Milien avait semé la graine de mon amour pour la pêche, mais c’est lui, l’anglais, qui l’a fait germer et grandir jusqu’à en faire une véritable passion.


L’anniversaire de mes huit ans approchait.
Maman s’était arrondie une nouvelle fois et en tout début de l’année 1949, elle disparut et, comme à son habitude, papa reparut quelques jours après pour l’annonce d’une grande nouvelle.
Avec deux semaines de retard, le petit Jésus venait d’apporter à Nono un cadeau merveilleux.
Sur un petit nuage, il venait de parcourir alertement à pied la petite dizaine de kilomètres qui séparait la clinique de Decazeville où il venait de laisser maman, en disant et répétant « j’ai une fille » à chaque foulée de la marche qui le ramenait à la maison.
Nous avions donc, Jean-Pierre et moi, une petite sœur répondant au joli nom de Catherine. En fait, si le nom nous paraissait joli, la petite sœur, dont nous fîmes la connaissance dès le retour à la maison de maman, ne nous enchantait guère, mon frère trouvant cette petite frimousse rougeaude fort laide quant à moi, j’avais du mal à comprendre comment une si petite chose pouvait brailler si fort en accaparant maman aussi souvent et complètement, ce que je supportais très mal.
Heureusement, cet état larvaire ne dura que quelques semaines, la petite sœur se transformant au fil des jours en une belle poupée gazouillante dont Jean-Pierre et moi finîmes par nous disputer la présence et l’insigne honneur de pousser le landau dans les rues et chemins du village, avec arrêt obligatoire tous les cent ou deux cents mètres, afin de permettre à tous les représentants de la gent féminine locale de s’extasier sur la petite merveille qu’avait pondu maman.
C’est vrai qu’elle était très mignonne, les photos qui nous restent en témoignent, et notre petite famille, ainsi complétée, faisait plaisir à voir.
A quelques temps de là, profitant de quelques jours de congés, Tonton et Tata vinrent eux aussi admirer l’évènement qui accaparait notre maisonnée.
Une partie de la famille du midi, dont je parlerai plus loin, nous ayant rejoint, Pierrette Jaubert étant la marraine et Tonton le parrain, le baptême de notre petite Catou put avoir lieu dans l’église de Boisse-Penchot.
A cette occasion et pour nous rejoindre, notre cher Tonton conduisait sa toute nouvelle acquisition, une Citroën B-14 d’occasion en parfait état.
Cette B-14, pour moi qui n’en avais encore jamais vu, était un engin magnifique. Il faut dire que dans le village reculé que nous habitions, en plein milieu du Massif Central, endroit perdu s’il en est, nous avions très peu l’occasion d’admirer ce genre de véhicule.
Il faut dire également qu’à cette époque, les automobiles avaient un charme particulier fleurant bon le cuir et l’ébénisterie, avec une carrosserie pour laquelle toute recherche aérodynamique semblait superflue, ses gros phares ronds aux chromes rutilants, son bouchon de radiateur et tous ces petits accessoires faits pour être vus et traités comme des objets décoratifs avant d’être utilitaires, bref, une merveille qui me semblait le plus bel objet au monde, dont le moteur au ralenti ronronnait comme un gros chat, tout cela mélangé aux enivrantes odeurs d’huile et d’essence.
Nous rentrions tous à l’aise, parents, oncle, tante et enfants, Tonton ayant très astucieusement installé un hamac pour bébé derrière les sièges avant, hamac dans lequel Catherine, balancée au gré des mouvements de la voiture, ne tardait pas à s’endormir quelques minutes après le démarrage.
Nous avons fait des balades dans cette B-14, sillonnant les routes auvergnates, tortueuses à souhait et qui nous rendaient malades, mon frère et moi. Il faut dire que le balancement du hamac de la petite sœur n’arrangeait pas les choses.
A la saison des champignons, nous partions explorer les « coins à champignons » dénichés par Tonton qui, en mycologue averti, nous faisait découvrir et apprendre à reconnaitre, cèpes et bolets divers, girolles, russules et trompettes de la mort, toutes espèces délicieuses et à ne pas confondre avec les dangereuses amanites, l’impressionnant entolome livide et le redoutable inocybe de Patouillard, dont le seul prononcé du nom nous faisait crouler de rire, mon frère et moi.
En été, la saison de pêche à l’écrevisse étant ouverte, la B-14 nous conduisait au bord d’un petit torrent, lui aussi dûment reconnu préalablement par Tonton comme propice à cet exercice très particulier.
A cette époque, les rivières et ruisseaux n’avaient pas encore été envahis et totalement squattés par les « écrevisses américaines ».
Le produit de nos pêches était composé de races autochtones dites « à pieds rouges » et « à pieds blancs » particulièrement abondantes et savoureuses.
Cette pêche très spéciale utilisait de petits filets ronds, appelés « balances », tendus entre des anneaux circulaires d’environ trente à trente-cinq centimètres de diamètre et suspendus par trois brins de fil reliés entre eux et régulièrement attachés et répartis en périphérie du cercle supérieur.
Un dernier fil d’environ deux mètres était attaché au point de convergence des trois brins, permettant ainsi de soulever cette sorte de nacelle pour la plonger ou la retirer de l’eau.
Enfin, au centre du cercle du bas, deux petits lacets noués au filet étaient destinés à attacher l’appât.
Quelques jours avant la séance de pêche, Tonton s’était procuré une tête de mouton chez le boucher du village, tête dûment découpée en morceaux d’environ cinquante grammes.
Les morceaux étaient ensuite abandonnés à l’air libre durant les quelques jours nous séparant de la séance de pêche.
Autant dire qu’arrivée à ce stade, la tête ne sentait plus très bon.
C’est justement ce que semblaient apprécier ces crustacés que sont les écrevisses.
Chaque « balance », appâtée à l’aide d’un morceau de tête de mouton attaché à l’aide des lacets au centre du filet, étant déposée sur le fond d’un trou d’eau, la séance de pêche pouvait commencer.
L’eau étant très claire, j’ai passé des heures à observer les « balances » et les mouvements d’approche prudents des écrevisses, attirées par l’appât, les petites tout d’abord, puis les plus grosses chassant les petites, pour se retrouver tout autour du morceau de tête, pinces plantées dans la chair du mouton, groupées en étoile au centre du filet.
Au bout de dix à quinze minutes, le relevage rapide de la « balance » ramenait sur la berge une demi-douzaine, voire plus, de crustacés battant frénétiquement de la queue et qu’il fallait attraper d’urgence avant qu’ils ne se sauvent, pour les enfouir dans un sac de jute, en prenant bien garde aux pinces promptes à saisir les doigts imprudents.
J’ai eu plusieurs fois l’occasion d’affronter l’une de ces maudites pinces et les marques qu’elles m’ont laissées attestent de leur efficacité.
C’est donc sans aucun état d’âme que j’assistais aux diverses opérations conduites par maman visant à ôter le boyau central de la bête avant de la plonger avec ses sœurs dans un bain d’eau bouillante d’où, à ma grande surprise, elles ressortaient d’un rouge éclatant.
Et quel régal !
Je revois encore ces énormes plats d’écrevisses dites « à l’américaine » cuisinées par maman et dont, les mains pleines de sauce, nous décortiquions queues et pinces pour déguster la chair savoureuse, avant de sucer des carapaces pleines d’un jus délicieux.
Je n’ai jamais depuis retrouvé pareille émotion culinaire dans tout ce qui m’a été servi sous l’appellation écrevisse dans les divers restaurants que j’ai pu fréquenter.
Il est vrai que les souvenirs d’enfant embellissent toujours un peu les choses, mais quand même !!!
Si je remercie les américains pour la recette de leur sauce, je ne peux que regretter l’invasion intempestive de ces races américaines qui ont envahi nos eaux et sont très loin d’avoir les qualités gustatives des races qu’elles ont éliminées.
Ces premiers effets néfastes d’une mondialisation qu’il m’a été donné de découvrir au fil des ans conduisent petit à petit à une vulnérabilité collective qui risque d’envoyer probablement à terme ce même monde à sa perte.
C’est du moins ce qu’on est en droit de se demander au moment où, confiné comme tout un chacun, face à ce vilain petit virus qui envahit la terre, j’écris ces lignes.
Curieusement d’ailleurs, l’arrêt de la production industrielle et des échanges mécanisés, qu’ils soient locaux ou mondiaux, consécutifs à cette énorme pandémie, assainit l’atmosphère au point que dans de nombreux pays, ce qui était masqué par les brumes épaisses de la pollution redevient visible et resplendissant.
Les rivières redeviennent claires et les poissons réapparaissent dans les canaux vénitiens.
Il faut espérer que cet effet palpable et positif conduira l’humanité à une réflexion fondamentale sur ce que le monde est devenu et sur les limites de ce à quoi nous pouvons prétendre.
Mais ceci est une autre histoire et je me dois de quitter ces quelques observations dictées par la situation actuelle pour replonger dans ma mémoire et compter ce que fut ce monde merveilleux de mes dix premières années.


Indépendamment de feu ma bicyclette et des parties de pêche auxquelles je m’adonnais aussi souvent que possible, l’ingéniosité enfantine de l’époque nous permettait de trouver autour de nous mille façons de créer les jouets et accessoires divers, sources de mille amusements et activités plus ou moins tolérées par les parents.
C’était, entre autres, la confection et l’usage de lance-pierres, autrement dénommés, si je m’en souviens bien, « tire-choux » par tous les enfants de la cité ouvrière.
Michel m’en avait livré les secrets de fabrication.
Prélevez une branche de saule ou de noisetier, prolongée par une fourche à trois branches en partie supérieure.
La branche doit avoir une taille telle que votre main puisse la tenir fermement et sans difficultés ; elle doit être coupée net à une dizaine de centimètres sous la fourche.
Supprimer soigneusement la branche centrale de la fourche et couper les autres branches en conservant environ cinquante centimètres pour chaque branche.
Immergez le tout dans l’eau durant environ vingt-quatre heures.
Ligaturer la partie supérieure de la fourche de façon à rapprocher les deux branches en formant un U à la base.
Laisser sécher le tout une petite semaine avant de couper net les deux branches à environ huit à dix centimètres de la base.
Vous avez ainsi obtenu l’élément principal du lance-pierre sur lequel deux longueurs d’élastique provenant d’une vieille chambre à air, chacune solidement fixée à chaque extrémité de la fourche, et une petite poche en cuir, découpée en douce sur un vieux portefeuille de maman et solidement reliée aux extrémités libres des élastiques grâce à deux fentes ménagées de part et d’autre de la poche en cuir et vous voilà en possession d’une arme redoutable aux usages multiples et que la récolte de petits cailloux ronds rendait très efficace.
Outre la chasse aux petits oiseaux pour laquelle je me révélais particulièrement nul, tremblant à chaque fois à l’idée de tuer ces pauvres petites bêtes, nos cibles d’entrainement étaient multiples et consistaient essentiellement en des bouteilles vides et de vieilles boites de conserve disposées à plus ou moins longue distance sur des rochers et autres souches d’arbres morts.
Il était d’autres cibles beaucoup moins avouables, mais qui nous attiraient d’autant plus que l’interdit dont elles étaient parées, associé à la peur panique du garde-champêtre, transformait en exploit chaque tentative, qu’elle fût ou non couronnée de succès.
Je veux parler des essais répétés que nous faisions, aussi furtivement que possible, de toucher,
- soit les réflecteurs en faïence des quelques lampadaires qui bordaient la route entre l’usine et le centre du village,
- soit ce que nous appelions « les tasses » c’est-à-dire les supports en verre moulé des lignes électriques ou téléphoniques,
- soit enfin les panneaux publicitaires en tôle laquée, vantant les mérites culinaires ou gustatifs des bouillons Kub et autres chocolats Poulain.
Les bruits d’impact, synonymes du succès de notre tentative, provoquaient un cocktail de jubilation et de frousse qui nous ravissait.
J’en ressens encore les effets, en écrivant ces lignes malgré la honte que j’en aie à présent, plus de soixante-dix ans après.
Mes chers petits-enfants, vous qui lisez peut-être ce que je viens d’écrire, ne suivez surtout pas cet exemple, ou alors, ne le dites à personne et surtout ne dites pas que c’est moi qui vous l’ai dit.
Un autre jeu occupait nos après-midi du jeudi, car, à cette époque, nous n’allions pas à l’école ce jour-là.
Il utilisait un objet récupéré sur des bicyclettes hors d’usage.
Je veux parler des roues, ou plutôt des jantes, soigneusement débarrassées des restes de pneus et chambres à air ainsi que de leurs rayons.
Grâce à un petit bâton, ou mieux, un morceau de fil de fer façonné en fourche, nous guidions ces cerceaux improvisés dans des courses effrénées sur tous les chemins du village et notamment autour de la cité ouvrière qui formait un circuit très pratique.
Ce n’était pas toujours du goût des résidents de la cité que nos cris enthousiastes et notre propension à bousculer passants et promeneurs dérangeaient.
Alors nous changions de circuit et allions jouer plus loin.
Je me souviens aussi de parties effrénées d’un jeu, lui aussi fabriqué de toutes pièces à l’aide d’un bout de bois d’une quinzaine de centimètres de longueur et deux à trois centimètres de diamètre, taillé en fuseau à ses deux extrémités.
Une branche d’environ un mètre et d’environ quatre centimètres de diamètre nous servait de batte.
Le jeu se pratiquait de la façon suivante : le bout de bois taillé en fuseau posé en équilibre sur le bord d’un trottoir ou d’une pierre, il s’agissait de taper violemment à l’aide de la batte sur l’extrémité du fuseau qui, une fois en l’air, devait être frappé à nouveau par la batte et projeté ainsi aussi loin que possible.
Chaque joueur disposait de trois essais le gagnant étant celui dont le tir avait envoyé le fuseau le plus loin de la pierre de départ.
Nous parions des billes ou des bonbons et je me souviens avoir été assez adroit à ce jeu qui ressemblait un peu au baseball.
Bien évidemment et comme tous les gamins de l’époque et bien sûr de nos jours, nous jouions aux billes et au football.
Pour les billes, c’était surtout le triangle qui avait nos faveurs.
Une fois le triangle isocèle tracé sur une surface de terre bien tassée et plane, chaque joueur disposait une demi-douzaine de billes dans la surface ainsi délimitée.
Tous se tenant à la hauteur du triangle, il s’agissait de lancer une grosse bille, appelée « calot », le plus près possible d’une ligne située à environ trois mètres de là.
Les participants pouvaient alors jouer, chacun à son tour, dans l’ordre de proximité de la ligne.
Une fois le « calot » lancé depuis la ligne, l’objectif à atteindre était de sortir le plus possible de billes du triangle et de les empocher.
Si le « calot » restait dans le triangle, il était perdu et le joueur fautif regardait les autres terminer la partie.
Le premier lancé du « calot » s’effectuait à bout de bras, comme à la pétanque, il était ensuite joué depuis son emplacement, posé sur le creux de l’index et propulsé par le pouce.
Ce n’était pas toujours facile et nombreux étaient ceux qui n’y parvenaient que difficilement.
Ceux-là restaient sur la touche et regardaient.
Les billes étaient en terre et non en verre comme à présent,, et chacun de nous avait son sac en toile, soigneusement confectionné par maman, fermé par une cordelette glissée dans des passants.
Accessoirement, ces billes pouvaient servir de monnaie d’échange ou d’enjeu pour des paris.
Quand nos pertes cumulées avaient épuisé notre stock de billes, quelques sous, produits de nos petites économies ou distraits de la monnaie des courses, nous permettaient de remplir à nouveau notre sac chez Réjane.
Le football, quant à lui était pratiqué par les « grands » qui complétaient parfois les équipes par les « petits » que nous étions.
Les parties se déroulaient dans un champ existant entre la cité et la route départementale menant au centre du village.
Deux bérets posés dans l’herbe figuraient les buts quant aux limites du terrain, elles n’étaient pas réellement définies et étaient fréquemment source de contestations plus qu’animées.
Michel et moi étions très fiers d’être sélectionnés et appelés par les « grands » et il n’était, bien entendu, pas question de quitter le terrain avant la fin sifflée de la partie.
L’été, ces parties se prolongeant souvent très tard, il m’arrivait de rentrer à la maison à une heure telle que je me trouvais, non seulement confronté aux reproches d’une mère inquiète, mais surtout à l’inévitable fessée paternelle et à la sanction du « dodo » sans diner, ce dont, je dois dire, je me moquais éperdument, fermement décidé à renouveler l’escapade dès que l’occasion se présenterait.
Tous ces jeux ont meublé mon enfance et jamais je ne m’ennuyais. Malgré fessées et remontrances, je suis infiniment reconnaissant à mes parents de m’avoir laissé vivre dans cette liberté qui, encore à présent, reste si chère à mon cœur et que je souhaite à tous les enfants d’aujourd’hui.

Parmi les évènements marquants chaque année dans le village, la Fête Nationale du 14 juillet était celle qui réunissait, surtout après la fin de cette guerre maudite qui avait vu mourir tant d’hommes, la plus grande foule joyeuse et bigarrée.
Après la cérémonie au monument aux morts, en présence du maire, du conseil municipal au grand complet, des enfants des écoles, maitres et maitresses en tête, des anciens combattants des deux guerres, tous drapeaux déployés, et d’une grande partie des habitants du village, un cortège se mettait en place.
Fanfare en tête, cuivres et tous instruments rutilants, suivaient dans l’ordre les anciens combattants et leurs drapeaux, puis deux équipes de jouteurs, bérets, ceintures larges et espadrilles rouges et bleues, chemises et pantalons blancs, lances sur l’épaule droite pour les joueurs et rames également sur l’épaule droite pour les rameurs, les deux barreurs précédant le groupe.
Cet impressionnant défilé, suivi par une foule endimanchée et en un joyeux désordre, au rythme des tambours et de musiques martiales souvent d’une justesse approximative mais jouées de grand cœur, se dirigeait, pas toujours très au pas, vers les rives du Lot, au pied de l’immeuble où nous habitions, en empruntant la route départementale et en contournant les murs de clôture de l’usine.
Tout le long de la route, contre les murs de l’usine, de petites boutiques sommaires s’étaient installées, vendant sucreries, barbe-à-papa, pommes d’amour, sandwichs et autres babioles à quatre sous, tentantes pour petits et grands.
Tout ce monde s’installait tant bien que mal sur la rive en pente pour attendre ce grand spectacle qu’étaient les joutes intercommunales.
De l’autre côté du Lot, la rive était également noire d’une foule, venue des villages environnants et dont des représentants figuraient au nombre des jouteurs.
Sur les bords de la rivière attendaient deux grandes barques, une rouge et une bleue, avec huit postes de rames, un siège de barreur et une grande plateforme à l’arrière, la quintaine, en pente vers l’avant d’environ quinze pour cent et susceptible de recevoir une équipe de six jouteurs dont un en position de combat.
Rameurs, barreurs et jouteurs ayant pris place sur les barques, ces dernières gagnaient le milieu de la rivière en s’éloignant à environ une centaine de mètres l’une de l’autre et, après avoir fait demi-tour, s’élançaient l’une vers l’autre jusqu’à se croiser par la droite.
Le rythme d’un tambour cadençant les coups de rames et les deux barques arrivées à une dizaine de mètres l’une de l’autre les rameurs levaient leurs rames à l’horizontale le long de la coque, le tambour cessait de battre et les notes aigües d’une trompette donnaient le signal de l’affrontement.
Les deux jouteurs combattants, en position de grand écart, le pied droit calé contre le rebord arrière de la plateforme, lance pointée à l’horizontale vers le plastron carré tenu par le bras gauche replié de l’adversaire, se heurtaient à pleine vitesse, l’un des jouteurs déséquilibré, parfois même les deux plongeaient dans la rivière, sous les hurlements et les vivats de la foule des supporters du vainqueur resté sur la plateforme.
Deux autres jouteurs se préparaient au combat et un nouvel affrontement avait lieu dans les mêmes conditions et jusqu’à ce que chaque équipe des six jouteurs ait combattu.
Les bateaux revenus sur la rive, deux autres équipes prenaient place, et ainsi de suite jusqu’à épuisement du nombre d’équipes.
La première manche ainsi terminée, les vainqueurs reprenaient place sur les plateformes pour de nouveaux affrontements jusqu’à la finale opposant les deux derniers combattants qui n’étaient pas encore tombés à l’eau.
C’était grandiose et passionnant. Ce n’était toutefois pas sans danger, les lances cassant parfois et les embouts de ferraille dentelés, pour mordre sans glisser dans les plastrons en bois de l’adversaire, pouvant causer des blessures quelquefois graves.
Une ambulance était toujours présente pour pallier à toute éventualité et soigner si nécessaire ces gladiateurs modernes.
Elle était aussi très utile pour soigner les nombreux cas d’insolation.
Les vainqueurs étaient adulés par la foule et portés en triomphe en fin de combat.
Certains étaient des habitués de ces joutes et revenaient chaque année remettre leur titre en jeu. Ils avaient tous des surnoms évoquant leurs exploits et leur statut de champion.
Je me souviens tout particulièrement de l’un d’entre eux.
Employé de l’usine et pesant probablement plus d’une centaine de kilos, certainement plus de muscles que de graisse, il était pratiquement impossible de parvenir à l’éjecter de la plateforme.
Chaque année, tous les combattants redoutaient d’avoir à l’affronter et très rares étaient ceux qui pouvaient se vanter de l’avoir fait tomber.
Il était devenu une gloire locale et portait fièrement le surnom de « Rocher de l’Aveyron ».
C’était au demeurant un gars très sympathique, comme le sont souvent ceux que l’on qualifie de « gros ».
Je crois me souvenir qu’il se nommait Gallaret et, comme c’est souvent le cas chez ces imposantes personnes, il adorait les enfants et tous l’aimaient beaucoup.
Un cortège de bambins rieurs l’accompagnait à chacun de ses passages dans la cité, d’autant plus qu’il avait toujours au fond de ses poches quelques bonbons à distribuer.
Je crois avoir appris depuis qu’à sa grande tristesse, il n’avait pas d’enfant. Ceci explique probablement cela.
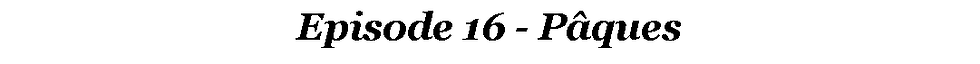
A la fin du long hiver, alors que la nature s’éveillant, arbres et arbustes bourgeonnaient, la période du carême, très observée en ce temps-là, touchant à sa fin, toute la chrétienté et, bien sûr, notre petite paroisse s’apprêtaient à célébrer les fêtes de Pâques.
Avant, bien entendu, se déroulait la semaine sainte.
Tout d’abord, le dimanche des Rameaux.
Les familles réunies, en « habits du dimanche » se rendaient à l’église en procession bigarrée.
Chaque enfant tenait fièrement une branche de buis abondamment ornée de rubans, de sujets en pain d’épice, de gâteaux secs et de bonbons.
Evidemment, nous n’avions pas le droit d’y toucher avant la messe, papa et maman veillant attentivement, et personne n’aurait osé enfreindre cette formelle interdiction.
Puis venait cette fameuse semaine de toutes les saintes obligations.
Se confesser avant tout, pour ceux dont l’enseignement catéchiste avait abouti à la communion privée autrement appelée première communion.
J’en faisais partie, à huit ans révolus, et je redoutais tout particulièrement d’avoir à raconter à voix basse, à ce curé sévère que je connaissais bien, masqué par sa grille de bois dans le confessionnal de l’église qui fleurait l’encaustique, les énormes péchés que je pensais avoir commis.
Je suis sûr que j’en inventais, terrorisé à l’idée qu’en en ayant oublié, le diable abominable, dont j’avais vu l’image dans mon livre de catéchisme, me condamnerait à l’enfer sur lequel il régnait.
Venaient ensuite la cérémonie des cendres, à laquelle je ne comprenais pas grand-chose, et qui m’obligeait, en rentrant, à laver mon front sali.
Vendredi, c’était l’interminable, fatiguant mais impressionnant chemin de croix.
Mes parents m’ayant informé du départ des cloches pour Rome, le bruit des crécelles, maniées par les enfants de chœur, ponctuait la cérémonie.
Je savais de source sûre que le retour des cloches serait pour dimanche.
J’en avais parlé à Poupi et nous nous étions promis de bien observer le ciel pour épier leur passage.
Elles étaient censées rapporter de leur long voyage des friandises diverses, bonbons, œufs et chocolats qu’elles perdraient et sèmeraient sur les rives du Lot.
A l’époque, nous n’avions pas de jardin.
Malheureusement, elles n’eurent aucun mal à échapper à notre vigilance durant l’interminable messe de ce dimanche saint.
Par contre, elles avaient bel et bien accompli leur tâche, semant abondamment leurs cadeaux sucrés et chocolatés dans les herbes et sur les arbustes, en bordure de la rivière au pied de notre immeuble.
Criant et riant, sous la vigilante attention parentale, nous avons rempli nos petits paniers.
Pour les quelques oubliés, la semaine suivante, une exploration minutieuse me permettait de disputer aux fourmis les restes de la fête que je dévorais sur le champ, sans souci, et j’en ai honte à présent, de partager avec frère et copains.

J’ai déjà évoqué, lors de l’épisode du boitillard de « Coco Boer », nos excursions clandestines dans les vergers du village.
Outre les cerises que nous chapardions, nous dégustions avec délice, suivant les saisons, framboises, fraises, abricots, pommes et poires.
Même si quelques propriétaires de ces réserves délicieuses, furieux devant ces pillages, protestaient et nous chassaient manu militari, la plupart des paysans concernés, considérant que nos prélèvements restaient, somme toute, assez négligeables, nous toléraient d’un œil bienveillant.
De surcroît, la nature offrait, pratiquement en toutes saisons, des trésors succulents que, guidés par l’expérience de quelques amis plus âgés et de vieux paysans ou bergers, nous avions appris à connaitre.
Dès l’arrivée du printemps et jusqu’à l’été, nous ponctuions nos escapades dans les champs et forêts par de fréquents arrêts pour picorer, çà et là, airelles, mûres et fraises des bois odorantes que nous trouvions en abondance sur les talus, le long des chemins.
Dès leur floraison, nous faisions des orgies de fleurs d’acacia.
L’automne apportait ses paniers de châtaignes, grillées, après avoir été légèrement entaillées pour éviter qu’elles éclatent, sur de vieilles tôles percées de trous et posées sur des braises ardentes.
Un régal !!!
Dans l’un des jardins d’une des grosses maisons à l’entrée du village, un arbre que j’ai appris plus tard s’appeler plaqueminier avait été planté par le propriétaire.
Cet arbre débordait largement sur le chemin qui menait à l’école et, après les premières froidures de l’automne, des fruits ressemblant à de grosses tomates oranges bien mûres, finissaient par tomber et s’écraser sur le chemin.
Ces fruits qu’on appelait kakis étaient sucrés et délicieux et, je ne compte pas le nombre de fois où je suis arrivé à l’école, abondamment barbouillé de jus orangé.
Le maître bien entendu, après m’avoir grondé, m’envoyait me laver le visage avant d’entrer en classe.
Je n’étais bien souvent pas le seul barbouillé.
Une autre merveille de ces débuts du froid, après les premières gelées, était le néflier qui produisait ces nèfles que nous ne mangions qu’après les avoir laissées reposer sur de la paille pendant environ deux semaines.
Une fois la peau enlevée et les pépins éliminés, elles avaient un délicieux goût de pomme que je n’ai jamais retrouvé depuis.
Mais là aussi, le temps a, peut-être, embelli mon souvenir.
Une récolte et une pratique étaient teintées d’interdit.
Après avoir prélevé une dizaine de centimètres d’une tige mince de sureau, dont nous évidions la moelle à l’aide d’une aiguille à tricoter dérobée dans la travailleuse de maman, nous confectionnions une pipe, le foyer étant également réalisé dans un morceau de tige de sureau de deux à trois centimètres de diamètre et également vidée de sa moelle, le fond étant bouché par un petit morceau de liège.
A défaut de « gros gris », en dérober n’était pas toujours facile, la barbe de maïs séchée, prélevée dans un champ voisin, tenait lieu de tabac.
C’était épouvantablement âcre et nous rendait la plupart du temps malades à vomir, mais nous adorions pratiquer en cachette cette activité interdite qui nous donnait l’impression de rejoindre le monde des adultes.
Je n’aurai garde d’oublier les fabuleuses récoltes de champignons, qu’avec Tonton au début et sans lui plus tard, j’ai pu faire dans les bois et prairies du Massif Central.
Dès la fin de l’été et durant tout l’automne, jusqu’aux premières gelées, la nature offrait aux connaisseurs mycologues une abondance de champignons qui, en quelques heures, remplissaient nos paniers.
Dans les champs, dès le mois de septembre, il était possible de récolter des rosés des prés en abondance.
Dans les bois, des plages entières de trompettes de mort que leur couleur noire avait affublées de ce nom dissuasif, mais que leur goût délicieux réhabilitait, finissaient soigneusement enfilées par maman à l’aide d’une aiguille sur une longueur de ficelle et suspendues pour sécher entre les poutres d’un galetas pour d’odorants et délicieux repas d’hiver.
Sans attendre aussi longtemps, de grands plats de girolles, de pieds-de-moutons et de russules vertes, abondamment aromatisés d’ail et de persil, concluaient somptueusement nos virées mycologiques.
Avec quelques côtelettes d’agneau de lait, quel régal !
N’oublions pas, dans cette gouteuse et passionnante évocation, ce roi des champignons. J’ai bien sûr nommé le cèpe et surtout l’empereur d’entre eux, celui dit « de Bordeaux » dont la tête brune était très difficile à voir, dissimulée qu’elle était le plus souvent sous les feuilles d’un chêne ou d’un châtaignier.
Les plus gros, facilement repérables étant donné leur taille parfois imposante, étaient les moins appréciés car souvent véreux et dévorés par d’énormes limaces orangées.
Par contre, les plus petits et moins âgés, les « bouchons de champagne » appelés ainsi en raison de leur forme, étaient évidemment beaucoup plus recherchés.
Délicatement brossés pour éliminer résidus de terre et de mousse, maman, à qui Tonton Millien, en excellent cuisinier qu’il était, avait appris la recette très simple, magnifiant ce met d’exception.
Elle faisait rôtir à la poêle, au beurre fermier et à l’huile d’olive, ces superbes « bouchons de champagne » dans de délicieuses odeurs d’ail ou d’échalotes, de thym et de laurier.
Tonton et Tata étaient souvent des nôtres pour ces expéditions en forêt.
Gégé avait un flair tout particulier pour repérer les plages de girolles, de trompettes et surtout pour dénicher les cèpes sous les feuilles mortes et la mousse.
Du plus loin qu’il les voyait, il courait presque pour être le premier « sur le coup », ne laissant à personne le soin d’exécuter le ramassage, la collecte ainsi effectuée étant soigneusement et presque amoureusement couchée dans son panier.
Cette passion, qu’il m’a transmise, m’a accompagnée tout au long de mon existence, et à présent encore, j’adore arpenter les forêts à la recherche de toutes ces merveilles gustatives.

A côté de Noël, de Pâques et du 14 Juillet, il était une fête particulièrement chère aux cœurs de tous, c’était « la Saint-Jean ».
Chez nous, avant tout, c’était la fête de papa.
Nono et Re-Chérie acceptaient ce jour-là et sans rechigner le moins du monde notre soudaine irruption sur le lit conjugal et les folles embrassades avec lesquelles, malgré sa barbe qui piquait, nous nous disputions les joues paternelles.
C’étaient ensuite la joie d’un petit déjeuner en commun, sur la table de la salle à manger.
Je ressens encore, à l’heure où j’écris ces lignes, l’odeur du bon café et le gout des tartines grillées sur le poêle en fonte de la cuisine, abondamment garnies de beurre venu directement d’une ferme voisine et de confiture de fraise, faite au printemps précédent par maman, et soigneusement conservée dans des pots de verre sous une couche de paraffine et un chapeau de tissus que maintenait un bracelet élastique.
En ces temps bénis où, par bonheur, les super et hyper marchés n’existaient pas,
chaque ménagère confectionnait, au fur et à mesure des saisons, des réserves de bocaux de légumes et de fruits, pour les saisons d’automne et surtout d’hiver.
Tomates, haricots, pêches, abricots, entre autres, et une foule de produits du jardin, des vergers et des bois, finissaient dans des bocaux de verre, fermés par un collier élastique écrasé par un couvercle également en verre et muni d’un système de verrouillage en fil de fer dont, pour ceux que cela pourrait intéresser, j’ai appris depuis qu’il avait fait en 1875 l’objet d’un brevet déposé aux Etats-Unis par un certain Charles Quillfeldt.
Ce procédé est encore largement utilisé, que ce soit sur des bocaux ou des canettes de cidre ou de bière.
Bref, une fois remplis et fermés, ces bocaux, rangés tête en bas dans une grande lessiveuse en partie remplie d’eau, étaient mis à bouillir des heures durant sur la cuisinière en fonte. Ils étaient, ce faisant, pasteurisés, c’est-à-dire, suivant le principe brillamment mis au point par Pasteur, débarrassés pour des mois de tous germes pathogènes susceptibles de détériorer leur contenu.
Tous ces bocaux finissaient alignés sur des étagères avant de rejoindre, cuisinés par maman, notre table durant les mois d’hiver.
Toutefois, l’utilisation de ces réserves n’allait pas sans une difficulté préalable, l’ouverture du bocal.
Le vide créé à l’intérieur durant l’opération de pasteurisation rendait la fermeture suffisamment hermétique pour interdire toute tentative visant à soulever le couvercle, une fois le levier métallique débloqué.
Le joint en caoutchouc, disposé entre couvercle et bocal, était muni d’une languette qui, selon le fabriquant, permettait en principe, et en la tirant de laisser pénétrer l’air à l’intérieur, débloquant ce faisant l’ouverture du couvercle.
Je revois et j’entends encore papa, rouge sous l’effort et pestant contre l’inventeur de ce procédé stupide, tenter, parfois en vain, d’abord à mains nues puis ensuite à l’aide de pinces, de venir à bout de cette satanée languette.
Cela se terminait souvent au couteau, et je ne compte pas le nombre de lames cassées durant ces affrontements qui finissaient toujours et heureusement par la défaite du bocal et son ouverture, accompagnée du « ouf » de soulagement de papa et la grande satisfaction d’une maman reconnaissante.
C’était économique et, complété par quelques conserves en boîte, achetées chez Réjane, nous permettait d’être alimentés en fruits et légumes toute l’année.
Mais je me suis éloigné de cette fête du 20 juin qui, chaque année, mettait le village en ébullition pour célébrer l’arrivée de l’été.
Dès le matin de ce jour, au centre de la vaste place située à l’extrémité de la cité ouvrière, autour d’un grand sapin dressé au centre, un imposant bucher de branches et de fagots était élevé, formant une pyramide d’environ trois mètres à sa base.
En fin de journée, la nuit venue, des hommes mettaient le feu à la base de la pyramide qui s’embrasait rapidement et brûlait avec des flammes immenses qui tenaient éloignée pour un temps la foule rassemblée tout autour de l’esplanade.
Quand les flammes ayant baissé, la foule se rapprochait, plusieurs rondes concentriques se formaient, mêlant femmes, hommes et enfants et, au son de fifres et de binious, tous dansaient la bourrée, riant, chantant et claquant des sabots.
Cela durait des heures, jusqu’à ce que le brasier soit réduit à l’état de grand cercle ardent et rougeoyant.
C’était le moment choisi par les hommes jeunes, inconscients et courageux, de répondre aux défis lancés par les femmes et les filles et, après quelques mètres d’élan, de sauter par-dessus les braises.
Des cris d’effroi et de bruyants vivats accompagnaient chaque exploit et, à ma connaissance, et malgré quelques fonds de culotte roussis, aucun accident n’a jamais été à déplorer.
En fin de soirée, il n’était pas rare d’observer quelques couples disparaitre dans le noir propice de la nuit, sans que je n’aie, à l’époque, vraiment compris la raison de ces fugues discrètes.
Papa et maman assistaient avec Poupi et moi à cette soirée que nous trouvions grandiose, et ce n’est qu’exceptionnellement fort tard que nous rentrions à la maison, Poupi endormi dans les bras et sur l’épaule de papa et moi, épuisé de fatigue et trainant la jambe.
Il faut dire qu’à cette époque de l’année, et même sans cette invention moderne de l’heure d’été, les journées de juin étaient longues et ô combien fatigantes pour les enfants que nous étions.
Je me souviens également qu’à la même saison et de façon récurrente à chaque mois de juin, avait lieu un phénomène qui a pratiquement disparu de nos jours.
Je veux parler de l’éclosion des éphémères, ces petits insectes, sorte de petites libellules aux ailes presque transparentes et qui, après quelques années passées dans l’eau à l’état larvaire, montaient en surface pour éclore et, après avoir assuré la survie de l’espèce, mouraient quelques heures après.
C’était absolument impressionnant.
Ils formaient des nuages extrêmement denses, au-dessus et à proximité du Lot, que leurs cadavres nappaient d’une couche blanche, un peu comme de la neige.
Tournoyant autour des lampes et piégés dans les toiles d’araignées, ils formaient des guirlandes sur chaque réverbère, au grand plaisir des guêpes qui, le lendemain, disputaient aux araignées cette manne providentielle.
Cela rendait fous les poissons qui se gavaient de ce cadeau prodigué par la nature à chaque début de l’été.
C’était par contre assez écœurant de devoir, plusieurs jours durant, patauger dans cette gluante mélasse, déposée sur la route, écrasée à chaque passage par les roues de camions rentrant et sortant de l’usine.
Comme beaucoup trop de choses, la pollution a tué cette manne et je suppose que plus aucun nuage blanc ne vient, de nos jours, fleurir au début de l’été les rives de ma chère rivière.

C’est vrai que ce Lot, ma rivière, même si depuis que je l’ai quitté je ne l’ai jamais revu, est restée très cher à ma mémoire.
Que de découvertes, d’activités multiples, de leçons de choses elle m’a procurées.
Juste en bas de notre immeuble, amarrée sur la rive au tronc d’un vieux saule, nous possédions une barque suffisamment grande pour que toute notre petite famille prenne place sans danger, y compris Catou notre petite sœur dans les bras de maman.
Poupi et moi avions, bien entendu, interdiction formelle de monter sur cet esquif attirant, en l’absence d’un adulte, mais parfois, la tentation étant trop forte et profitant de l’absence paternelle, je me risquais, un jour, sur les bancs du bateau, réussissant ce faisant des lancers de lignes plus au large, ce qui, dans mon esprit, me permettait de mieux approcher les gros poissons que j’espérais prendre.
L’expérience m’a montré qu’il n’en était rien.
Cela ne m’a pas empêché, quelques temps après alors que je bravais à nouveau l’interdit, l’amarre de la barque étant un peu trop tendue et l’espace un peu trop large pour mes petites jambes, de chuter dans l’eau du bord, heureusement peu profonde.
Ce fut, bien sûr, l’occasion d’un nouveau sermon paternel et d’une fessée que j’avais bien méritée.
Ce qui, pour nous enfants, était un grand navire avait évidemment un usage beaucoup plus approprié et passionnant.
Dès les beaux jours et lorsque le temps s’y prêtait, nous embarquions tous pour une journée de navigation et d’aventures.
Papa, une fois les restes d’averses récentes soigneusement écopés pour assécher le fond de la barque, assis sur le banc central, maniait vigoureusement les rames, maman assise à l’arrière, face à lui, Catou bien serrée dans ses bras, et nous groupés à l’avant et posés, bien serrés, sur un petit banc.
Tonton et Tata, souvent présents, nous accompagnaient dans ces aventures navales.
L’expédition devait durer une bonne demi-heure, avant que la barque n’échoue sur une accueillante plage de sable, juste en aval d’un ouvrage incliné qui formait barrage, et sur lequel l’eau ruisselait joyeusement pour franchir un dénivelé du cours du Lot d’environ un mètre.
C’était un endroit magnifique, la plage bordée d’une prairie s’enfonçait en pente douce dans cette eau limpide, à l’époque totalement indemne de pollution.
Nous pouvions bien sûr barboter en toute sécurité, et les joies d’un premier bain épuisées, nous nous réunissions, autour d’une grande nappe blanche posée sur l’herbe, pour faire honneur à un pique-nique somptueux et amoureusement préparé la veille par maman.
Le temps estimé à deux heures de digestion aidant, nous avions interdiction de retourner nous baigner.
Papa faisait la sieste et maman, après avoir satisfait aux exigences hygiéniques et affamées de la petite sœur, jouait avec elle sur la grande nappe blanche débarrassée de toutes traces du repas.
Le fameux barrage formait une pente raisonnablement inclinée qui permettait sans danger nos explorations pieds nus et dans l’eau jusqu’à la cheville, ce qui était bien évidemment permis, car sans risque de nuire à cette sacro-sainte digestion.
Il fallait simplement prendre garde à ne pas glisser sur les plaques de mousse, accrochées à toutes les aspérités.
Réalisé il y a fort longtemps, en maçonnerie de moellons de pierre grossièrement taillés et de surcroît usés par des années d’usage et de ruissellement, de nombreux manques créaient des intervalles et des trous d’eau de taille modeste.
C’était, très souvent, le refuge de petits poissons d’une dizaine de centimètres au plus et qu’avec un peu d’adresse, il était facile de capturer à la main.
Nous en attrapions par dizaines et, stockés dans nos seaux de plage, nous les rapportions fièrement à papa et maman.
Cette dernière, le soir venu, après les avoir sommairement vidés et roulés dans la farine, les plongeait dans un bain d’huile bouillante, pour de succulentes fritures que nous dégustions béats, avec des doigts abondamment tachés de gras.
C’était bon, véritablement divin !!!
Après un dernier bain, un goûter toujours pris sur l’herbe, nappe, ustensiles divers et déchets des repas réunis dans des sacs, nous refaisions en barque le parcours inverse, beaucoup plus facilement et rapidement pour papa, car portés par le courant.
Profondément heureuse et fatiguée, la petite famille réintégrait son gîte.
Inutile de dire que point n’était besoin de nous bercer pour nous plonger, la nuit venue, dans les bras de Morphée.

Je venais d’avoir neuf ans et, l’année scolaire terminée, arrivait la période merveilleuse et tant attendue des grandes vacances.
Débutant le premier juillet pour une rentrée prévue le premier octobre, elles duraient trois longs mois, une éternité pour les enfants que nous étions, éternité à peine troublée par les inévitables devoirs de vacances, corvées somme toutes assez relatives, les cahiers prévus à cet effet et achetés par papa dans une librairie de Decazeville étant abondamment et plaisamment illustrés pour rendre distrayante cette obligation, souvent supervisée par Tonton et Tata.
Ces derniers, tous deux enseignants, elle professeur de mathématiques et lui de biologie animale, bénéficiaient en effet de cet extraordinaire privilège de trois mois de totale liberté, qu’en général ils nous consacraient.
La B14 du début venait d’être remplacée par la, toute récente à l’époque, 203 Peugeot, dont les modernes lignes courbes tranchaient radicalement avec celles, parallélépipédiques et toutes en angles du précédent véhicule, spacieux et confortable, et qui nous avait autrefois éblouis.
Pourtant, cette nouvelle merveille ne manquait pas d’attraits et nous a, très rapidement, ravis, Poupi et moi, par tout un tas de détails innovants très séduisants.
Le toit ouvrant tout d’abord, spacieuse fenêtre zénithale montée sur rails et coulissante, permettait, tout en roulant, de contempler le ciel quand le temps était beau. Il avait aussi l’avantage de colorer d’un brun rougeoyant au début et de plus en plus « chocolat », comme disait Tata ravie, le crâne et le front totalement chauve de Tonton.
La commande d’avertisseur, sous le volant et le bruit assourdissant qu’il produisait, nous intéressait également. Tonton en abusait largement et avait pour habitude de faire part de son indignation, à l’aide de vigoureux et répétés coups de klaxon, chaque fois qu’un autre véhicule effectuait une manœuvre frauduleuse ou incongrue à ses yeux.
A ce propos, il me revient une anecdote croustillante qui nous a plongés, Poupi et moi ainsi que notre cousin Justin, dit Tintin, qui était également du voyage, dans une irrésistible crise de fou rire.
Alors que nous roulions sur une route en ligne droite et assez encombrée, le véhicule publicitaire d’un cirque ambulant réussit à nous doubler pour venir s’intercaler entre nous et la voiture précédente.
Tonton, certainement vexé, salua la prouesse d’une bordée de « coin-coin » rageurs et répétés.
C’était sans compter sur les possibilités offertes par deux haut-parleurs géants surmontant le véhicule de l’agresseur.
En retour et sans attendre, les protestations bruyantes de Tonton furent saluées par cette réplique péremptoire et assourdissante : « tu ne vas pas la fermer ta grande gueule » laissant Tonton interloqué, Tata ulcérée, et nous morts de rire.
Une autre particularité de cette voiture était l’indicateur de changement de direction.
Les clignotants actuels étaient remplacés, sur ces premières 203, par des flèches lumineuses, insérées dans des boitiers et qui jaillissaient à l’horizontale, soit à gauche, soit à droite, sur une simple impulsion d’une commande située au-dessus du volant.
C’était magique et nous amusait beaucoup.
C’était surtout l’occasion pour Tata d’intervenir souvent par un avertissement angoissé : « Gégé, tu n’as pas mis ta flèche » !!!
D’autres occasions justifiaient fréquemment l’intervention paniquée de Tata qui, à chaque tentative de dépassement, criait presque : « attention Gégé, tu n’as pas le temps » auquel il était invariablement répondu par Gégé, se rabattant brutalement et mâchouillant nerveusement une pipe, le plus souvent éteinte et qui ne le quittait jamais : « tu vois bien que si, Anne-Marie ».
Nous sommes pourtant toujours et grâce au ciel arrivés à bon port.
Cette année-là, entre La Rochelle et Quiberon, nous avons eu le merveilleux privilège de découvrir l’Atlantique.
Cette immense étendue d’eau aux couleurs infiniment changeantes, verte et bleue sous le soleil, grise ou brune sous la pluie, jamais immobile aux vagues douces ou menaçantes, me fascinait littéralement.
Le mouvement des marées offrait un monde de découvertes et d’aventures, inondant et détruisant nos châteaux, laborieusement bâtis avec pelles et seaux, dans le sable mouillé, lorsque la mer lointaine nous laissait, pour quelques heures, oublier l’inexorable retour du reflux.
Le port et les plages de La Cotinière, sur la presqu’île de Quiberon, nous ont accueillis durant quelques semaines et je m’échappais souvent, en suivant quelques camarades de vacances, pour de grandes parties de pêche-à-pied.
La basse-mer, surtout durant les périodes dites de grandes marées, découvrait un monde de rochers et d’étendues de sable, habituellement immergés, et qui recelaient des trésors.
Poissons, coquillages et crustacés divers, piégés dans les mares ou réfugiés dans des anfractuosités des rochers asséchés, représentaient des proies qu’armés de petits filets ou de crochets métalliques, nous nous efforcions de capturer.
Je découvrais, ce faisant, des techniques de pêche inattendues et originales.
Une jeune habitante de la presqu’île, fille de pêcheur, m’impressionnait tout particulièrement avec son extraordinaire méthode pour capturer des couteaux, ce coquillage ainsi nommé en raison de sa forme et qui a pour habitude de s’enterrer plus ou moins profondément dans le sable, ne laissant apparaitre en surface que deux petits trous aisément repérables.
Elle me laissait l’accompagner dans sa chasse.
Alors que le reflux commençait à envahir l’étendue de sable qu’elle avait choisie, dans quelques centimètres d’eau montante, elle semait autour des trous jumeaux qu’elle avait repérés une pincée de gros sel. Après quelques secondes d’attente, trompé par cette manœuvre, le couteau jaillissait du sol et ma compagne l’extrayait prestement entre pouce et index, avant qu’il n’ait le temps de réagir et de s’enfouir pour se réfugier à nouveau dans le sable.
Une grande habileté et rapidité étaient nécessaires et, à mon grand regret, je n’ai jamais réussi à capturer un de ces maudits bivalves.
Une autre technique m’amusait beaucoup.
Sous les rochers plus ou moins immergés, des colonies de crabes se cachaient sous les algues et dans les trous.
Armés d’un bon mètre de fil ou de ficelle, équipé à l’une de ses extrémités d’une épingle de sureté, nous embrochions sur cette épingle, avant de la refermer, l’un de ces nombreux « chapeaux chinois », appelés patelles, collés sur les rochers, préalablement écrasés et réduits en bouillie à l’aide d’un galet.
Ce bout de chair, plongé dans l’eau près des trous du rocher, était très rapidement assailli par une escouade de crabes.
Nous attendions que le plus gros d’entre eux ayant chassé les autres prenne solidement la pauvre patelle dans ses pinces, pour remonter le tout en surface, juste au-dessus de notre panier, dans lequel le crabe ainsi piégé tombait après avoir enfin consenti à lâcher sa proie.
J’avais quant à moi, et j’en étais très fier, mis au point une façon ultra efficace de capturer des crevettes.
En m’inspirant de la technique de pêche aux écrevisses, après avoir martyrisé de la même façon que pour les crabes une demi-douzaine de patelles, je déposais ces dépouilles délicatement dans la poche du petit filet offert par Tonton, et je présentais le tout, marée montante, au pied d’un rocher partiellement immergé.
Miraculeusement attirées par l’odeur de l’appât, les crevettes, d’abord prudemment puis résolument, se précipitaient sur l’offre qui leur était faite.
Le filet vivement relevé, je remplissais mon seau rempli d’eau de mer, par dizaines de prises frétillantes.
Le seul problème était que, souvent, les crabes arrivaient aussi, perturbant l’opération.
Il fallait donc trouver un juste milieu entre une levée trop rapide avec peu ou pas de crevettes, ou trop tardive avec l’irruption intempestive d’un ou plusieurs crabes qui faisaient fuir tout le monde.
J’étais devenu un expert à ce petit jeu que je pratiquais encore, il y a quelques années, quand, à Roscanvel, chez mon cher breton de beau-frère, j’assurais une partie de l’accompagnement de nos apéritifs de fin de journée.
Cette première découverte de l’océan marque la naissance de mon amour inconditionnel de la mer, la Méditerranée bien sûr que j’ai connue plus tard, mais surtout l’Atlantique, plus froid c’est vrai, mais tellement plus sauvage et riche des promesses que l’on doit aux marées.
Commentaires